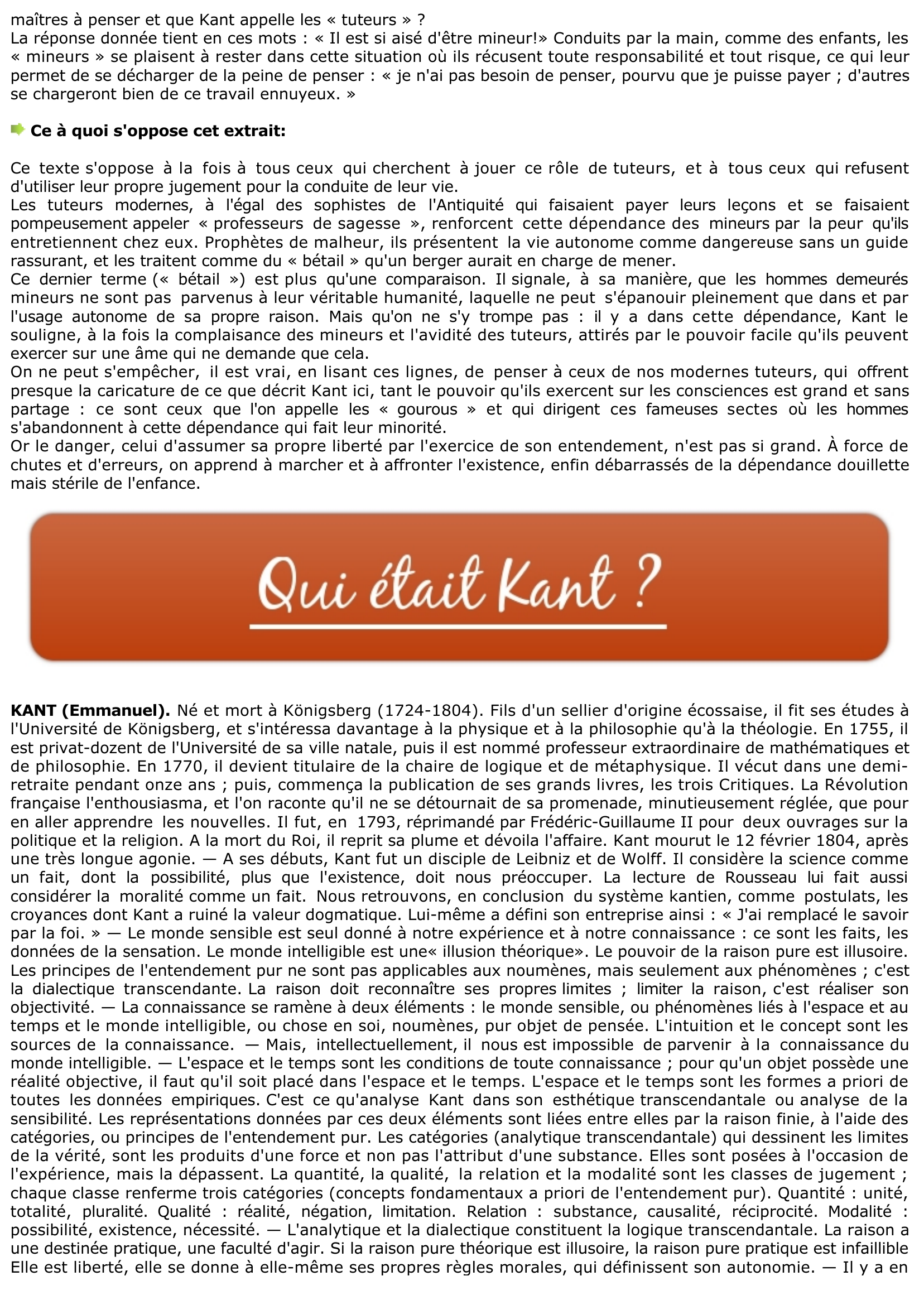Emmanuel Kant: La liberté fait-elle peur ?
Publié le 09/03/2005

Extrait du document

questions indicatives Est-ce à cause (et/ou seulement à cause) des « tuteurs « que « la plus grande partie des hommes (et avec eux, le beau sexe tout entier) tiennent pour difficile, même pour très dangereux, le passage de la minorité à la majorité «? L'assertion contenue dans la première phrase est-elle contradictoire avec cela ? Sinon, comment les deux assertions peuvent-elles s'articuler ? Comment penser alors que « le beau sexe tout entier tient pour... « ? Pourquoi est-il « si commode d'être mineur « ? Qu'en pensez-vous ? Importance de la notation « Après les avoir d'abord abêtis en les traitant comme des animaux domestiques... « dans l'argumentation et la position de Kant ? Quel est l'enjeu de ce texte ? Est-ce un texte : pédagogique ? moral ? philosophique ?

«
maîtres à penser et que Kant appelle les « tuteurs » ?La réponse donnée tient en ces mots : « Il est si aisé d'être mineur!» Conduits par la main, comme des enfants, les« mineurs » se plaisent à rester dans cette situation où ils récusent toute responsabilité et tout risque, ce qui leurpermet de se décharger de la peine de penser : « je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d'autresse chargeront bien de ce travail ennuyeux.
»
Ce à quoi s'oppose cet extrait:
Ce texte s'oppose à la fois à tous ceux qui cherchent à jouer ce rôle de tuteurs, et à tous ceux qui refusentd'utiliser leur propre jugement pour la conduite de leur vie.Les tuteurs modernes, à l'égal des sophistes de l'Antiquité qui faisaient payer leurs leçons et se faisaientpompeusement appeler « professeurs de sagesse », renforcent cette dépendance des mineurs par la peur qu'ilsentretiennent chez eux.
Prophètes de malheur, ils présentent la vie autonome comme dangereuse sans un guiderassurant, et les traitent comme du « bétail » qu'un berger aurait en charge de mener.Ce dernier terme (« bétail ») est plus qu'une comparaison.
Il signale, à sa manière, que les hommes demeurésmineurs ne sont pas parvenus à leur véritable humanité, laquelle ne peut s'épanouir pleinement que dans et parl'usage autonome de sa propre raison.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : il y a dans cette dépendance, Kant lesouligne, à la fois la complaisance des mineurs et l'avidité des tuteurs, attirés par le pouvoir facile qu'ils peuventexercer sur une âme qui ne demande que cela.On ne peut s'empêcher, il est vrai, en lisant ces lignes, de penser à ceux de nos modernes tuteurs, qui offrentpresque la caricature de ce que décrit Kant ici, tant le pouvoir qu'ils exercent sur les consciences est grand et sanspartage : ce sont ceux que l'on appelle les « gourous » et qui dirigent ces fameuses sectes où les hommess'abandonnent à cette dépendance qui fait leur minorité.Or le danger, celui d'assumer sa propre liberté par l'exercice de son entendement, n'est pas si grand.
À force dechutes et d'erreurs, on apprend à marcher et à affronter l'existence, enfin débarrassés de la dépendance douillettemais stérile de l'enfance.
KANT (Emmanuel). Né et mort à Königsberg (1724-1804).
Fils d'un sellier d'origine écossaise, il fit ses études à l'Université de Königsberg, et s'intéressa davantage à la physique et à la philosophie qu'à la théologie.
En 1755, ilest privat-dozent de l'Université de sa ville natale, puis il est nommé professeur extraordinaire de mathématiques etde philosophie.
En 1770, il devient titulaire de la chaire de logique et de métaphysique.
Il vécut dans une demi-retraite pendant onze ans ; puis, commença la publication de ses grands livres, les trois Critiques.
La Révolutionfrançaise l'enthousiasma, et l'on raconte qu'il ne se détournait de sa promenade, minutieusement réglée, que pouren aller apprendre les nouvelles.
Il fut, en 1793, réprimandé par Frédéric-Guillaume II pour deux ouvrages sur lapolitique et la religion.
A la mort du Roi, il reprit sa plume et dévoila l'affaire.
Kant mourut le 12 février 1804, aprèsune très longue agonie.
— A ses débuts, Kant fut un disciple de Leibniz et de Wolff.
Il considère la science commeun fait, dont la possibilité, plus que l'existence, doit nous préoccuper.
La lecture de Rousseau lui fait aussiconsidérer la moralité comme un fait.
Nous retrouvons, en conclusion du système kantien, comme postulats, lescroyances dont Kant a ruiné la valeur dogmatique.
Lui-même a défini son entreprise ainsi : « J'ai remplacé le savoirpar la foi.
» — Le monde sensible est seul donné à notre expérience et à notre connaissance : ce sont les faits, lesdonnées de la sensation.
Le monde intelligible est une« illusion théorique».
Le pouvoir de la raison pure est illusoire.Les principes de l'entendement pur ne sont pas applicables aux noumènes, mais seulement aux phénomènes ; c'estla dialectique transcendante.
La raison doit reconnaître ses propres limites ; limiter la raison, c'est réaliser sonobjectivité.
— La connaissance se ramène à deux éléments : le monde sensible, ou phénomènes liés à l'espace et autemps et le monde intelligible, ou chose en soi, noumènes, pur objet de pensée.
L'intuition et le concept sont lessources de la connaissance.
— Mais, intellectuellement, il nous est impossible de parvenir à la connaissance dumonde intelligible.
— L'espace et le temps sont les conditions de toute connaissance ; pour qu'un objet possède uneréalité objective, il faut qu'il soit placé dans l'espace et le temps.
L'espace et le temps sont les formes a priori detoutes les données empiriques.
C'est ce qu'analyse Kant dans son esthétique transcendantale ou analyse de lasensibilité.
Les représentations données par ces deux éléments sont liées entre elles par la raison finie, à l'aide descatégories, ou principes de l'entendement pur.
Les catégories (analytique transcendantale) qui dessinent les limitesde la vérité, sont les produits d'une force et non pas l'attribut d'une substance.
Elles sont posées à l'occasion del'expérience, mais la dépassent.
La quantité, la qualité, la relation et la modalité sont les classes de jugement ;chaque classe renferme trois catégories (concepts fondamentaux a priori de l'entendement pur).
Quantité : unité,totalité, pluralité.
Qualité : réalité, négation, limitation.
Relation : substance, causalité, réciprocité.
Modalité :possibilité, existence, nécessité.
— L'analytique et la dialectique constituent la logique transcendantale.
La raison aune destinée pratique, une faculté d'agir.
Si la raison pure théorique est illusoire, la raison pure pratique est infaillibleElle est liberté, elle se donne à elle-même ses propres règles morales, qui définissent son autonomie.
— Il y a en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Kant : La liberté malgré le déterminisme Emmanuel KANT écrit en 1781 son ouvrage « Critique de la raison pure » dans lequel figure l’extrait que nous allons tenter expliquer.
- Un des plus grands problèmes de l'éducation est le suivant: comment unir la soumission sous une contrainte légale avec la faculté de se servir de sa liberté? Car la contrainte est nécessaire! Mais comment puis-je cultiver la liberté sous la contrainte? Réflexions sur l'éducation Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.
- La liberté est sauvegardée, quand elle est comprise comme la puissance d'agir déterminée par la représentation claire du meilleur possible. Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.
- Un des plus grands problèmes de l'éducation est le suivant: comment unir la soumission sous une contrainte légale avec la faculté de se servir de sa liberté? Car la contrainte est nécessaire! Mais comment puis-je cultiver la liberté sous la contrainte? [ Réflexions sur l'éducation ] Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.
- La liberté est sauvegardée, quand elle est comprise comme la puissance d'agir déterminée par la représentation claire du meilleur possible. [ ] Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.