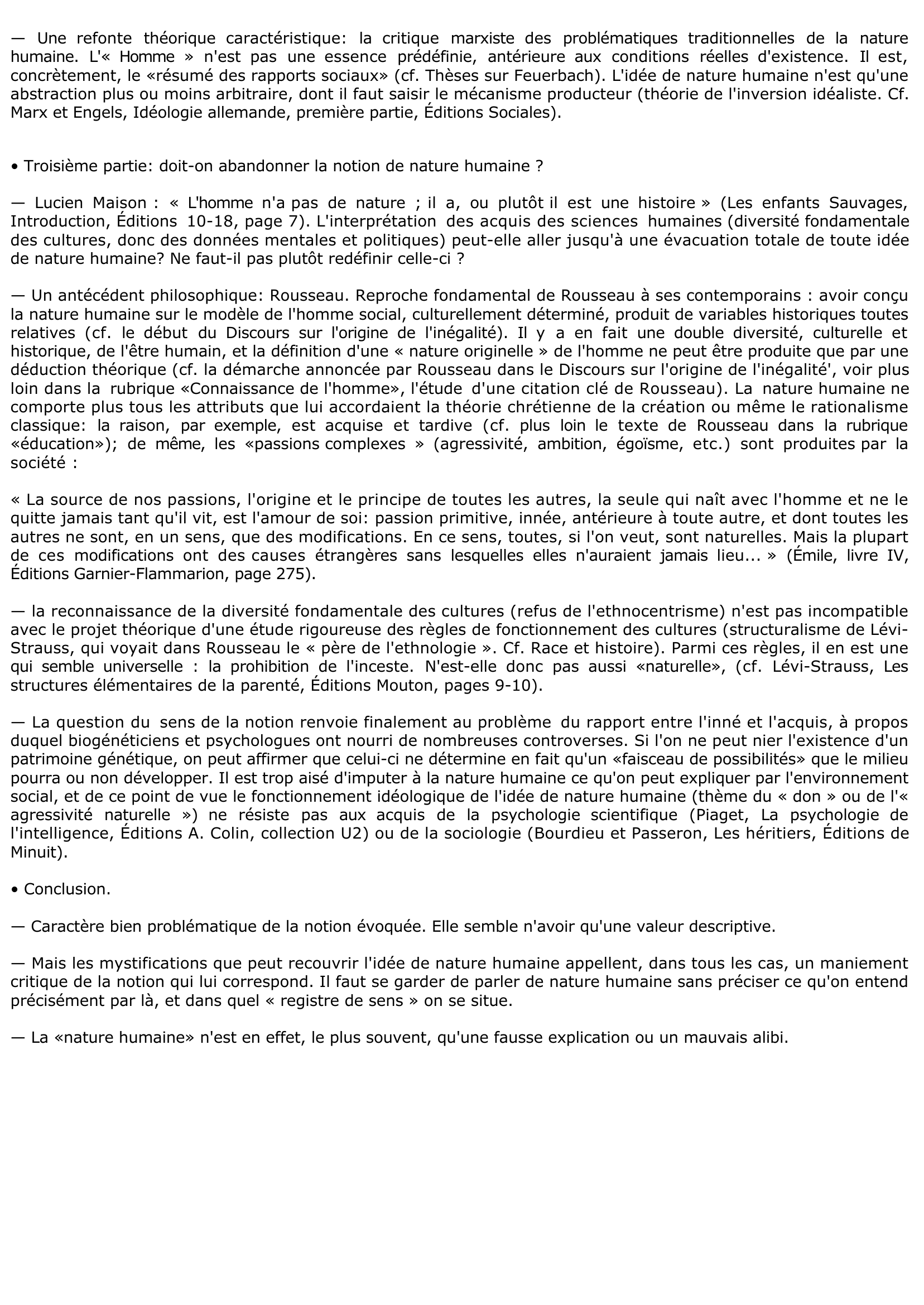En quel sens peut-on parler d'une nature humaine ?
Publié le 10/02/2011

Extrait du document
— Représentations traditionnelles des données propres à l'existence humaine: existence d'une «nature«, prédéfinie, opposant radicalement l'homme à l'animal (cf. Bible, Ancien Testament. Genèse). — Découverte de la variété des civilisations: élément de problématisation de ces représentations. — Développement des sciences humaines : confirmation de cette problématisation. — Mais l'apport récent de la biologie génétique (patrimoine génétique, hérédité) nuance cette problématisation.
«
— Une refonte théorique caractéristique: la critique marxiste des problématiques traditionnelles de la naturehumaine.
L'« Homme » n'est pas une essence prédéfinie, antérieure aux conditions réelles d'existence.
Il est,concrètement, le «résumé des rapports sociaux» (cf.
Thèses sur Feuerbach).
L'idée de nature humaine n'est qu'uneabstraction plus ou moins arbitraire, dont il faut saisir le mécanisme producteur (théorie de l'inversion idéaliste.
Cf.Marx et Engels, Idéologie allemande, première partie, Éditions Sociales).
• Troisième partie: doit-on abandonner la notion de nature humaine ?
— Lucien Maison : « L'homme n'a pas de nature ; il a, ou plutôt il est une histoire » (Les enfants Sauvages,Introduction, Éditions 10-18, page 7).
L'interprétation des acquis des sciences humaines (diversité fondamentaledes cultures, donc des données mentales et politiques) peut-elle aller jusqu'à une évacuation totale de toute idéede nature humaine? Ne faut-il pas plutôt redéfinir celle-ci ?
— Un antécédent philosophique: Rousseau.
Reproche fondamental de Rousseau à ses contemporains : avoir conçula nature humaine sur le modèle de l'homme social, culturellement déterminé, produit de variables historiques toutesrelatives (cf.
le début du Discours sur l'origine de l'inégalité).
Il y a en fait une double diversité, culturelle ethistorique, de l'être humain, et la définition d'une « nature originelle » de l'homme ne peut être produite que par unedéduction théorique (cf.
la démarche annoncée par Rousseau dans le Discours sur l'origine de l'inégalité', voir plusloin dans la rubrique «Connaissance de l'homme», l'étude d'une citation clé de Rousseau).
La nature humaine necomporte plus tous les attributs que lui accordaient la théorie chrétienne de la création ou même le rationalismeclassique: la raison, par exemple, est acquise et tardive (cf.
plus loin le texte de Rousseau dans la rubrique«éducation»); de même, les «passions complexes » (agressivité, ambition, égoïsme, etc.) sont produites par lasociété :
« La source de nos passions, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui naît avec l'homme et ne lequitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de soi: passion primitive, innée, antérieure à toute autre, et dont toutes lesautres ne sont, en un sens, que des modifications.
En ce sens, toutes, si l'on veut, sont naturelles.
Mais la plupartde ces modifications ont des causes étrangères sans lesquelles elles n'auraient jamais lieu...
» (Émile, livre IV,Éditions Garnier-Flammarion, page 275).
— la reconnaissance de la diversité fondamentale des cultures (refus de l'ethnocentrisme) n'est pas incompatibleavec le projet théorique d'une étude rigoureuse des règles de fonctionnement des cultures (structuralisme de Lévi-Strauss, qui voyait dans Rousseau le « père de l'ethnologie ».
Cf.
Race et histoire).
Parmi ces règles, il en est unequi semble universelle : la prohibition de l'inceste.
N'est-elle donc pas aussi «naturelle», (cf.
Lévi-Strauss, Lesstructures élémentaires de la parenté, Éditions Mouton, pages 9-10).
— La question du sens de la notion renvoie finalement au problème du rapport entre l'inné et l'acquis, à proposduquel biogénéticiens et psychologues ont nourri de nombreuses controverses.
Si l'on ne peut nier l'existence d'unpatrimoine génétique, on peut affirmer que celui-ci ne détermine en fait qu'un «faisceau de possibilités» que le milieupourra ou non développer.
Il est trop aisé d'imputer à la nature humaine ce qu'on peut expliquer par l'environnementsocial, et de ce point de vue le fonctionnement idéologique de l'idée de nature humaine (thème du « don » ou de l'«agressivité naturelle ») ne résiste pas aux acquis de la psychologie scientifique (Piaget, La psychologie del'intelligence, Éditions A.
Colin, collection U2) ou de la sociologie (Bourdieu et Passeron, Les héritiers, Éditions deMinuit).
• Conclusion.
— Caractère bien problématique de la notion évoquée.
Elle semble n'avoir qu'une valeur descriptive.
— Mais les mystifications que peut recouvrir l'idée de nature humaine appellent, dans tous les cas, un maniementcritique de la notion qui lui correspond.
Il faut se garder de parler de nature humaine sans préciser ce qu'on entendprécisément par là, et dans quel « registre de sens » on se situe.
— La «nature humaine» n'est en effet, le plus souvent, qu'une fausse explication ou un mauvais alibi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quel sens et quelle valeur attribuez-vous à l'affirmation de Rousseau selon laquelle «Quand il est question de raisonner sur la nature humaine, le vrai philosophe n'est ni Indien, ni Tartare, ni de Genève, ni de Paris, mais il est homme». ?
- En quel sens le désir révèle-t-il la nature humaine ?
- Parler de nature humaine cela a-t-il encore un sens aujourd'hui ?
- L'idée de nature humaine a-t-elle un sens ?
- En quel sens peut-on parler d'une nature humaine ?