EPICURE - LETTRE A MENECEE
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
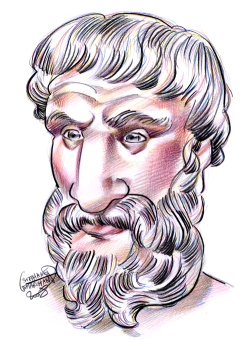
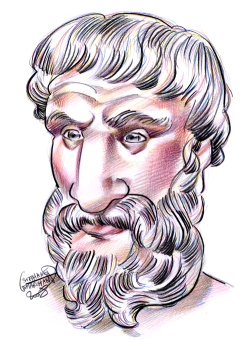
«
plénitude d'une vie heureuse, il convient donc de les éliminer.b) Les désirs naturels quant à eux sont nécessaires ou non et parmi les nécessaires, ils tiennent leur nécessité soitde la vie même, soit pour le bien-être du corps, soit pour le bonheur.
Commençons par étudier ces derniers.
Lesdésirs naturels et nécessaires pour la vie même sont la faim et la soif, sans la satisfaction desquelles nous nepouvons pas vivre, car en raison de doctrine atomiste d'Epicure , les déperditions atomiques de notre organisme doivent être compensées.
Cela est inhérent à la condition humaine et à la condition divine à ceci prêt que chez lesDieux la perte est immédiatement compensée.
Or chez l'homme la non-compensation peut entraîner la perte mêmede la vie, c'est-à-dire une destruction qui prendrait la forme de la douleur.
En ce sens, on comprend alors que leplaisir de manger et de boire traduisent le processus de restauration de notre nature.
Nous ne sommes que despaquets d'atomes.
Pour le bien-être du corps, c'est-à-dire pour la quiétude du corps.
Il s'agit simplement deprotéger le corps des dangers extérieurs comme le froid, les intempéries ou les dangers qui pourraient entamer unprocessus de destruction général du corps en bouleversant les éléments de notre nature.
D'où le désir de protectiondu corps c'est-à-dire à travers un abri ou un vêtement.
Il s'agit là en fait d'un définition du mode de vie du sageépicurien qui n'a rien de primitif mais simplement de frugalité reposant effectivement sur les premiers acquis de lacivilisation à savoir : le feu, le vêtement, l'abri.
Enfin pour le bonheur qui est la dernière forme des désirs naturels etnécessaires.
Chez Epicure il s'agit du désir de la philosophie car avec la civilisation l'homme s'est éloigné de son étatde nature, et c'est bien à travers la philosophie qu'il peut comprendre et apprendre que tous les désirs ne sont pasbons, que beaucoup sont sans objet et doivent être éliminés.
Reste donc les désirs naturels et non nécessaires.Principalement, ils sont de deux types, les désirs sexuels et les désirs esthétiques.
Pour Epicure, si la non-satisfaction sexuelle est compatible avec le bonheur c'est qu'elle n'entraîne pas de douleur.
En effet, si ne pasmanger provoque douleur et trouble parce qu'il a des atomes en moins ; le désir sexuel est la marque de la présenced'atomes en trop.
Il est dès lors possible de remplacer la satisfaction sexuelle par une autre activité, comme untravail pénible, qui rétablira l'harmonie physiologique.
Le désir ne subsiste pas, il n'est pas refoulé : il a simplementdisparu.
Quant aux désirs esthétiques, c'est-à-dire le plaisir pris au beau, on peut s'en passer : ils ne sont pasnécessaires au sage mais rien ne s'oppose à ce qu'on y goûte.
Dès lors, le dénominateurs communs de tous cesdésirs sont leur naturalité, c'est-à-dire un rapport d'équilibre, d'harmonie dans notre nature.
Cette harmonie estl'exigence même de la Nature qui tend à la réalisation de l'équilibre et de l'accord.c) C'est en effet pour cela que selon Epicure , toute théorie du désir doit se comprendre à l'aune d'une réflexion sur l'harmonie et l'équilibre du corps et de l'âme afin de mener une vie heureuse ce qui est le but de l'Ethique.
Dès lorson remarque que l'Ethique n'est pas indépendante de la physique chez Epicure dans la mesure où de part la thèseatomiste la perfection se situe dans la juste proportion.
Toute la lettre à Ménécée insiste justement sur cette volonté de mener une « vie heureuse » et la régulation ou la réglementation des désirs en fait partie au même titreque la réflexion sur la mort.
Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve un ton que l'on pourrait dire pédagogiquetout au long de la lettre.
Le but est effectivement d'éviter la douleur qui est un trouble atomique, un manque, ou lapeur qui est une crainte alors toute psychologique.
La douleur est un manque.
Elle est un processus finie, amenantà la destruction du corps.
C'est donc proprement une morale ou une éthique hédoniste que nous propose Epicuredans le sens où le plaisir qui est alors comme un repos traduit l'état d'équilibre du corps.
Et s'il faut limiter les désirset la peur, c'est que la peur est une peur de la mort qui entraîne avec elle l'inquiétude, l'ambition de l'amour et del'argent, la vaine gloire.
Ils sont donc contraire à l'ataraxie, ce repos de l'âme ; l'âme n'est pas en repos, elle n'estpas tranquille ce qui crée le mal.
L'ataraxie, ce bonheur des Dieux est donc possible pour le sage qui essayed'atteindre le bonheur par une purification de la vie, en renonçant à tout ce qui est vain et superflu.
Le bonheurconsistant dans cet équilibre et une fois atteint, la « tempête » cesse.
L'homme ne court plus de divertissement endiversement, de vide en vide.
Il s'agit donc de ne plus souffrir.
Transition : Ainsi à travers cette purgation ou purification des désirs Epicure nous propose une typologie hiérarchisée des désirssuivant une dichotomie apte à rendre compte de la nature des désirs et de leur naturalité ou/et nécessité si tel estle cas.
En ce sens le plaisir semble bien être la norme de la vie heureuse en tant qu'aponie et ataraxie.
Dès lors, lasuite du texte peut se comprendre comme une conséquence et devra définir plus amplement le rapport plaisir –nature.
II – Le plaisir comme source et fin du bonheur a) Dès lors pour nous se tire une conséquence que l'on trouve présente dès le début de ce paragraphe : le plaisirest source et fin du bonheur.
Pourquoi ? La plaisir est effectivement la fin de la nature.
La nature s'oppose au videcomme le fini à ce qui est générateur de désirs sans limites.
Le plaisir est en effet conforme à notre nature.
Lanature est pour nous une norme au sens où c'est ce d'après quoi on doit se diriger dont il ne faut pas s'écarter, oudont il suffit de ne pas s'écarter pour rester et être heureux.
C'est pourquoi le plaisir est commencement et fin.
Eneffet, l'homme qui n'est pas heureux est dans cette situation par oubli de sa nature.
Ses choix et ses actions nesont pas conformes à sa nature, c'est-à-dire à son harmonie.
Dès lors il est la proie des craintes, de la peur et desdésirs vains.
Pour redevenir heureux l'homme doit faire un retour en lui-même, c'est-à-dire vers sa nature propre etrechercher dans son agir l'harmonie afin de trouver le repos.b) Et le guide qui nous informe de cette nature est bien la sensation.
Elle est un signe de cette présence ouabsence d'équilibre.
Elle est juge de notre situation.
En ce sens, on comprend alors qu'elle désigne le plaisir commeun bien et la douleur comme un mal.
Comme « pathos », la sensation nous informe immédiatement sur la poursuite àavoir face au plaisir et à la fuite face à la douleur.
C'est donc en recherchant les plaisirs que l'on vivra en accordavec la Nature et sa nature.
C'est toujours en fonction du plaisir qu'il faudra effectuer nos choix ou refuser.
En ce.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FICHE DE LECTURE, EPICURE, LETTRE A MENECEE
- PRESENTATION DE LA "LETTRE A MENECEE" D'EPICURE: Le plaisir est notre bien principal et inné
- EPICURE: LETTRE A MENECEE (Résumé & Analyse)
- Fiche lecture : Epicure - Lettre à Ménécée
- Epicure, explication de texte, Lettre à Ménécée

































