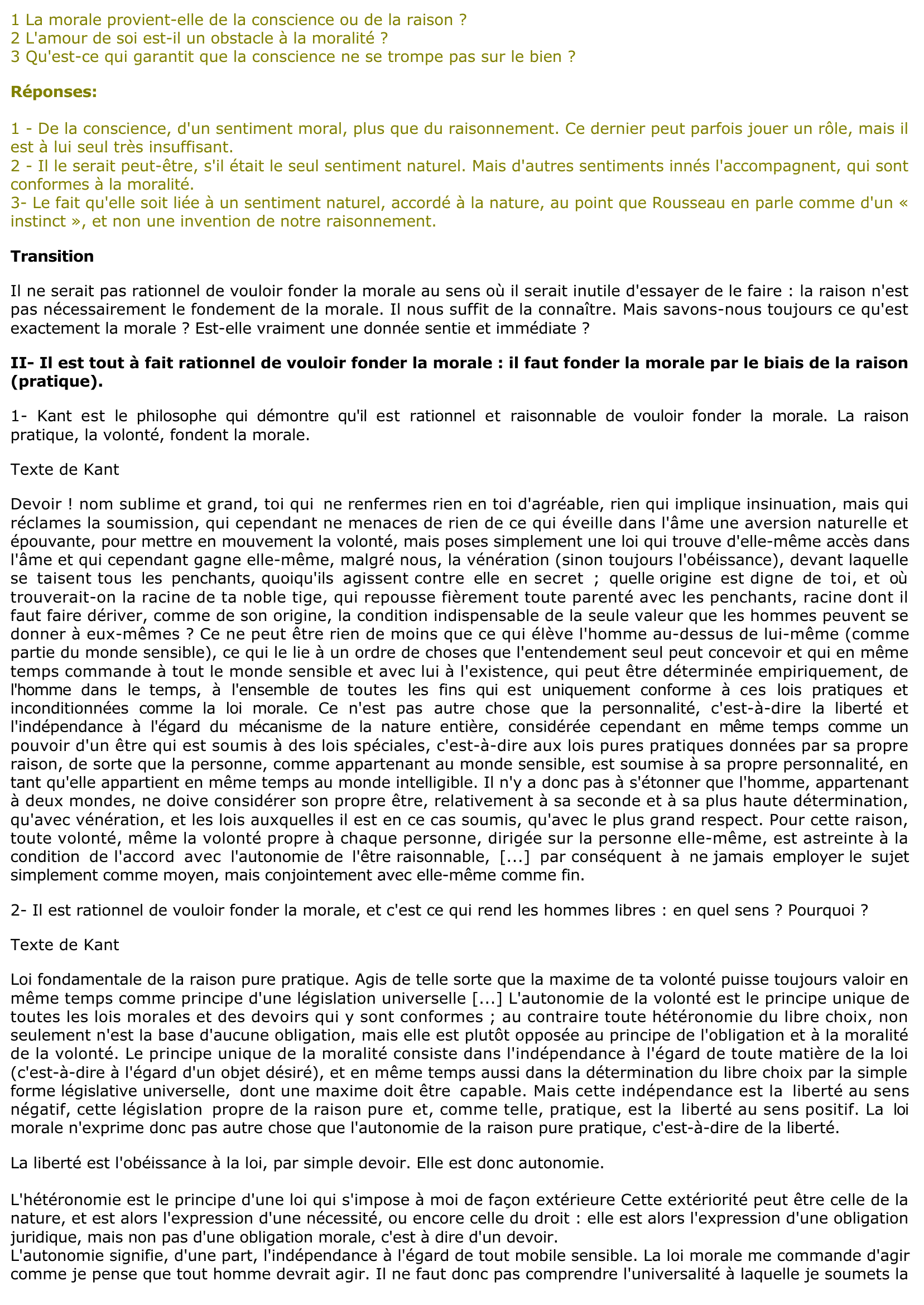Est-il rationnel de vouloir fonder la morale?
Publié le 30/01/2005

Extrait du document

La morale désigne l’ensemble des règles de conduite tenues pour inconditionnellement valables. La morale indique aux hommes ce qu’il faut faire, la manière dont ils doivent agir, et ce qui est bien et mal. La morale ne désigne pas une morale particulière à tels ou tels individus, ou à telle ou telle société, mais la morale en général- le concept de morale. Fonder la morale serait l’établir sur une base solide : le fondement d’une chose ou d’une idée est ce qui lui donne sa raison d’être, ce qui lui confère son existence. Vouloir fonder la morale reviendrait à appliquer sa volonté à donner sa raison d’être à l’ensemble des règles de conduite tenues pour inconditionnellement valables. Est-il rationnel, conforme à la raison, logique de vouloir donner la raison d’être de ce qui dicte ce qu’il nous faut faire ? En somme, est-il rationnel de vouloir fonder la morale ? Vouloir fonder la morale, est-ce une ambition irrationnelle, absurde ? N’est-il pas possible de donner la raison d’être de la morale ? Cette raison est-elle inaccessible à la raison humaine ?

«
1 La morale provient-elle de la conscience ou de la raison ?2 L'amour de soi est-il un obstacle à la moralité ?3 Qu'est-ce qui garantit que la conscience ne se trompe pas sur le bien ?
Réponses:
1 - De la conscience, d'un sentiment moral, plus que du raisonnement.
Ce dernier peut parfois jouer un rôle, mais ilest à lui seul très insuffisant.2 - Il le serait peut-être, s'il était le seul sentiment naturel.
Mais d'autres sentiments innés l'accompagnent, qui sontconformes à la moralité.3- Le fait qu'elle soit liée à un sentiment naturel, accordé à la nature, au point que Rousseau en parle comme d'un «instinct », et non une invention de notre raisonnement.
Transition
Il ne serait pas rationnel de vouloir fonder la morale au sens où il serait inutile d'essayer de le faire : la raison n'estpas nécessairement le fondement de la morale.
Il nous suffit de la connaître.
Mais savons-nous toujours ce qu'estexactement la morale ? Est-elle vraiment une donnée sentie et immédiate ?
II- Il est tout à fait rationnel de vouloir fonder la morale : il faut fonder la morale par le biais de la raison(pratique).
1- Kant est le philosophe qui démontre qu'il est rationnel et raisonnable de vouloir fonder la morale.
La raisonpratique, la volonté, fondent la morale.
Texte de Kant
Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui implique insinuation, mais quiréclames la soumission, qui cependant ne menaces de rien de ce qui éveille dans l'âme une aversion naturelle etépouvante, pour mettre en mouvement la volonté, mais poses simplement une loi qui trouve d'elle-même accès dansl'âme et qui cependant gagne elle-même, malgré nous, la vénération (sinon toujours l'obéissance), devant laquellese taisent tous les penchants, quoiqu'ils agissent contre elle en secret ; quelle origine est digne de toi, et oùtrouverait-on la racine de ta noble tige, qui repousse fièrement toute parenté avec les penchants, racine dont ilfaut faire dériver, comme de son origine, la condition indispensable de la seule valeur que les hommes peuvent sedonner à eux-mêmes ? Ce ne peut être rien de moins que ce qui élève l'homme au-dessus de lui-même (commepartie du monde sensible), ce qui le lie à un ordre de choses que l'entendement seul peut concevoir et qui en mêmetemps commande à tout le monde sensible et avec lui à l'existence, qui peut être déterminée empiriquement, del'homme dans le temps, à l'ensemble de toutes les fins qui est uniquement conforme à ces lois pratiques etinconditionnées comme la loi morale.
Ce n'est pas autre chose que la personnalité, c'est-à-dire la liberté etl'indépendance à l'égard du mécanisme de la nature entière, considérée cependant en même temps comme unpouvoir d'un être qui est soumis à des lois spéciales, c'est-à-dire aux lois pures pratiques données par sa propreraison, de sorte que la personne, comme appartenant au monde sensible, est soumise à sa propre personnalité, entant qu'elle appartient en même temps au monde intelligible.
Il n'y a donc pas à s'étonner que l'homme, appartenantà deux mondes, ne doive considérer son propre être, relativement à sa seconde et à sa plus haute détermination,qu'avec vénération, et les lois auxquelles il est en ce cas soumis, qu'avec le plus grand respect.
Pour cette raison,toute volonté, même la volonté propre à chaque personne, dirigée sur la personne elle-même, est astreinte à lacondition de l'accord avec l'autonomie de l'être raisonnable, [...] par conséquent à ne jamais employer le sujetsimplement comme moyen, mais conjointement avec elle-même comme fin.
2- Il est rationnel de vouloir fonder la morale, et c'est ce qui rend les hommes libres : en quel sens ? Pourquoi ?
Texte de Kant
Loi fondamentale de la raison pure pratique.
Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir enmême temps comme principe d'une législation universelle [...] L'autonomie de la volonté est le principe unique detoutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes ; au contraire toute hétéronomie du libre choix, nonseulement n'est la base d'aucune obligation, mais elle est plutôt opposée au principe de l'obligation et à la moralitéde la volonté.
Le principe unique de la moralité consiste dans l'indépendance à l'égard de toute matière de la loi(c'est-à-dire à l'égard d'un objet désiré), et en même temps aussi dans la détermination du libre choix par la simpleforme législative universelle, dont une maxime doit être capable.
Mais cette indépendance est la liberté au sensnégatif, cette législation propre de la raison pure et, comme telle, pratique, est la liberté au sens positif.
La loimorale n'exprime donc pas autre chose que l'autonomie de la raison pure pratique, c'est-à-dire de la liberté.
La liberté est l'obéissance à la loi, par simple devoir.
Elle est donc autonomie.
L'hétéronomie est le principe d'une loi qui s'impose à moi de façon extérieure Cette extériorité peut être celle de lanature, et est alors l'expression d'une nécessité, ou encore celle du droit : elle est alors l'expression d'une obligationjuridique, mais non pas d'une obligation morale, c'est à dire d'un devoir.L'autonomie signifie, d'une part, l'indépendance à l'égard de tout mobile sensible.
La loi morale me commande d'agircomme je pense que tout homme devrait agir.
Il ne faut donc pas comprendre l'universalité à laquelle je soumets la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on fonder la morale SUR LA RECHERCHE DU BONHEUR?
- L'eudémonisme peut-il fonder la morale ?
- Le bonheur peut-il fonder la morale ?
- Commenter ou discuter cette pensée de Renouvier : « La morale et les mathématiques ont cela de commun que, pour exister en tant que sciences, elles doivent se fonder sur de purs concepts. L'expérience et l’histoire sont plus loin de représenter les lois de la morale que la nature ne l’est de réaliser exactement les Idées mathématiques »
- Le fondement de la morale est-il rationnel ?