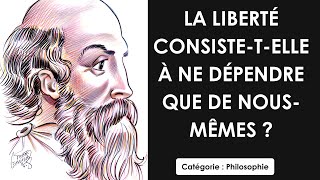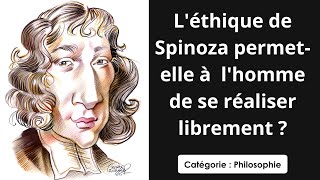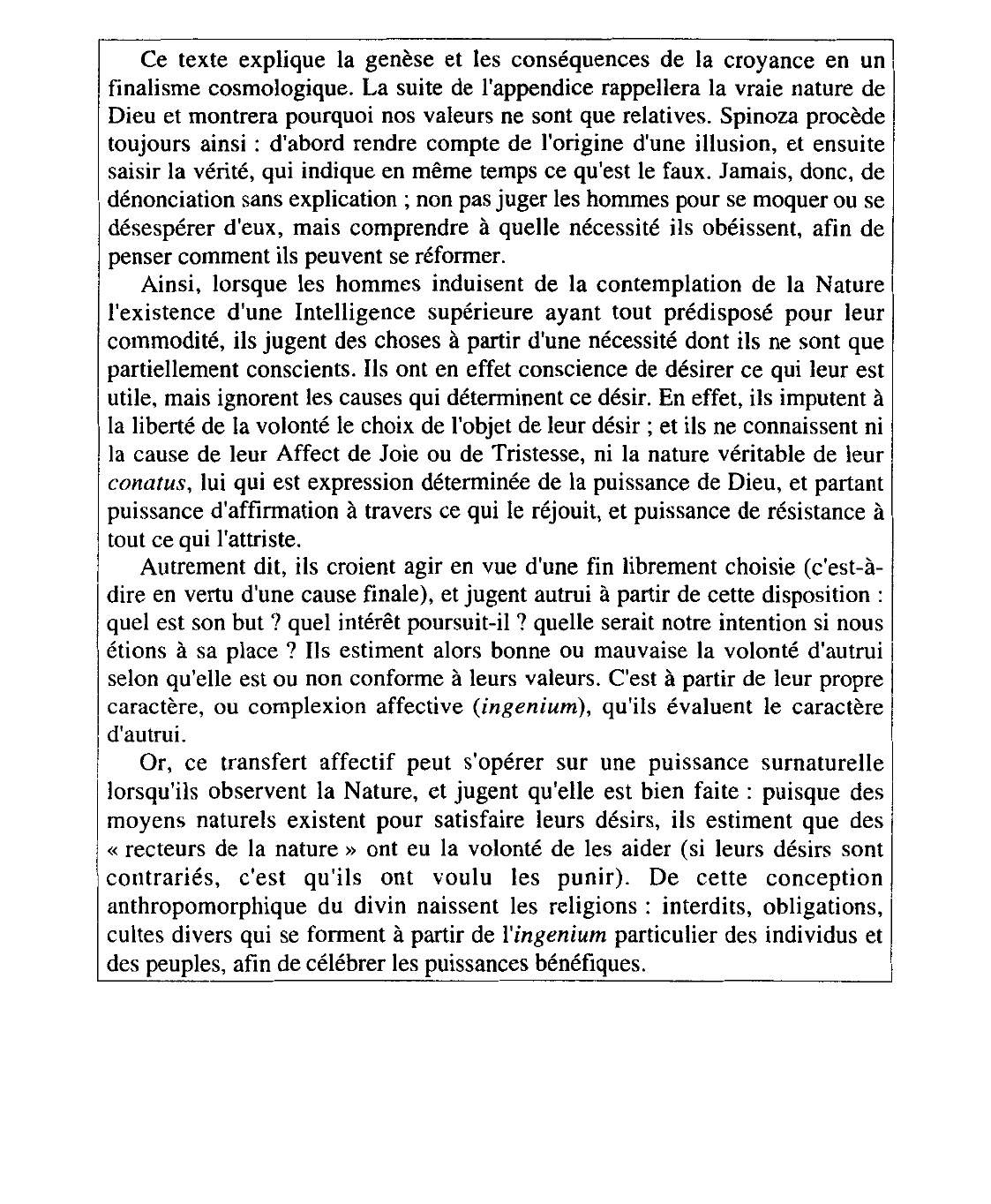Éthique, I, Appendice (extrait). Aristote
Publié le 22/03/2015
Extrait du document

Tous les hommes naissent ignorants des causes des choses, et [...j tous ont l'appétit de chercher ce qui leur est utile [suum utile], chose dont ils sont conscients. De cela, il suit en effet, premièrement, que les hommes ont pour opinion qu'ils sont libres, puisqu'ils sont conscients de leurs volitions et de leur appétit, et sont ignorants des causes par lesquelles ils sont disposés à vouloir et à avoir en appétit, et auxquelles méme en rêve ils ne pensent pas. Il suit, deuxiè¬mement, que les hommes en tout agissent à cause d'une fin ; évidemment, à cause de l'utile, dont ils ont l'appétit ; d'où vient que, toujours ils réclament de savoir les causes seulement finales des choses accomplies, et quand ils les ont entendues, ils sont satisfaits ; à l'évidence, parce qu'ils n'ont aucune raison de douter davantage. Mais s'ils ne peuvent les entendre d'autrui, il ne leur reste plus qu'à se tourner vers eux-mêmes, à réfléchir aux fins par lesquelles ils sont eux-mêmes habituellement déterminés à des actes semblables, et ainsi à juger nécessairement à partir de leur propre caractère du caractère d'autrui.
De plus, comme ils trouvent en eux et hors d'eux bon nombre de moyens qui conduisent grandement à atteindre ce qui leur est utile, comme par ex. des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des végétaux et des animaux pour s'alimenter, un soleil pour s'éclairer, une mer pour nourrir des poissons, etc., de là vint qu'ils considèrent toutes choses naturelles comme des moyens pour ce qui leur est utile ; et parce qu'ils savent que ces moyens, ils les ont trouvés et non pas fabriqués, ils y ont vu une raison de croire qu'il y avait quelqu'un d'autre, qui avait fabriqué ces moyens à leur usage. Car, après avoir considéré ces choses comme des moyens, il leur devint impossible de croire qu'elles se suivirent les unes les autres ; mais, à partir des moyens qu'habituellement ils se fabriquaient eux-mêmes, ils ont dû conclure qu'il y avait un ou plusieurs recteurs de la nature, dotés de liberté humaine, ayant pour eux pris soin de tout, et ayant pour leur usage tout fait. Or, le caractère de ces recteurs, puisqu'ils n'avaient rien entendu à leur sujet, ils ont dû également en juger à partir du leur, et de là ils ont établi que les Dieux dirigent tout à l'usage des hommes, pour s'attacher les hommes, et être tenus par eux dans un suprême honneur.
Éthique, I, Appendice (extrait).

«
Textes commentés 37
Ce texte explique la genèse et les conséquences de la croyance en un
finalisme cosmologique.
La suite de l'appendice rappellera la vraie nature de
Dieu et montrera pourquoi nos valeurs ne sont que relatives.
Spinoza procède
toujours ainsi : d'abord rendre compte de l'origine d'une illusion, et ensuite
saisir la vérité, qui indique en même temps ce qu'est le faux.
Jamais, donc, de
dénonciation sans explication ; non pas juger les hommes pour
se moquer ou se
désespérer d'eux, mais comprendre à quelle nécessité ils obéissent, afin de
penser comment ils peuvent
se réformer.
Ainsi, lorsque les hommes induisent de la contemplation de la Nature
l'existence d'une Intelligence supérieure ayant tout prédisposé pour leur
commodité, ils jugent des choses à partir d'une nécessité dont ils ne sont que
partiellement conscients.
Ils ont
en effet conscience de désirer ce qui leur est
utile, mais ignorent les causes qui déterminent ce désir.
En effet, ils imputent à
la liberté de la volonté
le choix de l'objet de leur désir ; et ils ne connaissent ni
la cause de leur Affect de Joie ou de Tristesse, ni la nature véritable de leur
conatus, lui qui est expression déterminée de la puissance de Dieu, et partant
puissance d'affirmation à travers ce qui
le réjouit, et puissance de résistance à
tout ce qui l'attriste.
Autrement dit, ils croient agir
en vue d'une fin librement choisie (c'est-à
dire
en vertu d'une cause finale), et jugent autrui à partir de cette disposition :
quel est son
but? quel intérêt poursuit-il ? quelle serait notre intention si nous
étions
à sa place ? Ils estiment alors bonne ou mauvaise la volonté d'autrui
selon qu'elle est
ou non conforme à leurs valeurs.
C'est à partir de leur propre
caractère, ou complexion affective
(ingenium), qu'ils évaluent le caractère
d'autrui.
Or, ce transfert affectif peut s'opérer sur une puissance surnaturelle
lorsqu'ils observent la Nature, et jugent qu'elle est bien faite : puisque des
moyens naturels existent pour satisfaire leurs désirs, ils estiment que des
« recteurs de la nature» ont eu la volonté de les aider (si leurs désirs sont
contrariés, c'est qu'ils ont voulu les punir).
De cette conception
anthropomorphique du divin naissent les religions : interdits, obligations,
'
cultes divers qui se forment à partir de l'ingenium particulier des individus et
des peuples, afin de célébrer les puissances bénéfiques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote, Éthique à Nicomaque (extrait) - anthologie.
- ÉTHIQUE À EUDÈME, Aristote
- ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote
- ÉTHIQUE A EUDÈME d’Aristote
- Le texte que nous allons étudier est un extrait du Livre X de l’Ethique à Nicomaque, écrit par le philosophe Aristote vers 335 avant J-C.