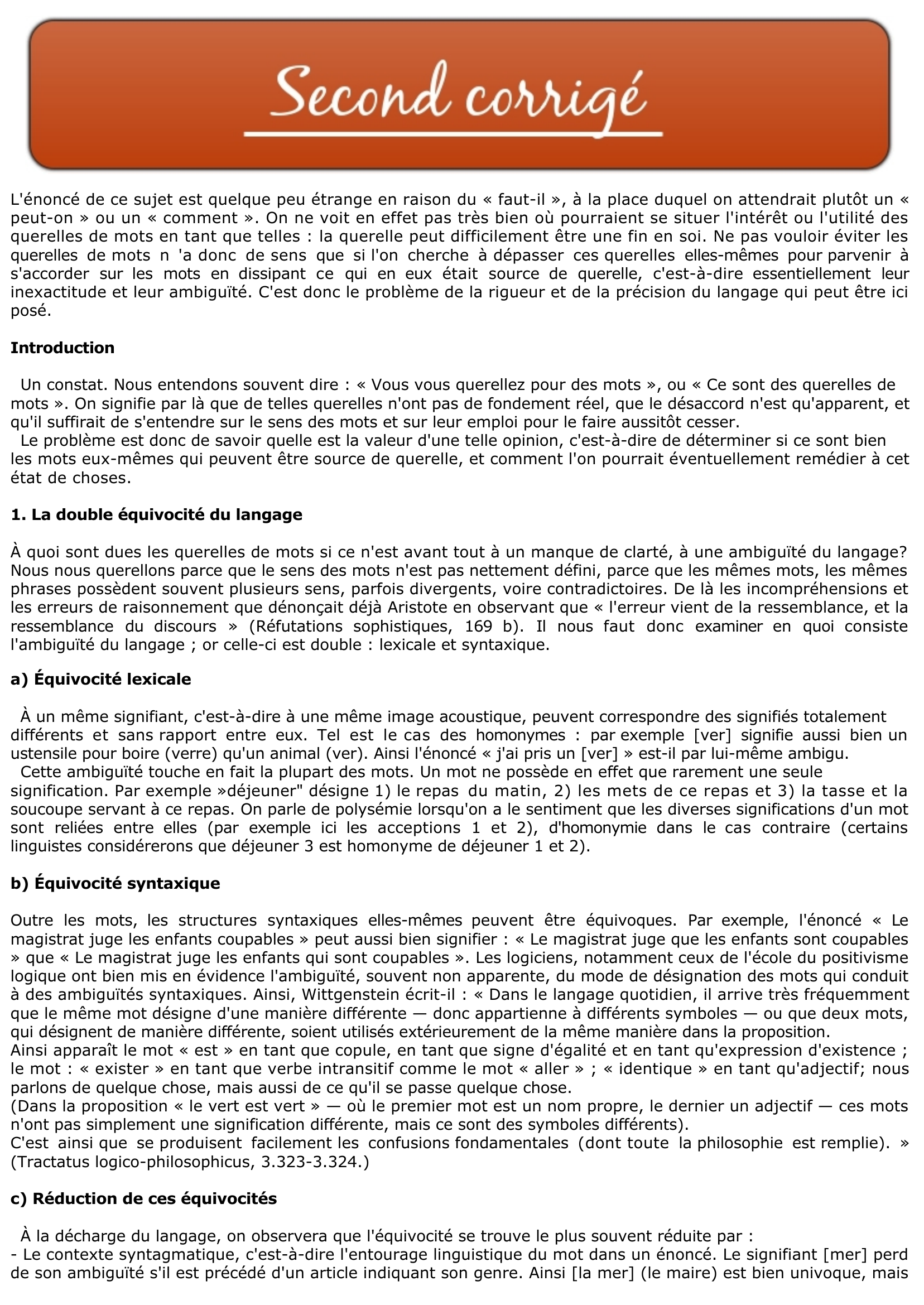Faut-il éviter les querelles de mots ?
Publié le 13/03/2004

Extrait du document
- I) Maintes querelles qui se croient d'idées ne sont que des mots.
- II) Les querelles de mots sont utiles.
«
L'énoncé de ce sujet est quelque peu étrange en raison du « faut-il », à la place duquel on attendrait plutôt un «peut-on » ou un « comment ».
On ne voit en effet pas très bien où pourraient se situer l'intérêt ou l'utilité desquerelles de mots en tant que telles : la querelle peut difficilement être une fin en soi.
Ne pas vouloir éviter lesquerelles de mots n 'a donc de sens que si l'on cherche à dépasser ces querelles elles-mêmes pour parvenir às'accorder sur les mots en dissipant ce qui en eux était source de querelle, c'est-à-dire essentiellement leurinexactitude et leur ambiguïté.
C'est donc le problème de la rigueur et de la précision du langage qui peut être iciposé.
Introduction
Un constat.
Nous entendons souvent dire : « Vous vous querellez pour des mots », ou « Ce sont des querelles demots ».
On signifie par là que de telles querelles n'ont pas de fondement réel, que le désaccord n'est qu'apparent, etqu'il suffirait de s'entendre sur le sens des mots et sur leur emploi pour le faire aussitôt cesser.
Le problème est donc de savoir quelle est la valeur d'une telle opinion, c'est-à-dire de déterminer si ce sont bienles mots eux-mêmes qui peuvent être source de querelle, et comment l'on pourrait éventuellement remédier à cetétat de choses.
1.
La double équivocité du langage
À quoi sont dues les querelles de mots si ce n'est avant tout à un manque de clarté, à une ambiguïté du langage?Nous nous querellons parce que le sens des mots n'est pas nettement défini, parce que les mêmes mots, les mêmesphrases possèdent souvent plusieurs sens, parfois divergents, voire contradictoires.
De là les incompréhensions etles erreurs de raisonnement que dénonçait déjà Aristote en observant que « l'erreur vient de la ressemblance, et laressemblance du discours » (Réfutations sophistiques, 169 b).
Il nous faut donc examiner en quoi consistel'ambiguïté du langage ; or celle-ci est double : lexicale et syntaxique.
a) Équivocité lexicale
À un même signifiant, c'est-à-dire à une même image acoustique, peuvent correspondre des signifiés totalementdifférents et sans rapport entre eux.
Tel est le cas des homonymes : par exemple [ver] signifie aussi bien unustensile pour boire (verre) qu'un animal (ver).
Ainsi l'énoncé « j'ai pris un [ver] » est-il par lui-même ambigu.
Cette ambiguïté touche en fait la plupart des mots.
Un mot ne possède en effet que rarement une seulesignification.
Par exemple »déjeuner" désigne 1) le repas du matin, 2) les mets de ce repas et 3) la tasse et lasoucoupe servant à ce repas.
On parle de polysémie lorsqu'on a le sentiment que les diverses significations d'un motsont reliées entre elles (par exemple ici les acceptions 1 et 2), d'homonymie dans le cas contraire (certainslinguistes considérerons que déjeuner 3 est homonyme de déjeuner 1 et 2).
b) Équivocité syntaxique
Outre les mots, les structures syntaxiques elles-mêmes peuvent être équivoques.
Par exemple, l'énoncé « Lemagistrat juge les enfants coupables » peut aussi bien signifier : « Le magistrat juge que les enfants sont coupables» que « Le magistrat juge les enfants qui sont coupables ».
Les logiciens, notamment ceux de l'école du positivismelogique ont bien mis en évidence l'ambiguïté, souvent non apparente, du mode de désignation des mots qui conduità des ambiguïtés syntaxiques.
Ainsi, Wittgenstein écrit-il : « Dans le langage quotidien, il arrive très fréquemmentque le même mot désigne d'une manière différente — donc appartienne à différents symboles — ou que deux mots,qui désignent de manière différente, soient utilisés extérieurement de la même manière dans la proposition.Ainsi apparaît le mot « est » en tant que copule, en tant que signe d'égalité et en tant qu'expression d'existence ;le mot : « exister » en tant que verbe intransitif comme le mot « aller » ; « identique » en tant qu'adjectif; nousparlons de quelque chose, mais aussi de ce qu'il se passe quelque chose.(Dans la proposition « le vert est vert » — où le premier mot est un nom propre, le dernier un adjectif — ces motsn'ont pas simplement une signification différente, mais ce sont des symboles différents).C'est ainsi que se produisent facilement les confusions fondamentales (dont toute la philosophie est remplie).
»(Tractatus logico-philosophicus, 3.323-3.324.)
c) Réduction de ces équivocités
À la décharge du langage, on observera que l'équivocité se trouve le plus souvent réduite par :- Le contexte syntagmatique, c'est-à-dire l'entourage linguistique du mot dans un énoncé.
Le signifiant [mer] perdde son ambiguïté s'il est précédé d'un article indiquant son genre.
Ainsi [la mer] (le maire) est bien univoque, mais.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FAUT-IL ÉVITER LES QUERELLES DE MOTS ?
- Faut-il éviter les querelles de mots ?
- Faut-il éviter les querelles de mots ?
- Faut-il éviter les querelles de mots ?
- Les querelles de mots sont elle futile ?