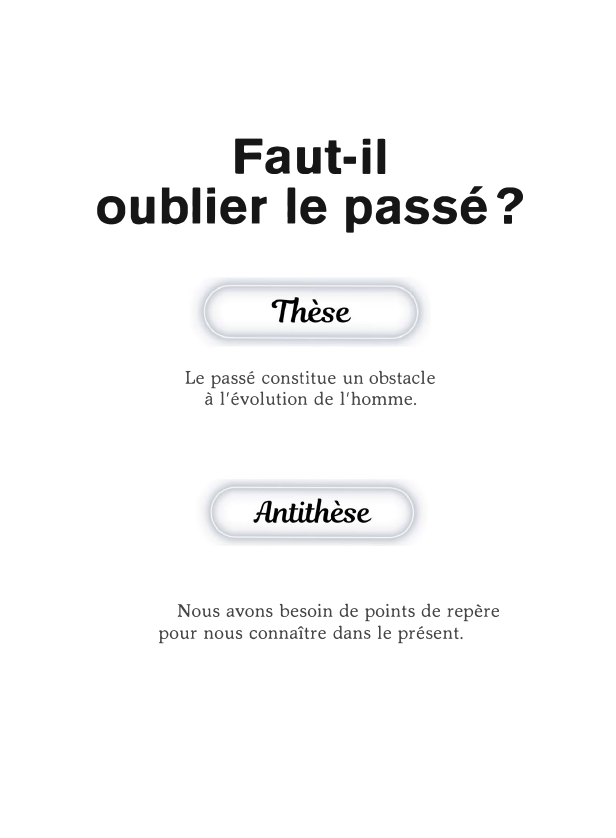Faut-il rompre avec le passé ?
Publié le 17/10/2011

Extrait du document
Qu’y a-t-il de plus intangible, de plus immatériel que le temps ? Longtemps divisé en trois entités (le passé, le présent, et le futur) le temps et son écoulement n’ont cessé d’animer chez l’homme des sentiments de terreur et d’angoisse. Si le futur demeure inconnu, fruit d’un présent que l’on construit et reconstruit sans cesse ; le passé, en revanche, est immuable et figé, et influence de manière importante les deux autres « modes «. La fuite inlassable du temps, ainsi que l’impact terrible de son écoulement est lamenté depuis la nuit des temps par les artistes, et les représentations du temps nous échappant inondent les pages des livres d’histoire de l’art et rares sont les œuvres qui dépeignent de façon élégiaque cette fuite et cette perte (la souffrance et la mélancolie étant les maîtres-mots des œuvres romantiques). Pourtant, cette quasi-condamnation à être enchaîné à un passé qui ne dépend pas toujours de nous ne comporterait-elle pas une dimension tragique ? N’y aurait-il pas un côté autodestructeur à tout cela ? La solution logique à ce problème serait donc de briser tout lien nous unissant à notre passé, afin de pouvoir aller de l’avant, sans être freinés par des souvenirs immatériels qui, bien que perdurant uniquement dans notre mémoire, nous parlent sans cesse. Cette scission avec notre anamnèse nous rendrait plus libres, car elle nous détacherait de nos « déterminismes «. Pourtant, l’histoire est le propre de l’homme, et rompre avec elle reviendrait à perdre l’un de nos plus importants constituants, menant par conséquent à une perte d’identité conséquente. Plutôt que la quête sans fin d’un divorce avec notre mémoire, l’on devrait tenter de réunir notre passé, présent, et futur, tous intimement liés.
«
Il est presque naturel que notre impossibilité d'émanciper notre présent de notre passé implique une difficulté à fairede même pour notre futur.
Le poids des souvenirs rend inaccessible à l'homme une quelconque évolution.
« L'enfer,c'est les autres » , cette phrase de Sartre, vivement controversée, traduit la médiation des autres dans laperception de la vie .
A travers le regard des autres nous prenons conscience de nous même, de notre triste réalitéhumaine, mais l'intervention de ceux-ci reste une condition sine qua non à la réalisation de l'être.
Dans Gatsby leMagnifique de F.
Scott Fitzgerald, le personnage éponyme ne parvient pas à se défaire de son passé, et tente toutau long de l'œuvre de recréer la magie de l'amour qu'il partageait avec Daisy.
Cette obsession pour le passé mèneéventuellement à sa mort, détruisant tout futur qu'il aurait pu avoir.
S'attacher au passé affecte donc notre présentmais aussi le futur, et notre désir de couper tout lien avec lui est donc entièrement légitime et justifiée.
Décider de rompre avec notre passé est donc une action brutale, certes, mais libératrice, qui nous permettraitd'aller de l'avant et d'évoluer.
Néanmoins, un acte tel ne reviendrait-il pas à remettre en question notre humanité,et d'effacer ce qui nous caractérise, ce qui nous rend humains ?La frontière entre l'homme et l'animal à longtemps été disputée, et l'on pourrait inclure l'historicité parmi les pierresconstituant le mur qui les sépare.
Bien sur, il existe certaines espèces d'animaux dont les capacités mémoriellessurpassent la moyenne, comme le dauphin et le chien, cependant, l'homme demeure la seule espèce animale ayantles moyens de conserver des archives des milliers d'années de son histoire, de préserver des documents retraçantles grands évènements ayant affecté ses semblables.
L'homme peut, avec du recul, observer son passé, et en tirerdu savoir.
La crise économique de 2010, par exemple, a eu un effet bien moindre que celui qu'il aurait pu avoir,grâce aux contre-mesures élaborés à partir du modèle du crash de Wall Street de 1929.
D'un point de vuepersonnelle, notre jeunesse affecte notre âge adulte.
Pour Freud, les traumatismes liés à l'enfance façonnentl'adulte ainsi que son rapport au monde.
Une personne ayant manqué de se noyer lorsqu'elle était petite seraitprédisposé à développer une hydrophobie, par exemple.
Notre mémoire et notre passé sont donc des composantsindispensables à notre humanité, à notre individualité, même, et s'en défaire reviendrait à exciser une partie denous.
En quelque sorte, notre histoire constitue les fondations sur lesquelles l'on se construit ; enlever le support denotre humanité s'assimilerait donc à un acte d'autodestruction, à un effondrement de notre identité.
Parmi lespersonnes au passé supprimé, l'on peut compter les enfants des personnes victimes de disparition forcée (lesdesaparecidos) qui ont été secrètement arrêtées et tuées en Argentine pendant la "guerre sale".
Ces enfants neconnaissent ni leur pères, ni leurs mères, ne connaissent non plus leur nom de famille, ni même leur village d'origine.Est-il donc souhaitable de se séparer de son passé ? Certes, cela soulagerait d'un poids immense.
Cependant, le prixd'une identité disparue en vaut-il la peine"Certaines personnes affirmeront que notre passé n'a pas la moindre incidence sur notre « moi » du passé, et qu'iln'affecte en rien les « moi » de notre passé et de notre futur.
Par contre, cette affirmation sous-entendrait quenotre « moi » de chaque mode temporel serait dissemblable des autres.
Cependant, il serait difficile d'imaginer lapossibilité selon laquelle on serait un être complètement différent : nous avons une personnalité fixe, des humeursqui nous sont particulières ; certes l'on peut changer, mais suggérer une sorte de métamorphose complète de notre« moi » serait difficile a imaginer.
Bien que nous existons dans de différentes conditions physiques et mentales dansnotre passé, présent, et futur, il existe un « moi » absolu et immuable qui nous constitue de manière fondamentale.Le philosophe Henri Bergson explique les deux influences que subit notre « moi », d'une part, il y a l'aspect génétiquede notre caractère, de l'autre, ce qu'il appelle la « courbure d'âme originelle », ou la part minime de changementsqu'on peut y apporter : « que sommes-nous, en effet, qu'est-ce que notre caractère sinon la condensation del'histoire que nous avons vécue depuis notre naissance, avant notre naissance même, puisque nous apportons avecnous des dispositions prénatales ? Sans doute nous ne pensons qu'avec une partie de notre passé ; mais c'est avecnotre passé tout entier, y compris notre courbure d'âme originelle, que nous désirons, voulons, agissons.
».
Déciderde rompre avec notre passé ne serait donc rien de moins qu'un attentat envers nous-mêmes, qui aurait pourconséquence d'éroder notre « moi » intemporelle, ce fil raccordant nos trois divisions du temps.
Nous ne pouvons « être » sans notre passé, car celui-ci agit à l'image des fondations d'une batisse : c'est ce quinous offre une structure, un squelette identitaire avec lequel aborder le monde.
Les trois divisions du temps sontinterdépendantes, et la suppression de l'une entraine la suppression des deux autres, ainsi que du sens del'existence et de la conception du « temps ».
Sans passé, il n'y aurait ni présent, ni futur.
Sans présent, le passéperdrait son sens, et le futur s'évaporerait.
Enfin, sans futur, il n'y aurait nul besoin de passé, et encore moins d'unprésent.
Ces trois modes temporelles se mélangent, s'unissent et se mêlent, et l'apparente importance du passé s‘explique grâce à la l'inhabilité de l'homme de clairement distinguer le passé, le présent et le futur.
Tenter d'oublierou effacer le passé est donc vain.
L'emprise de l'homme sur le temps est trop faible, et nous ne pouvons toutsimplement pas rompre avec le passé, qu'on le veuille ou non.
L'homme est donc condamné à être enchainé à son passé.
Il est donc à nous de trouver un moyen de l'apprivoiser,de vivre avec le passé et non pas malgré le passé.
En cela, ce qui pouvait autrefois apparaître comme un fardeaudevient en réalité une richesse.Nous développons sans cesse de nouveau moyens physiques de capturer l'instant présent.
Auparavant, l'on faisaitappel aux peintures ou aux sculptures, de nos jours, vidéos et photographies permettent cela avec une rapiditéépoustouflante.
Ce désir de créer un témoignage tangible d'un instant est la conséquence de notre incapacité àfaire cela naturellement.
En tant qu'hommes, seuls les souvenirs témoignent d'un instant précis, mais ces images, etsensations mentales ne sont guère transmissibles.
A l'inverse d'une photographie, le passé qu'enregistre nosmémoires n'es pas un passé objectif et total.
Il est physiquement impossible de se souvenir de chaque détail dechaque instant auxquels nous sommes témoins, et certaines expériences, douloureuses ou magnifiques peuvent êtrehyperbolisées.
Aux yeux de Saint Augustin, nos souvenirs ne sont que le fruit de ce qui « sort de la mémoire », de «.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il rompre avec le passé ?
- Faut-il rompre avec l'héritage de mai 1968 ? (Philosophie et Religion)
- Faut-il rompre avec le passé ?
- Faut-il rompre avec le passé ?
- Si l'intelligence menace ... de rompre sur certains points la cohésion sociale, et si la société doit subsister, il faut que, sur ces points, il y ait à l'intelligence un contre poids. Ainsi s'expliquerait la fonction fabulatrice. Bergson, Les deux sources de la morale et de la Religion, PUF, page 124. Commentez cette citation.