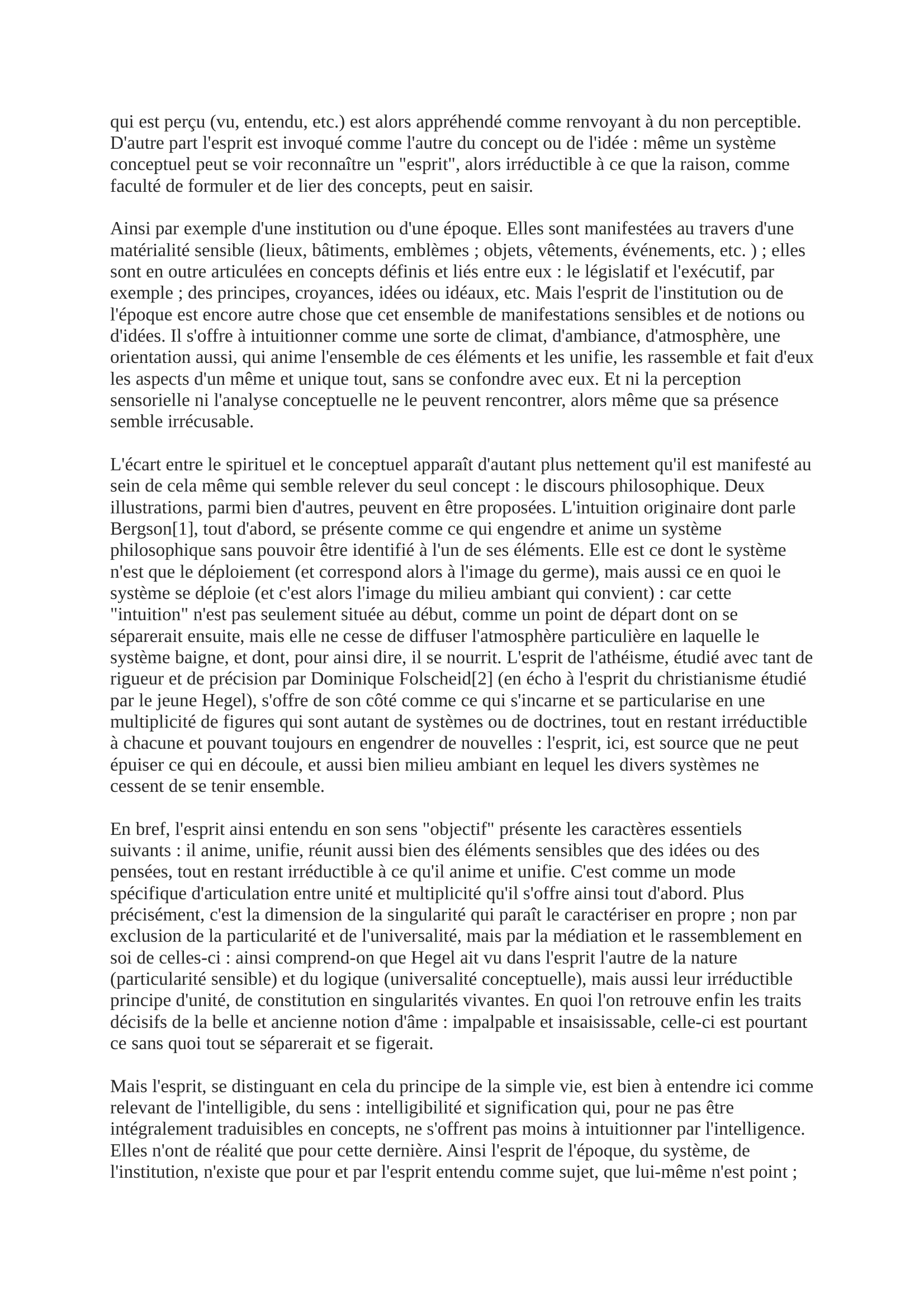la matière et l'esprit
Publié le 07/12/2012

Extrait du document


«
qui est perçu (vu, entendu, etc.) est alors appréhendé comme renvoyant à du non perceptible.
D'autre part l'esprit est invoqué comme l'autre du concept ou de l'idée : même un système
conceptuel peut se voir reconnaître un "esprit", alors irréductible à ce que la raison, comme
faculté de formuler et de lier des concepts, peut en saisir.
Ainsi par exemple d'une institution ou d'une époque.
Elles sont manifestées au travers d'une
matérialité sensible (lieux, bâtiments, emblèmes ; objets, vêtements, événements, etc.
) ; elles
sont en outre articulées en concepts définis et liés entre eux : le législatif et l'exécutif, par
exemple ; des principes, croyances, idées ou idéaux, etc.
Mais l'esprit de l'institution ou de
l'époque est encore autre chose que cet ensemble de manifestations sensibles et de notions ou
d'idées.
Il s'offre à intuitionner comme une sorte de climat, d'ambiance, d'atmosphère, une
orientation aussi, qui anime l'ensemble de ces éléments et les unifie, les rassemble et fait d'eux
les aspects d'un même et unique tout, sans se confondre avec eux.
Et ni la perception
sensorielle ni l'analyse conceptuelle ne le peuvent rencontrer, alors même que sa présence
semble irrécusable.
L'écart entre le spirituel et le conceptuel apparaît d'autant plus nettement qu'il est manifesté au
sein de cela même qui semble relever du seul concept : le discours philosophique.
Deux
illustrations, parmi bien d'autres, peuvent en être proposées.
L'intuition originaire dont parle
Bergson[1], tout d'abord, se présente comme ce qui engendre et anime un système
philosophique sans pouvoir être identifié à l'un de ses éléments.
Elle est ce dont le système
n'est que le déploiement (et correspond alors à l'image du germe), mais aussi ce en quoi le
système se déploie (et c'est alors l'image du milieu ambiant qui convient) : car cette
"intuition" n'est pas seulement située au début, comme un point de départ dont on se
séparerait ensuite, mais elle ne cesse de diffuser l'atmosphère particulière en laquelle le
système baigne, et dont, pour ainsi dire, il se nourrit.
L'esprit de l'athéisme, étudié avec tant de
rigueur et de précision par Dominique Folscheid[2] (en écho à l'esprit du christianisme étudié
par le jeune Hegel), s'offre de son côté comme ce qui s'incarne et se particularise en une
multiplicité de figures qui sont autant de systèmes ou de doctrines, tout en restant irréductible
à chacune et pouvant toujours en engendrer de nouvelles : l'esprit, ici, est source que ne peut
épuiser ce qui en découle, et aussi bien milieu ambiant en lequel les divers systèmes ne
cessent de se tenir ensemble.
En bref, l'esprit ainsi entendu en son sens "objectif" présente les caractères essentiels
suivants : il anime, unifie, réunit aussi bien des éléments sensibles que des idées ou des
pensées, tout en restant irréductible à ce qu'il anime et unifie.
C'est comme un mode
spécifique d'articulation entre unité et multiplicité qu'il s'offre ainsi tout d'abord.
Plus
précisément, c'est la dimension de la singularité qui paraît le caractériser en propre ; non par
exclusion de la particularité et de l'universalité, mais par la médiation et le rassemblement en
soi de celles-ci : ainsi comprend-on que Hegel ait vu dans l'esprit l'autre de la nature
(particularité sensible) et du logique (universalité conceptuelle), mais aussi leur irréductible
principe d'unité, de constitution en singularités vivantes.
En quoi l'on retrouve enfin les traits
décisifs de la belle et ancienne notion d'âme : impalpable et insaisissable, celle-ci est pourtant
ce sans quoi tout se séparerait et se figerait.
Mais l'esprit, se distinguant en cela du principe de la simple vie, est bien à entendre ici comme
relevant de l'intelligible, du sens : intelligibilité et signification qui, pour ne pas être
intégralement traduisibles en concepts, ne s'offrent pas moins à intuitionner par l'intelligence.
Elles n'ont de réalité que pour cette dernière.
Ainsi l'esprit de l'époque, du système, de
l'institution, n'existe que pour et par l'esprit entendu comme sujet, que lui-même n'est point ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MATIÈRE ET MÉMOIRE, Essai sur la relation du corps à l’esprit d’Henri Bergson (résumé)
- > Peut-on réduire l’esprit à la matière ?
- La matière s oppose-t-elle radicalement à l esprit?
- Gaston BACHELARD, Le Matérialisme rationnel. LA MATIÈRE ET L'ESPRIT
- L'homme est-il à la fois matière et esprit ?