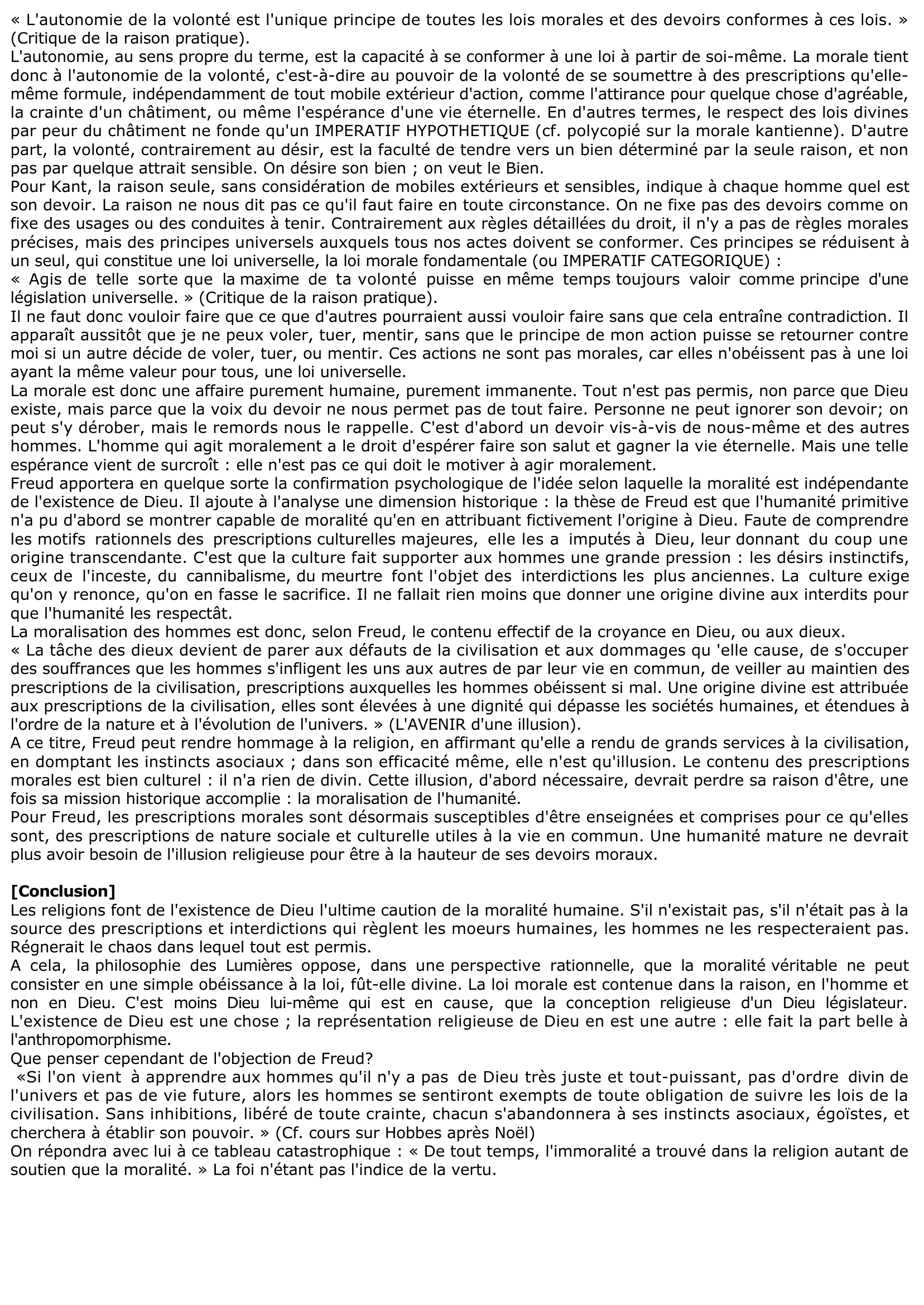La morale peut- elle etre athée ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document


«
« L'autonomie de la volonté est l'unique principe de toutes les lois morales et des devoirs conformes à ces lois.
»(Critique de la raison pratique).L'autonomie, au sens propre du terme, est la capacité à se conformer à une loi à partir de soi-même.
La morale tientdonc à l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire au pouvoir de la volonté de se soumettre à des prescriptions qu'elle-même formule, indépendamment de tout mobile extérieur d'action, comme l'attirance pour quelque chose d'agréable,la crainte d'un châtiment, ou même l'espérance d'une vie éternelle.
En d'autres termes, le respect des lois divinespar peur du châtiment ne fonde qu'un IMPERATIF HYPOTHETIQUE (cf.
polycopié sur la morale kantienne).
D'autrepart, la volonté, contrairement au désir, est la faculté de tendre vers un bien déterminé par la seule raison, et nonpas par quelque attrait sensible.
On désire son bien ; on veut le Bien.Pour Kant, la raison seule, sans considération de mobiles extérieurs et sensibles, indique à chaque homme quel estson devoir.
La raison ne nous dit pas ce qu'il faut faire en toute circonstance.
On ne fixe pas des devoirs comme onfixe des usages ou des conduites à tenir.
Contrairement aux règles détaillées du droit, il n'y a pas de règles moralesprécises, mais des principes universels auxquels tous nos actes doivent se conformer.
Ces principes se réduisent àun seul, qui constitue une loi universelle, la loi morale fondamentale (ou IMPERATIF CATEGORIQUE) :« Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps toujours valoir comme principe d'unelégislation universelle.
» (Critique de la raison pratique).Il ne faut donc vouloir faire que ce que d'autres pourraient aussi vouloir faire sans que cela entraîne contradiction.
Ilapparaît aussitôt que je ne peux voler, tuer, mentir, sans que le principe de mon action puisse se retourner contremoi si un autre décide de voler, tuer, ou mentir.
Ces actions ne sont pas morales, car elles n'obéissent pas à une loiayant la même valeur pour tous, une loi universelle.La morale est donc une affaire purement humaine, purement immanente.
Tout n'est pas permis, non parce que Dieuexiste, mais parce que la voix du devoir ne nous permet pas de tout faire.
Personne ne peut ignorer son devoir; onpeut s'y dérober, mais le remords nous le rappelle.
C'est d'abord un devoir vis-à-vis de nous-même et des autreshommes.
L'homme qui agit moralement a le droit d'espérer faire son salut et gagner la vie éternelle.
Mais une telleespérance vient de surcroît : elle n'est pas ce qui doit le motiver à agir moralement.Freud apportera en quelque sorte la confirmation psychologique de l'idée selon laquelle la moralité est indépendantede l'existence de Dieu.
Il ajoute à l'analyse une dimension historique : la thèse de Freud est que l'humanité primitiven'a pu d'abord se montrer capable de moralité qu'en en attribuant fictivement l'origine à Dieu.
Faute de comprendreles motifs rationnels des prescriptions culturelles majeures, elle les a imputés à Dieu, leur donnant du coup uneorigine transcendante.
C'est que la culture fait supporter aux hommes une grande pression : les désirs instinctifs,ceux de l'inceste, du cannibalisme, du meurtre font l'objet des interdictions les plus anciennes.
La culture exigequ'on y renonce, qu'on en fasse le sacrifice.
Il ne fallait rien moins que donner une origine divine aux interdits pourque l'humanité les respectât.La moralisation des hommes est donc, selon Freud, le contenu effectif de la croyance en Dieu, ou aux dieux.« La tâche des dieux devient de parer aux défauts de la civilisation et aux dommages qu 'elle cause, de s'occuperdes souffrances que les hommes s'infligent les uns aux autres de par leur vie en commun, de veiller au maintien desprescriptions de la civilisation, prescriptions auxquelles les hommes obéissent si mal.
Une origine divine est attribuéeaux prescriptions de la civilisation, elles sont élevées à une dignité qui dépasse les sociétés humaines, et étendues àl'ordre de la nature et à l'évolution de l'univers.
» (L'AVENIR d'une illusion).A ce titre, Freud peut rendre hommage à la religion, en affirmant qu'elle a rendu de grands services à la civilisation,en domptant les instincts asociaux ; dans son efficacité même, elle n'est qu'illusion.
Le contenu des prescriptionsmorales est bien culturel : il n'a rien de divin.
Cette illusion, d'abord nécessaire, devrait perdre sa raison d'être, unefois sa mission historique accomplie : la moralisation de l'humanité.Pour Freud, les prescriptions morales sont désormais susceptibles d'être enseignées et comprises pour ce qu'ellessont, des prescriptions de nature sociale et culturelle utiles à la vie en commun.
Une humanité mature ne devraitplus avoir besoin de l'illusion religieuse pour être à la hauteur de ses devoirs moraux.
[Conclusion]Les religions font de l'existence de Dieu l'ultime caution de la moralité humaine.
S'il n'existait pas, s'il n'était pas à lasource des prescriptions et interdictions qui règlent les moeurs humaines, les hommes ne les respecteraient pas.Régnerait le chaos dans lequel tout est permis.A cela, la philosophie des Lumières oppose, dans une perspective rationnelle, que la moralité véritable ne peutconsister en une simple obéissance à la loi, fût-elle divine.
La loi morale est contenue dans la raison, en l'homme etnon en Dieu.
C'est moins Dieu lui-même qui est en cause, que la conception religieuse d'un Dieu législateur.L'existence de Dieu est une chose ; la représentation religieuse de Dieu en est une autre : elle fait la part belle àl'anthropomorphisme.Que penser cependant de l'objection de Freud? «Si l'on vient à apprendre aux hommes qu'il n'y a pas de Dieu très juste et tout-puissant, pas d'ordre divin del'univers et pas de vie future, alors les hommes se sentiront exempts de toute obligation de suivre les lois de lacivilisation.
Sans inhibitions, libéré de toute crainte, chacun s'abandonnera à ses instincts asociaux, égoïstes, etcherchera à établir son pouvoir.
» (Cf.
cours sur Hobbes après Noël)On répondra avec lui à ce tableau catastrophique : « De tout temps, l'immoralité a trouvé dans la religion autant desoutien que la moralité.
» La foi n'étant pas l'indice de la vertu..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La morale et l'amour, un mariage impossible avec le roman le diable au corps de raymond radiguet
- La morale de Sartre
- La réflexion sur la morale
- La morale peut-elle s’enseigner ?
- la société et la morale du temps du personnage romanesque doivent-elles être en confrontation avec ce dernier afin de captiver le lecteur ?