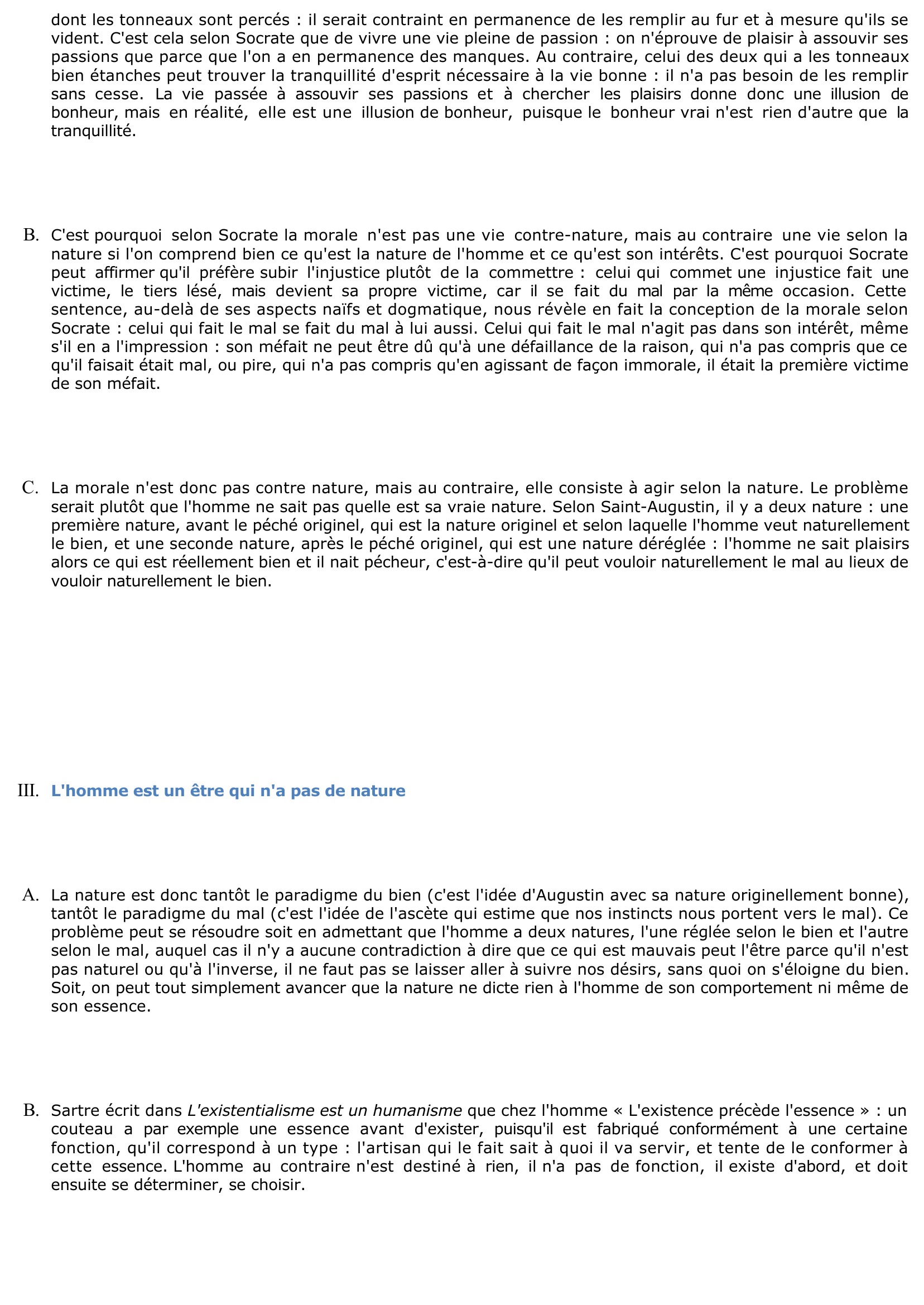La moralité est-elle contre-nature ?
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
dont les tonneaux sont percés : il serait contraint en permanence de les remplir au fur et à mesure qu'ils sevident.
C'est cela selon Socrate que de vivre une vie pleine de passion : on n'éprouve de plaisir à assouvir sespassions que parce que l'on a en permanence des manques.
Au contraire, celui des deux qui a les tonneauxbien étanches peut trouver la tranquillité d'esprit nécessaire à la vie bonne : il n'a pas besoin de les remplirsans cesse.
La vie passée à assouvir ses passions et à chercher les plaisirs donne donc une illusion debonheur, mais en réalité, elle est une illusion de bonheur, puisque le bonheur vrai n'est rien d'autre que latranquillité.
A.
C'est pourquoi selon Socrate la morale n'est pas une vie contre-nature, mais au contraire une vie selon lanature si l'on comprend bien ce qu'est la nature de l'homme et ce qu'est son intérêts.
C'est pourquoi Socratepeut affirmer qu'il préfère subir l'injustice plutôt de la commettre : celui qui commet une injustice fait unevictime, le tiers lésé, mais devient sa propre victime, car il se fait du mal par la même occasion.
Cettesentence, au-delà de ses aspects naïfs et dogmatique, nous révèle en fait la conception de la morale selonSocrate : celui qui fait le mal se fait du mal à lui aussi.
Celui qui fait le mal n'agit pas dans son intérêt, mêmes'il en a l'impression : son méfait ne peut être dû qu'à une défaillance de la raison, qui n'a pas compris que cequ'il faisait était mal, ou pire, qui n'a pas compris qu'en agissant de façon immorale, il était la première victimede son méfait.
B.
La morale n'est donc pas contre nature, mais au contraire, elle consiste à agir selon la nature.
Le problèmeserait plutôt que l'homme ne sait pas quelle est sa vraie nature.
Selon Saint-Augustin, il y a deux nature : unepremière nature, avant le péché originel, qui est la nature originel et selon laquelle l'homme veut naturellementle bien, et une seconde nature, après le péché originel, qui est une nature déréglée : l'homme ne sait plaisirsalors ce qui est réellement bien et il nait pécheur, c'est-à-dire qu'il peut vouloir naturellement le mal au lieux devouloir naturellement le bien.
C.
L'homme est un être qui n'a pas de nature III.
La nature est donc tantôt le paradigme du bien (c'est l'idée d'Augustin avec sa nature originellement bonne),tantôt le paradigme du mal (c'est l'idée de l'ascète qui estime que nos instincts nous portent vers le mal).
Ceproblème peut se résoudre soit en admettant que l'homme a deux natures, l'une réglée selon le bien et l'autreselon le mal, auquel cas il n'y a aucune contradiction à dire que ce qui est mauvais peut l'être parce qu'il n'estpas naturel ou qu'à l'inverse, il ne faut pas se laisser aller à suivre nos désirs, sans quoi on s'éloigne du bien.Soit, on peut tout simplement avancer que la nature ne dicte rien à l'homme de son comportement ni même deson essence.
A.
Sartre écrit dans L'existentialisme est un humanisme que chez l'homme « L'existence précède l'essence » : un couteau a par exemple une essence avant d'exister, puisqu'il est fabriqué conformément à une certainefonction, qu'il correspond à un type : l'artisan qui le fait sait à quoi il va servir, et tente de le conformer àcette essence.
L'homme au contraire n'est destiné à rien, il n'a pas de fonction, il existe d'abord, et doitensuite se déterminer, se choisir.
B.
C..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'éthique peut proposer des lois de moralité qui sont indulgentes et qui s'ordonnent aux faiblesses de la nature humaine, et ainsi elle s'accommode à cette nature en ne demandant rien de plus à l'homme que ce qu'il est en mesure d'accomplir.
- Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité que leur manquait auparavant.
- Rousseau, Du contrat social. "Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possibles pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter cette liberté à sa volonté .". Commentez cette citation.
- Rousseau " Conscience, conscience, conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. " (Rousseau, Émile ou De l'éducation, 1762, livre IV, GF-Flammarion, 1966, p. 378). Commentez cette citation.
- « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. » Rousseau, Émile ou De l'éducation, 1762. Commentez cette citation.