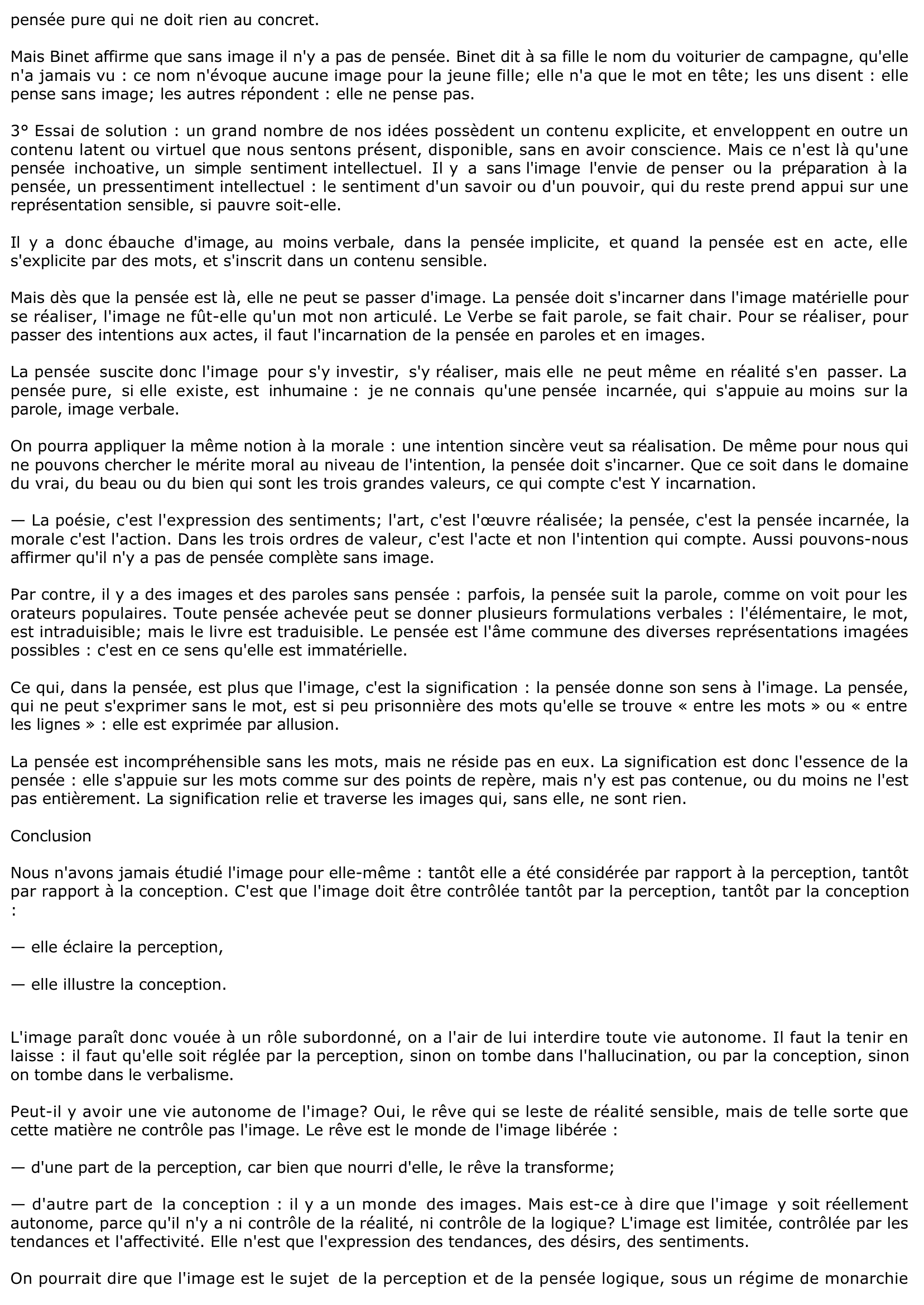LA PENSÉE ET L'IMAGE
Publié le 16/03/2011
Extrait du document
A) Les thèses empiristes 1° Certains psychologues ont voulu voir dans Vidée générale une simple image composite, comme en réalisait matériellement Galton qui superposait les photos des membres d'une même famille et obtenait ainsi le type familial, c'est parce que les caractères individuels s'annulaient et les caractères communs se renforçaient; ainsi un photographe américain obtenait le type de l'assassin en superposant des photos d'assassins. Cette explication est-elle applicable aux concepts? Elle ne le serait que pour les représentations d'objets de forme semblable, celles que Ribot appelle « les abstraits inférieurs «. Elle ne saurait expliquer les idées d'objets ayant des formes aussi diverses que les différentes espèces d'arbres, d'animaux, d'instruments. A plus forte raison ne peut-elle expliquer d'où vient l'idée de notions que les sens ne peuvent percevoir : justice, nécessité, etc...
«
pensée pure qui ne doit rien au concret.
Mais Binet affirme que sans image il n'y a pas de pensée.
Binet dit à sa fille le nom du voiturier de campagne, qu'ellen'a jamais vu : ce nom n'évoque aucune image pour la jeune fille; elle n'a que le mot en tête; les uns disent : ellepense sans image; les autres répondent : elle ne pense pas.
3° Essai de solution : un grand nombre de nos idées possèdent un contenu explicite, et enveloppent en outre uncontenu latent ou virtuel que nous sentons présent, disponible, sans en avoir conscience.
Mais ce n'est là qu'unepensée inchoative, un simple sentiment intellectuel.
Il y a sans l'image l'envie de penser ou la préparation à lapensée, un pressentiment intellectuel : le sentiment d'un savoir ou d'un pouvoir, qui du reste prend appui sur unereprésentation sensible, si pauvre soit-elle.
Il y a donc ébauche d'image, au moins verbale, dans la pensée implicite, et quand la pensée est en acte, elles'explicite par des mots, et s'inscrit dans un contenu sensible.
Mais dès que la pensée est là, elle ne peut se passer d'image.
La pensée doit s'incarner dans l'image matérielle pourse réaliser, l'image ne fût-elle qu'un mot non articulé.
Le Verbe se fait parole, se fait chair.
Pour se réaliser, pourpasser des intentions aux actes, il faut l'incarnation de la pensée en paroles et en images.
La pensée suscite donc l'image pour s'y investir, s'y réaliser, mais elle ne peut même en réalité s'en passer.
Lapensée pure, si elle existe, est inhumaine : je ne connais qu'une pensée incarnée, qui s'appuie au moins sur laparole, image verbale.
On pourra appliquer la même notion à la morale : une intention sincère veut sa réalisation.
De même pour nous quine pouvons chercher le mérite moral au niveau de l'intention, la pensée doit s'incarner.
Que ce soit dans le domainedu vrai, du beau ou du bien qui sont les trois grandes valeurs, ce qui compte c'est Y incarnation.
— La poésie, c'est l'expression des sentiments; l'art, c'est l'œuvre réalisée; la pensée, c'est la pensée incarnée, lamorale c'est l'action.
Dans les trois ordres de valeur, c'est l'acte et non l'intention qui compte.
Aussi pouvons-nousaffirmer qu'il n'y a pas de pensée complète sans image.
Par contre, il y a des images et des paroles sans pensée : parfois, la pensée suit la parole, comme on voit pour lesorateurs populaires.
Toute pensée achevée peut se donner plusieurs formulations verbales : l'élémentaire, le mot,est intraduisible; mais le livre est traduisible.
Le pensée est l'âme commune des diverses représentations imagéespossibles : c'est en ce sens qu'elle est immatérielle.
Ce qui, dans la pensée, est plus que l'image, c'est la signification : la pensée donne son sens à l'image.
La pensée,qui ne peut s'exprimer sans le mot, est si peu prisonnière des mots qu'elle se trouve « entre les mots » ou « entreles lignes » : elle est exprimée par allusion.
La pensée est incompréhensible sans les mots, mais ne réside pas en eux.
La signification est donc l'essence de lapensée : elle s'appuie sur les mots comme sur des points de repère, mais n'y est pas contenue, ou du moins ne l'estpas entièrement.
La signification relie et traverse les images qui, sans elle, ne sont rien.
Conclusion
Nous n'avons jamais étudié l'image pour elle-même : tantôt elle a été considérée par rapport à la perception, tantôtpar rapport à la conception.
C'est que l'image doit être contrôlée tantôt par la perception, tantôt par la conception:
— elle éclaire la perception,
— elle illustre la conception.
L'image paraît donc vouée à un rôle subordonné, on a l'air de lui interdire toute vie autonome.
Il faut la tenir enlaisse : il faut qu'elle soit réglée par la perception, sinon on tombe dans l'hallucination, ou par la conception, sinonon tombe dans le verbalisme.
Peut-il y avoir une vie autonome de l'image? Oui, le rêve qui se leste de réalité sensible, mais de telle sorte quecette matière ne contrôle pas l'image.
Le rêve est le monde de l'image libérée :
— d'une part de la perception, car bien que nourri d'elle, le rêve la transforme;
— d'autre part de la conception : il y a un monde des images.
Mais est-ce à dire que l'image y soit réellementautonome, parce qu'il n'y a ni contrôle de la réalité, ni contrôle de la logique? L'image est limitée, contrôlée par lestendances et l'affectivité.
Elle n'est que l'expression des tendances, des désirs, des sentiments.
On pourrait dire que l'image est le sujet de la perception et de la pensée logique, sous un régime de monarchie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le rôle de l image dans la pensée ?
- l'image d'une chose est-elle pensée de cette chose ?
- Parmi l’ensemble du corpus proposé et celui du bac blanc, le texte qui m’a semblé être le plus efficace par rapport aux autres textes, reste celui de Louis Ferdinand Céline qui expose grâce à un style d’écriture très proche de la pensée et à la fois extrêmement bien formulé, une image de la guerre critique et affreusement réel.
- «Un long avenir se préparait pour (la culture française) du XVIIe (siècle). Même encore au temps du romantisme, les œuvres classiques continuent à bénéficier d'une audience considérable ; l'époque qui les a vu naître bénéficie au premier chef du progrès des études historiques ; l'esprit qui anime ses écrivains, curiosité pour l'homme, goût d'une beauté harmonieuse et rationnelle, continue à inspirer les créatures. Avec cette esthétique une autre ne pourra véritablement entrer en concur
- Vous expliquerez et apprécierez ce parallèle entre le XVIIe siècle classique et le moyen âge : «Le XVIIe siècle - en ce qu'il a de classique - bien plus que l'introduction à la pensée scientifique, moderne et athée du XVIIIe siècle, est l'épanouissement de la pensée du moyen âge, dont il donne, sous des habits empruntés et dans une langue magnifique, une nouvelle et somptueuse image. Un homme prévenu, qui oublierait tant de poncifs et de jugements consacrés, comment ne serait-il pas fr