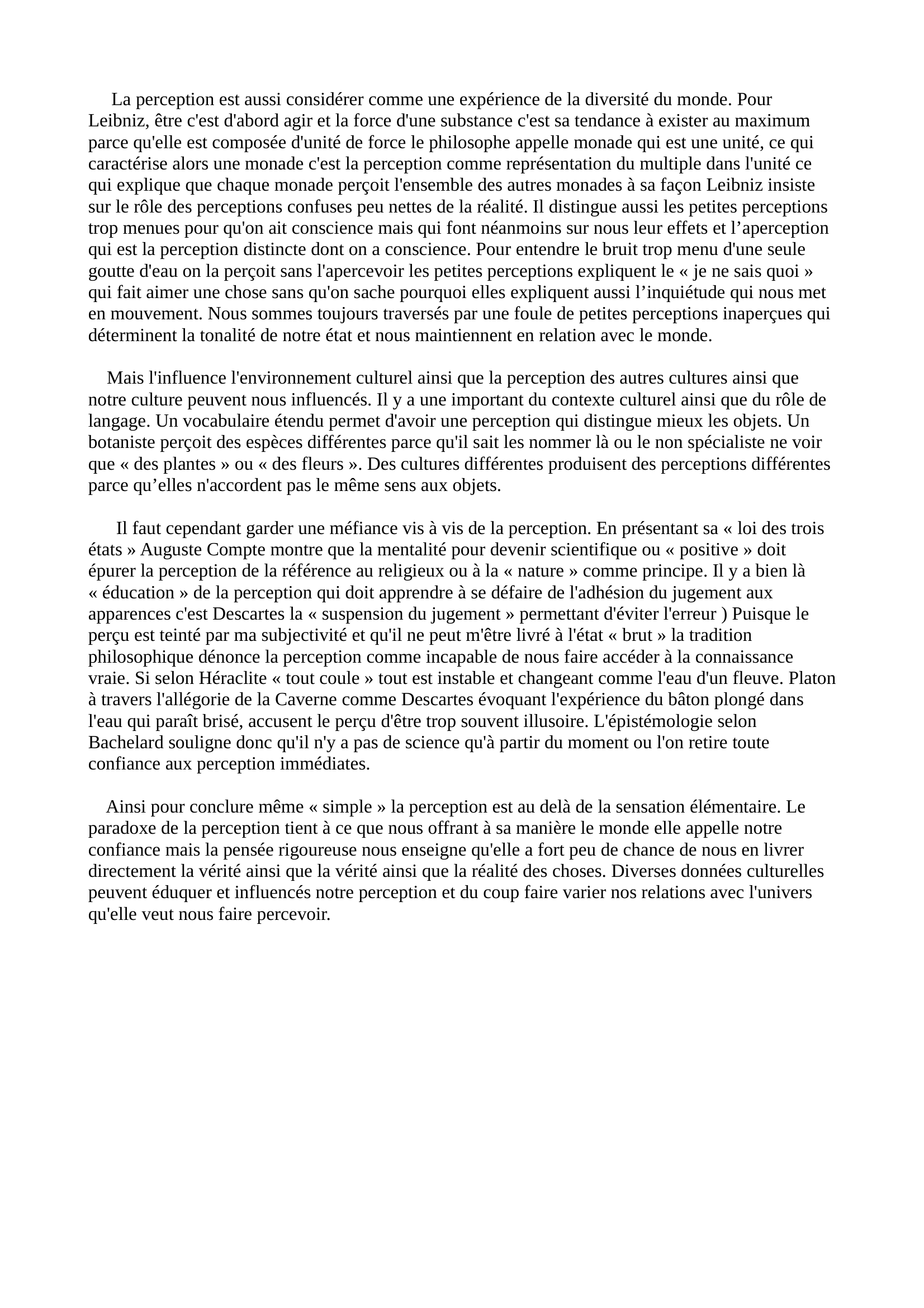La perception
Publié le 15/04/2016

Extrait du document


«
La perception est aussi considérer comme une expérience de la diversité du monde.
Pour
Leibniz, être c'est d'abord agir et la force d'une substance c'est sa tendance à exister au maximum
parce qu'elle est composée d'unité de force le philosophe appelle monade qui est une unité, ce qui
caractérise alors une monade c'est la perception comme représentation du multiple dans l'unité ce
qui explique que chaque monade perçoit l'ensemble des autres monades à sa façon Leibniz insiste
sur le rôle des perceptions confuses peu nettes de la réalité.
Il distingue aussi les petites perceptions
trop menues pour qu'on ait conscience mais qui font néanmoins sur nous leur effets et l’aperception
qui est la perception distincte dont on a conscience.
Pour entendre le bruit trop menu d'une seule
goutte d'eau on la perçoit sans l'apercevoir les petites perceptions expliquent le « je ne sais quoi »
qui fait aimer une chose sans qu'on sache pourquoi elles expliquent aussi l’inquiétude qui nous met
en mouvement.
Nous sommes toujours traversés par une foule de petites perceptions inaperçues qui
déterminent la tonalité de notre état et nous maintiennent en relation avec le monde.
Mais l'influence l'environnement culturel ainsi que la perception des autres cultures ainsi que
notre culture peuvent nous influencés.
Il y a une important du contexte culturel ainsi que du rôle de
langage.
Un vocabulaire étendu permet d'avoir une perception qui distingue mieux les objets.
Un
botaniste perçoit des espèces différentes parce qu'il sait les nommer là ou le non spécialiste ne voir
que « des plantes » ou « des fleurs ».
Des cultures différentes produisent des perceptions différentes
parce qu’elles n'accordent pas le même sens aux objets.
Il faut cependant garder une méfiance vis à vis de la perception.
En présentant sa « loi des trois
états » Auguste Compte montre que la mentalité pour devenir scientifique ou « positive » doit
épurer la perception de la référence au religieux ou à la « nature » comme principe.
Il y a bien là
« éducation » de la perception qui doit apprendre à se défaire de l'adhésion du jugement aux
apparences c'est Descartes la « suspension du jugement » permettant d'éviter l'erreur ) Puisque le
perçu est teinté par ma subjectivité et qu'il ne peut m'être livré à l'état « brut » la tradition
philosophique dénonce la perception comme incapable de nous faire accéder à la connaissance
vraie.
Si selon Héraclite « tout coule » tout est instable et changeant comme l'eau d'un fleuve.
Platon
à travers l'allégorie de la Caverne comme Descartes évoquant l'expérience du bâton plongé dans
l'eau qui paraît brisé, accusent le perçu d'être trop souvent illusoire.
L'épistémologie selon
Bachelard souligne donc qu'il n'y a pas de science qu'à partir du moment ou l'on retire toute
confiance aux perception immédiates.
Ainsi pour conclure même « simple » la perception est au delà de la sensation élémentaire.
Le
paradoxe de la perception tient à ce que nous offrant à sa manière le monde elle appelle notre
confiance mais la pensée rigoureuse nous enseigne qu'elle a fort peu de chance de nous en livrer
directement la vérité ainsi que la vérité ainsi que la réalité des choses.
Diverses données culturelles
peuvent éduquer et influencés notre perception et du coup faire varier nos relations avec l'univers
qu'elle veut nous faire percevoir..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la perception d'une beauté trop intense est-elle source de souffrance ?
- Bergson et la perception du changement
- perception - psychologie & psychanalyse.
- PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA PERCEPTION, 1945. Maurice Merleau-Ponty - résumé de l'oeuvre
- L'oeuvre d'art la perception