La Psychanalyse après Freud.
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
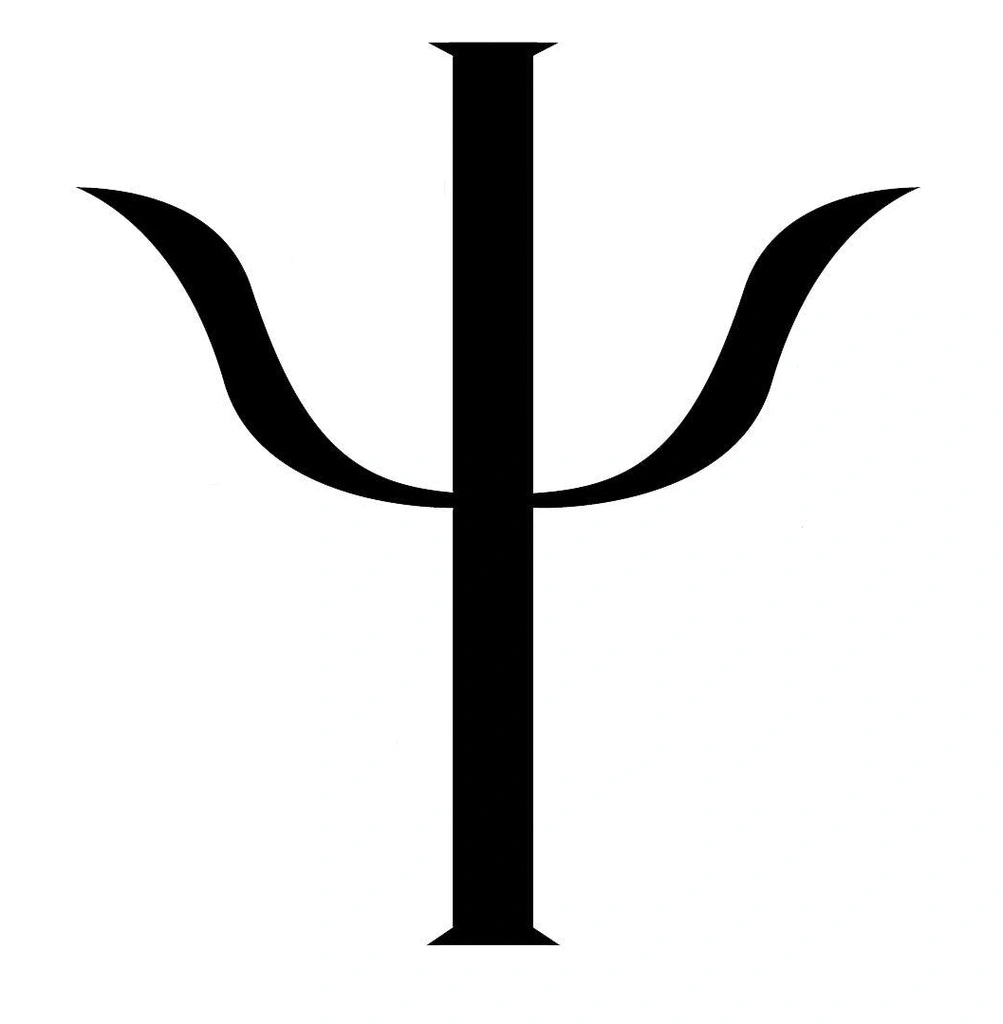
Outre les scissions évoquées (Adler rompt avec Freud en 1915, Jung avait rompu en 1911), des dissidences divisent le mouvement psychanalytique. L. Binswanger (mort en 1966) crée la Daseinsanalyse (ou analyse existentielle, mentionnée ci-dessus à propos des théories de l'inconscient), à partir de 1927, après avoir été un élève de Freud. J.-L. Moreno (connu pour être le créateur du psychodrame) abandonne la psychanalyse vers 1925, et, mettant l'accent sur la spontanéité trop étouffée par les habitudes sociales ou les contraintes culturelles, cherche les moyens de ranimer la spontanéité des individus et des groupes dits « primaires » (où l'existence en commun a créé des liens sociaux observables et où chacun connaît tous les autres) ; il est à l'origine (avec Lewin, mort à 57 ans en 1947) de la Dynamique des groupes (étude des groupes restreints et utilisation des lois de ces phénomènes pour agir sur les individus). Jacques Lacan étudie « le langage de l'inconscient ».
1 — Parmi les développements récents, signalons l'orientation politique qui se réfère à Wilhelm Reich et à Herbert Marcuse : allant jusqu'au bout de l'hypothèse freudienne, ces auteurs concluent que toute morale et toute société sont répressives et que la vraie libération, celle des instincts et spécialement de la sexualité, doit accompagner la révolution sociale (destruction de toute structure, de toute règle imposée et de toute discipline).
Parallèlement s'est développée, sous l'impulsion de psychanalystes anglais dissidents (David Cooper, 1960), une tendance connue sous le nom d'anti-psychiatrie, fondée sur 5 thèmes : 1) le fou n'est pas un malade mental, c'est celui qui n'a pas su refouler ses instincts normaux pour se conformer à une société répressive et anormale ; 2) la folie est une valeur. Le fou a « un message » à nous transmettre car il est l'auteur d'une « tentative réussie de ne pas s'adapter » (R.D. Laing) ; 3) l'institution (l'hôpital psychiatrique) et la société doivent être dénoncées comme des instances répressives dont les psychiatres ordinaires sont des complices ; 4) tous les traitements sont à proscrire ; 5) une action révolutionnaire s'impose pour casser les institutions et libérer les humains.
Dans cette perspective la notion d'adaptation est violemment attaquée ; on dénonce « le mythe de la norme » (Maud Mannoni) ; on nie l'existence de la folie (Michel Foucault) et l'on retrouve la glorification du « primitif » et du « sauvage ».
Liens utiles
- Freud : Introduction à la Psychanalyse, explication de texte
- Freud, Introduction à la psychanalyse (extrait) Au cours de l'hiver 1915-1916,
- Freud, Anna - psychologie & psychanalyse.
- Anna Freud, le Traitement psychanalytique des enfants (extrait) Fille de Sigmund Freud, Anna Freud entre à son tour dans le mouvement psychanalytique dans les années vingt par ses travaux sur la psychanalyse des enfants.
- CINQ LEÇONS SUR LA PSYCHANALYSE,Sigmund Freud (résumé)































