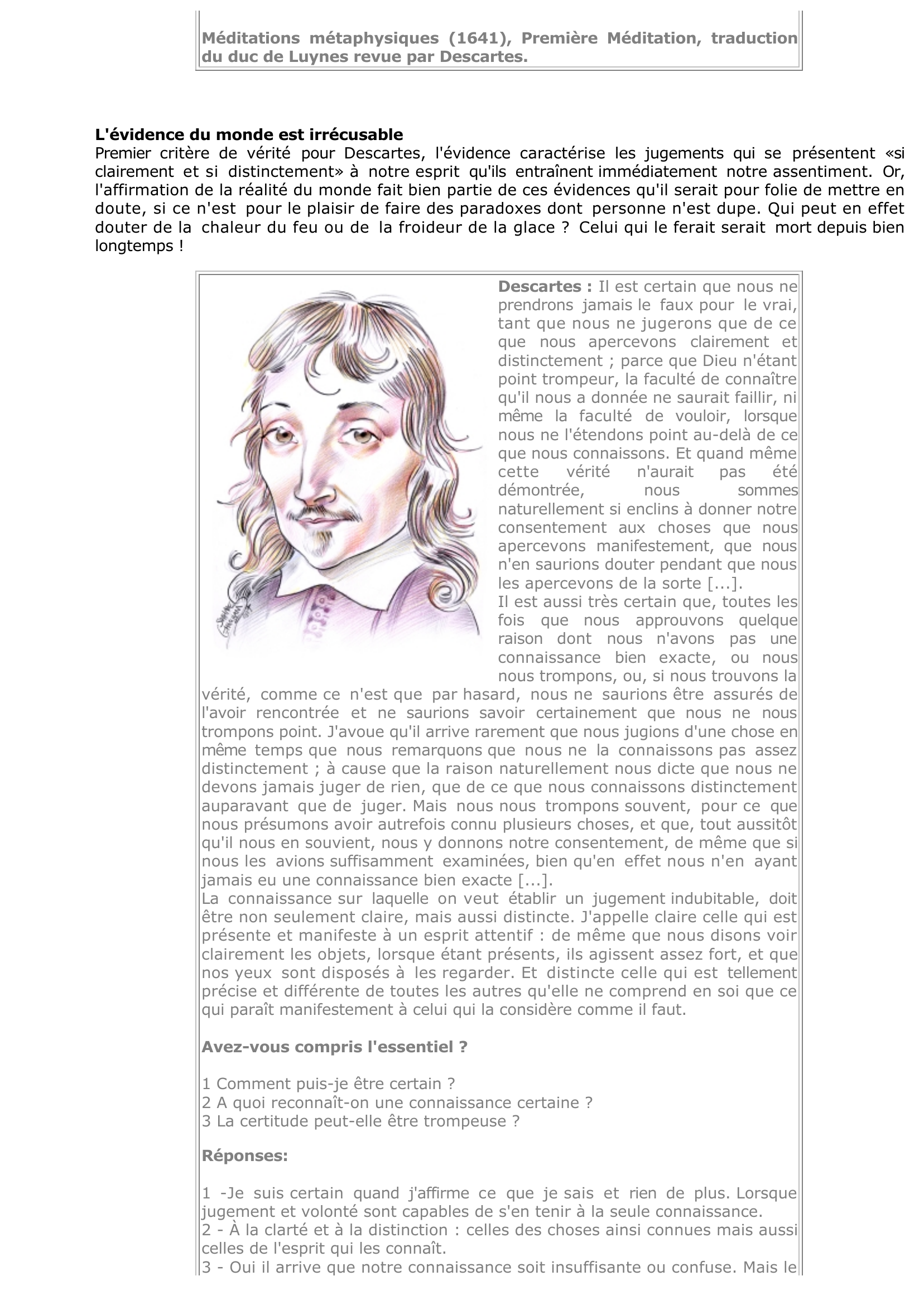La réalité peut-elle exister en dehors de l'esprit ?
Publié le 22/02/2004
Extrait du document


«
Méditations métaphysiques (1641), Première Méditation, traductiondu duc de Luynes revue par Descartes.
L'évidence du monde est irrécusablePremier critère de vérité pour Descartes, l'évidence caractérise les jugements qui se présentent «siclairement et si distinctement» à notre esprit qu'ils entraînent immédiatement notre assentiment.
Or,l'affirmation de la réalité du monde fait bien partie de ces évidences qu'il serait pour folie de mettre endoute, si ce n'est pour le plaisir de faire des paradoxes dont personne n'est dupe.
Qui peut en effetdouter de la chaleur du feu ou de la froideur de la glace ? Celui qui le ferait serait mort depuis bienlongtemps !
Descartes : Il est certain que nous ne prendrons jamais le faux pour le vrai,tant que nous ne jugerons que de ceque nous apercevons clairement etdistinctement ; parce que Dieu n'étantpoint trompeur, la faculté de connaîtrequ'il nous a donnée ne saurait faillir, nimême la faculté de vouloir, lorsquenous ne l'étendons point au-delà de ceque nous connaissons.
Et quand mêmecette vérité n'aurait pas étédémontrée, nous sommesnaturellement si enclins à donner notreconsentement aux choses que nousapercevons manifestement, que nousn'en saurions douter pendant que nousles apercevons de la sorte [...].Il est aussi très certain que, toutes lesfois que nous approuvons quelqueraison dont nous n'avons pas uneconnaissance bien exacte, ou nousnous trompons, ou, si nous trouvons la vérité, comme ce n'est que par hasard, nous ne saurions être assurés del'avoir rencontrée et ne saurions savoir certainement que nous ne noustrompons point.
J'avoue qu'il arrive rarement que nous jugions d'une chose enmême temps que nous remarquons que nous ne la connaissons pas assezdistinctement ; à cause que la raison naturellement nous dicte que nous nedevons jamais juger de rien, que de ce que nous connaissons distinctementauparavant que de juger.
Mais nous nous trompons souvent, pour ce quenous présumons avoir autrefois connu plusieurs choses, et que, tout aussitôtqu'il nous en souvient, nous y donnons notre consentement, de même que sinous les avions suffisamment examinées, bien qu'en effet nous n'en ayantjamais eu une connaissance bien exacte [...].La connaissance sur laquelle on veut établir un jugement indubitable, doitêtre non seulement claire, mais aussi distincte.
J'appelle claire celle qui estprésente et manifeste à un esprit attentif : de même que nous disons voirclairement les objets, lorsque étant présents, ils agissent assez fort, et quenos yeux sont disposés à les regarder.
Et distincte celle qui est tellementprécise et différente de toutes les autres qu'elle ne comprend en soi que cequi paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut.
Avez-vous compris l'essentiel ?
1 Comment puis-je être certain ?2 A quoi reconnaît-on une connaissance certaine ?3 La certitude peut-elle être trompeuse ?
Réponses:
1 -Je suis certain quand j'affirme ce que je sais et rien de plus.
Lorsquejugement et volonté sont capables de s'en tenir à la seule connaissance.2 - À la clarté et à la distinction : celles des choses ainsi connues mais aussicelles de l'esprit qui les connaît.3 - Oui il arrive que notre connaissance soit insuffisante ou confuse.
Mais le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ESPRIT ET RÉALITÉ, Nikolaï Alexandrovitch Berdiaev
- Si pour Descartes aucune preuve n'est nécessaire, si l'expérience suffit c'est parce que l'évidence du libre-arbitre est liée à notre conscience. Être conscient c'est en effet se savoir être, se savoir exister, et donc être face à la réalité qui nous entoure : j'ai le choix de faire ou non des études, j'ai le choix de pratiquer ou non un sport etc. On voit ainsi qu'être un être conscient c'est se sentir libre. La conscience nous donne l'intuition de notre existence, de notre présence a
- Dans la préface de « Pierre et Jean », Maupassant s'en prend aux romanciers d'analyse qui s'attachent « à indiquer les moindres évolutions d'un esprit, les mobiles les plus secrets qui déterminent nos actions ». Il leur oppose la manière des « écrivains objectifs » qui « se bornent à faire passer sous nos yeux les personnages » et conclut que « la psychologie doit être cachée dans le livre comme elle est cachée en réalité sous les faits dans l'existence ». En prenant des exemples dans
- « La poésie est uniquement une opération de l'esprit du poète exprimant les accords de son être sensible au contact de la réalité. » (Reverdy). ?
- Réalité et nature de l'esprit ?