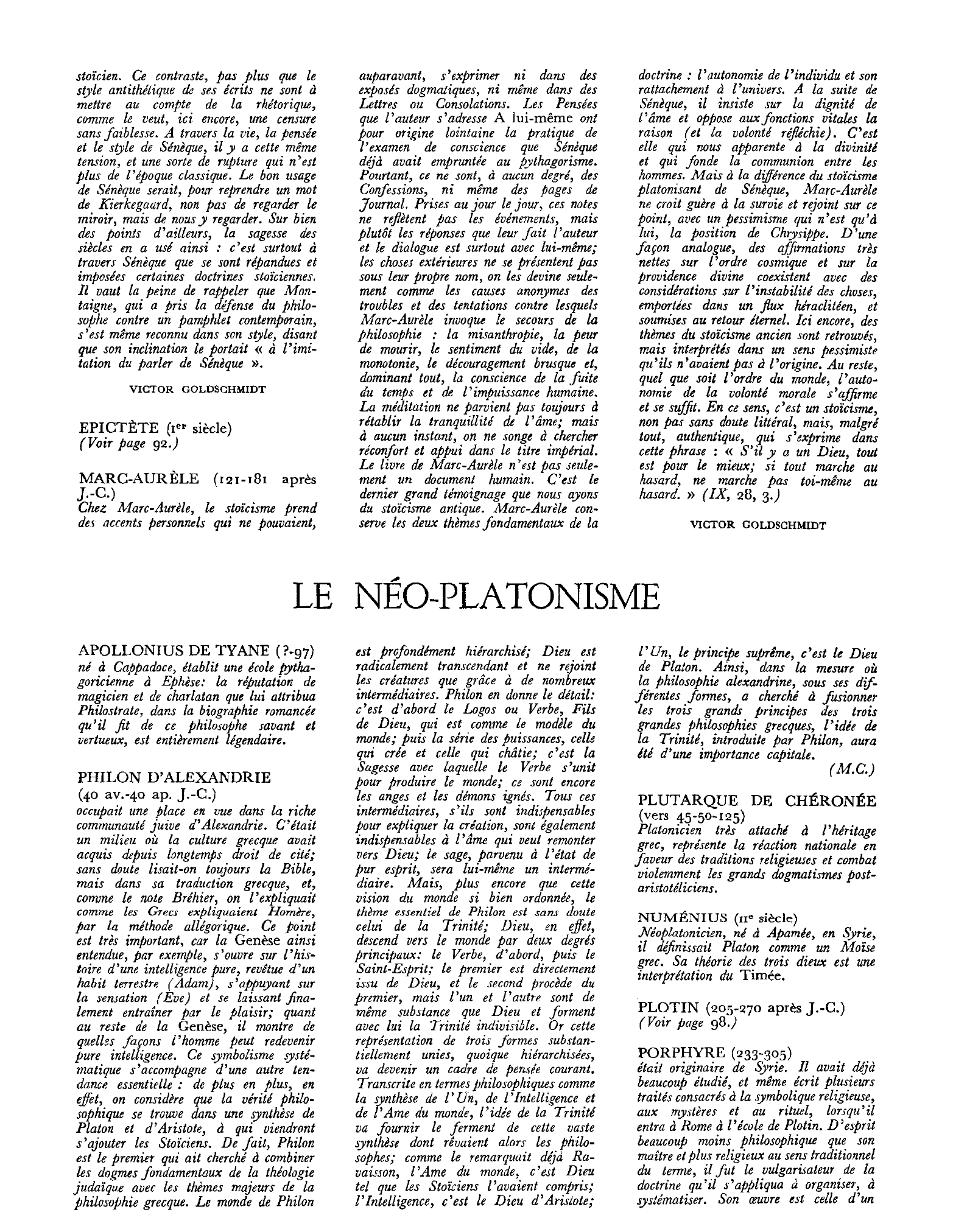LA TRADITION DE PLATON ARCÉSILAS (315-241 av.
Publié le 21/10/2012

Extrait du document
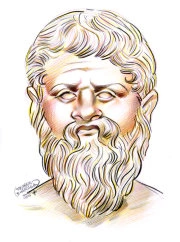
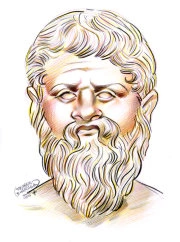
«
stoïcien.
Ce contraste, pas plus que le style antithétique de ses écrits ne sont à
mettre au compte de la rhétorique, comme le veut, ici encore, une censure sans faiblesse.
A travers la vie, la pensée et le style de Sénèque, il y a cette même tension, et une sorte de rupture qui n'est
plus de l'époque classique.
Le bon usage de Sénèque serait, pour reprendre un mot de Kierkegaard, non pas de regarder le miroir, mais de nous y regarder.
Sur bien des points d'ailleurs, la sagesse des siècles en a usé ainsi : c'est surtout à
travers Sénèque que se sont répandues et
imposées certaines doctrines stoïciennes.
Il vaut la peine de rappeler que Mon
taigne, qui a pris la défense du philo sophe contre un pamphlet contemporain,
s'est même reconnu dans son style, disant que son inclination le portait « à l' imi
tation du parler de Sénèque ».
VICTOR GOLDSCHMIDT
EPICTÈTE (1•• siècle) (Voir page 92.)
MARC-AURÈLE (12I-I81 après J.-C.) Chez Marc-Aurèle, le stoïcisme prend de.s accents personnels qui ne pouvaient, auparavant,
s'exprimer ni dans
des exposés dogmatiques, ni même dans des Lettres ou Consolations.
Les Pensées que l'auteur s'adresse A lui-même ont
pour origine lointaine la pratique de l'examen de conscience que Sénèque déjà avait empruntée au pythagorisme.
Pourtant, ce ne sont, à aucun degré, des Confessions, ni même des pages de Journal.
Prises au jour le jour, ces notes ne reflètent pas les événements, mais
plutôt les réponses que leur fait l'auteur
et le dialogue est surtout avec lui-même; les choses extérieures ne se présentent pas sous leur propre nom, on les devine seule
ment comme les causes anonymes des troubles et des tentations contre lesquels
Marc-Aurèle invoque le secours de la
philosophie : la misanthropie, la peur
de mourir, le sentiment du vide, de la
monotonie, le découragement brusque et,
dominant tout, la conscience de la fuite du temps et de l'impuissance humaine.
La méditation ne parvient pas toujours à
rétablir la tranquillité de l'âme; mais
à aucun instant, on ne songe à chercher réconfort et appui dans le titre impérial.
Le livre de Marc-Aurèle n'est pas seule
ment un document humain.
C'est le dernier grand témoignage que nous ayons du stoïcisme antique.
Marc-Aurèle con serve les deux thèmes fondamentaux de la
doctrine : l'autonomie de l'individu et son rattachement à l'univers.
A la suite de Sénèque, il insiste sur la dignité de l'âme et oppose aux fonctions vitales la
raison (et la volonté réfléchie).
C'est elle qui nous apparente à la divinité
et qui fonde la communion entre les hommes.
Mais à la différence du stoïcisme
platonisant de Sénèque, Marc-Aurèle ne croit guère à la survie et rejoint sur ce point, avec un pessimisme qui n'est qu'à
lui, la position de Chrysippe.
D'une façon analogue, des affirmations très
nettes sur l'ordre cosmique et sur la
providence divine coexistent
avec des considérations sur l'instabilité des choses, emportées dans un flux héraclitéen, et
soumises au retour éternel.
Ici encore, des thèmes du stoïcisme ancien sont retrouvés, mais interprétés dans un sens pessimiste
qu'ils n'avaient pas à l'origine.
Au reste, quel que soit l'ordre du monde, l'auto
nomie de la volonté morale s'affirme
et se suffit.
En ce sens, c'est un stoïcisme, non pas sans doute littéral, mais, malgré
tout, authentique, qui s'exprime dans
cette phrase : « S'il y a un Dieu, tout
est pour le mieux; si tout marche au
hasard, ne marche pas toi-même au
hasard.
» (IX, 28, 3.)
VICTOR GOLDSCHMIDT
LE NÉO-PLATONISME
APOLLONIUS DE TYANE ( ?-g7) né à Cappadoce, établit une école pytha
goricienne à Ephèse: la réputation de magicien et de charlatan que lui attribua
Philostrate, dans la biographie romancée qu'il fit de ce philosophe savant et
vertueux, est entièrement légendaire.
PHILON D'ALEXANDRIE
(40 av.-40 ap.
J.-C.) occupait une place en vue dans la riche
communauté juive d'Alexandrie.
C'était
un milieu où la culture grecque avait
acquis depuis longtemps droit de cité;
sans doute lisait-on toujours la Bible,
mais dans sa traduction grecque, et, comme le note Bréhier, on l'expliquait comme les Grecs expliquaient Homère,
par la méthode allégorique.
Ce point
est très important, car la Genèse ainsi
entendue, par exemple, s'ouvre sur l'his toire d'une intelligence pure, revêtue d'un
habit terrestre (Adam), s'appuyant sur
la sensation (Eve) et se laissant fina
lement entraîner par le plaisir; quant
au reste de la Genèse, il montre de quelüs façons l'homme peut redevenir
pure intelligence.
Ce symbolisme systé
matique s'accompagne d'une autre ten
dance essentielle : de plus en plus, en effet, on considère que la vérité philo
sophique se trouve dans une synthèse de Platon et d'Aristote, à qui viendront
s'ajouter les Stoïciens.
De fait, Philon
est le premier qui ait cherché à combiner les dogmes fondamentaux de la théologie
judaïque avec les thèmes majeurs de la philosophie grecque.
Le monde de Philon est
profondément hiérarchisé; Dieu est
radicalement transcendant et
ne rqoint les créatures que grâce à de nombreux
intermédiaires.
Philon en donne le détail:
c'est d'abord le Logos ou Verbe, Fils de Dieu, qui est comme le modèle du monde; puis la série des puissances, celle qui crée et celle qui châtie; c'est la Sagesse avec laquelle le Verbe s'unit pour produire le monde; ce sont encore les anges et les démons ignés.
Tous ces intermédiaires, s'ils sont indispensables
pour expliquer la création, sont également
indispensables à l'âme qui veut remonter
vers Dieu; le sage, parvenu à l'état de pur esprit, sera lui-même un intermé
diaire.
Mais, plus encore que cette
vision du monde si bien ordonnée, le thème essentiel de Philon est sans doute celui de la Trinité; Dieu, en effet, descend vers le monde par deux degrés principaux: le Verbe, d'abord, puis le Saint-Esprit; le premier est directement
issu de Dieu, et le second procède du premier, mais l'un et l'autre sont de même substance que Dieu et forment avec lui la Trinité indivisible.
Or cette représentation de trois formes substan
tiellement unies, quoique hiérarchisées, va devenir un cadre de pensée courant.
Transcrite en termes philosophiques comme la synthèse de l'Un, de l'Intelligence et de l'Ame du monde, l'idée de la Trinité va fournir le ferment de cette vaste
synthèse dont rêvaient alors les philo
sophes; comme le remarquait déjà Ra vaisson, l'Ame du monde, c'est Dieu
tel que les Stoïciens l'avaient compris;
l'Intelligence, c'est le Dieu d'Aristote;
l'Un, le principe suprlme, c'est le Dieu de Platon.
Ainsi, dans la mesure où la philosophie alexandrine, sous ses dif
férentes formes, a cherché à fusionner les trois grands principes des trois
grandes philosophies grecques, l'idée de la Trinité, introduite par Philon, aura
été d'une importance capitale.
(M.C.)
PLUTARQUE DE CHÉRONÉE (vers 45-50-1 25) Platonicien très attaché à l'héritage
grec, représente la réaction nationale en faveur des traditions religieuses et combat
violemment les grands dogmatismes post
aristotéliciens.
NUMÉNIUS (rr• siècle) Néoplatonicien, né à Apamée, en Syrie, il définissait Platon comme un Moïse
grec.
Sa théorie des trois dieux est une interprétation du Timée.
PLOTIN (205-270 après J.-C.) (Voir page gB.)
PORPHYRE (233-305) était originaire de Syrie.
Il avait déjà beaucoup étudié, et même écrit plusieurs
traités consacrés à la symbolique religieuse,
aux mystères et au rituel, lorsqu 'il entra à Rome à l'école de Plotin.
D'esprit beaucoup moins philosophique que son maître et plus religieux au sens traditionnel du terme, il fut le vulgarisateur de la doctrine qu'il s'appliqua à organiser, à
systématiser.
Son œuvre est celle d'un
g6g.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mais le fait est que, parmi nos biens, les plus grands sont ceux qui nous viennent par l'intermédiaire d'un délire, dont à coup sûr nous dote un don divin. Platon Phèdre, 241. Commentez cette citation.
- « L’oeil est le miroir de l’âme » PLATON
- « Le corps est le tombeau de l’âme » PLATON Cratyle
- La tradition est-elle un obstacle à la raison ?
- Présocratiques à Platon