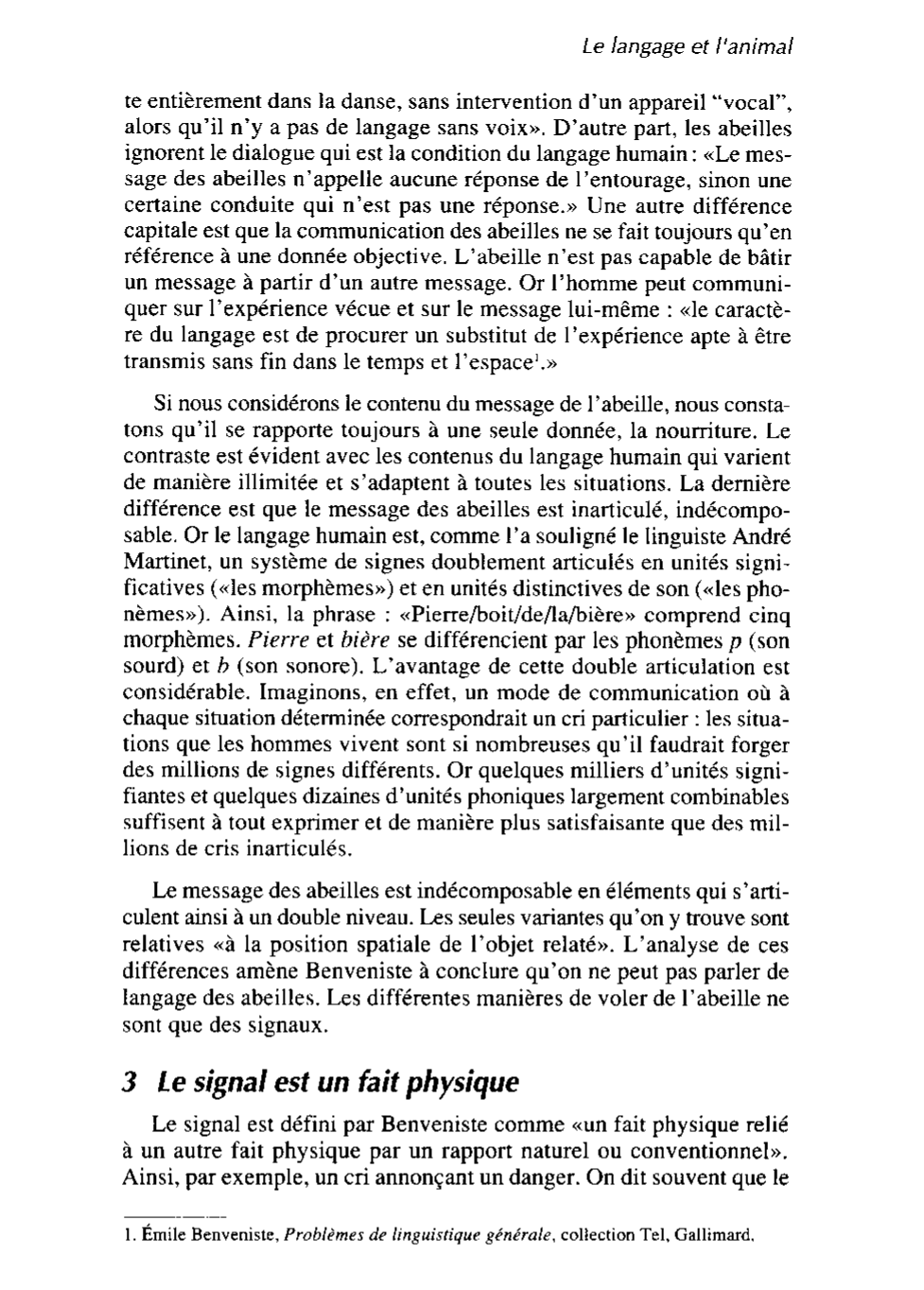LANGAGE ET ANIMALITE
Publié le 11/03/2015

Extrait du document

Dans Vie et moeurs des abeilles, Karl Von Frisch montre que les
abeilles disposent d'un système de signes différenciés leur permettant
d'indiquer la distance et la direction d'un gisement de pollen. Les
éclaireuses ayant découvert un lieu de butinage, rentrent à la ruche et
se livrent à deux sortes de danse. L'une se fait en cercle et annonce que
l'emplacement de la nourriture doit être cherché à une faible distance
dans un rayon de cent mètres environ de la ruche.L'autre que l' abeille
accomplit en frétillant et en décrivant des huit indique que le point est
situé à une distance supérieure, au-delà de cent mètres et jusqu'à six
kilomètres. Le rythme de la danse frétillante est plus ou moins lent selon
l'éloignement du point et son allure comporte aussi des indications de
direction. Il y a donc bien, chez les abeilles, une correspondance
«conventionnelle« entre le «comportement« et les «données« (distance,
direction) qu'il traduit, donc une certaine «capacité de formuler et
d'interpréter un signe qui renvoie à une certaine réa!ité 1«.
les singes ont-ils les mêmes aptitudes
linguistiques que l'homme ?
Des spécialistes de psychologie animale ont cherché à évaluer les
aptitudes des singes à utiliser un langage comme le nôtre. Des expériences
ont été menées par les Gardner avec leur femelle chimpanzé,
Washoe, par D. Premack avec Sarah. Les organes phonatoires des
singes ne leur permettant pas d'émettre des sons articulés, ils ont eu
recours à des codes de communication visuels. Washoe «parlait« en faisant
des gestes adaptés du langage des sourds-muets américains. Sarah
utilisait des jetons de couleurs et de formes variées qu'elle plaçait verticalement
sur une ardoise aimantée.

«
Le langage et l'animal
te entièrement dans la danse, sans intervention d'un appareil "vocal",
alors qu'il n'y a pas de langage sans voix».
D'autre part, les abeilles
ignorent le dialogue qui est la condition du langage humain: «Le mes
sage des abeilles
n'appelle aucune réponse de l'entourage, sinon une
certaine conduite qui n'est pas une réponse.» Une autre différence
capitale est que la communication des abeilles ne se fait toujours
qu'en référence à une donnée objective.
L'abeille n'est pas capable de bâtir
un message à partir
d'un autre message.
Or l'homme peut communi
quer sur l'expérience vécue et sur le message lui-même :
«le caractè
re du langage est de procurer un substitut de l'expérience apte à être
transmis sans fin dans le temps et
l'espace 1.»
Si nous considérons le contenu du message de l'abeille, nous consta
tons
qu'il se rapporte toujours à une seule donnée, la nourriture.
Le
contraste est évident avec les contenus du langage humain qui varient
de manière illimitée et
s'adaptent à toutes les situations.
La dernière
différence est que le message des abeilles est inarticulé, indécompo
sable.
Or le langage humain est, comme l'a souligné le linguiste André
Martinet, un système de signes doublement articulés en unités signi
ficatives
(«les morphèmes») et en unités distinctives de son («les pho
nèmes»).
Ainsi, la phrase : «Pierre/boit/de/la/bière» comprend cinq
morphèmes.
Pierre et bière se différencient par les phonèmes p (son
sourd) eth (son sonore).
L'avantage de cette double articulation est
considérable.
Imaginons,
en effet, un mode de communication où à chaque situation déterminée correspondrait un cri particulier : les situa
tions que les hommes vivent sont si nombreuses
qu'il faudrait forger
des millions de signes différents.
Or quelques milliers d'unités signi
fiantes et quelques dizaines d'unités phoniques largement combinables
suffisent à tout exprimer et de manière plus satisfaisante que des mil
lions de cris inarticulés.
Le message des abeilles est indécomposable
en éléments qui s 'arti
culent ainsi à un double niveau.
Les seules variantes
qu'on y trouve sont
relatives
«à la position spatiale de l'objet relaté».
L'analyse de ces
différences amène Benveniste à conclure
qu'on ne peut pas parler de
langage des abeilles.
Les différentes manières de voler de l'abeille ne
sont que des signaux.
3 Le signal est un fait physique
Le signal est défini par Benveniste comme «un fait physique relié
à
un autre fait physique par un rapport naturel ou conventionnel».
Ainsi, par exemple, un cri annonçant un danger.
On dit souvent que le
1.
Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, col!ection Tel, Gallimanl.
17.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES BALISAGES DU LANGAGE HTML
- Le langage – cours
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle
- dissertation juste la fin du monde: En quoi l’œuvre Juste la Fin du Monde relève-telle une crise personnelle et familiale à travers une crise du langage ?
- Qu’est-ce qui rend le langage humain ? (cours de philo)