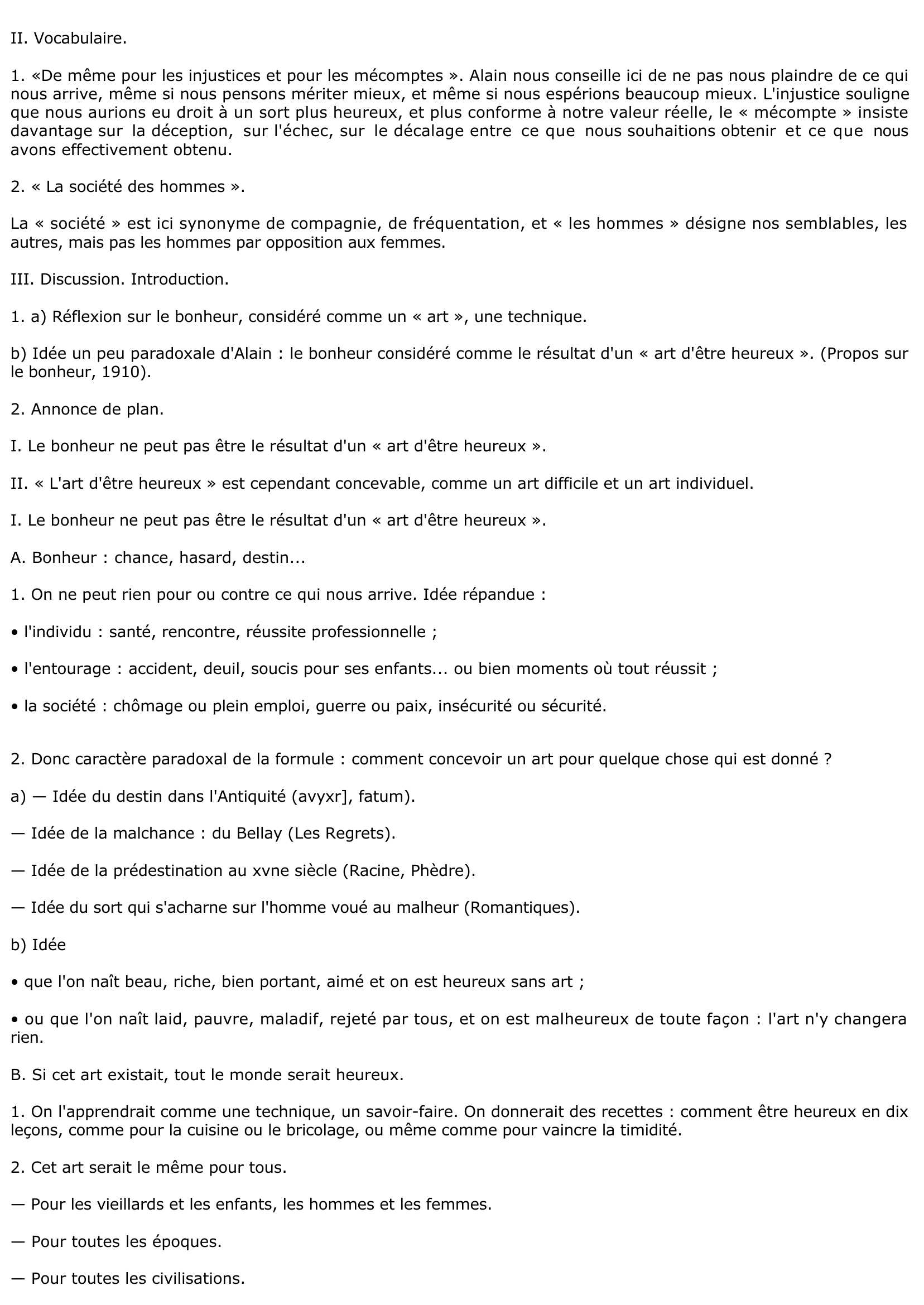Le bonheur selon Alain
Publié le 24/03/2011

Extrait du document
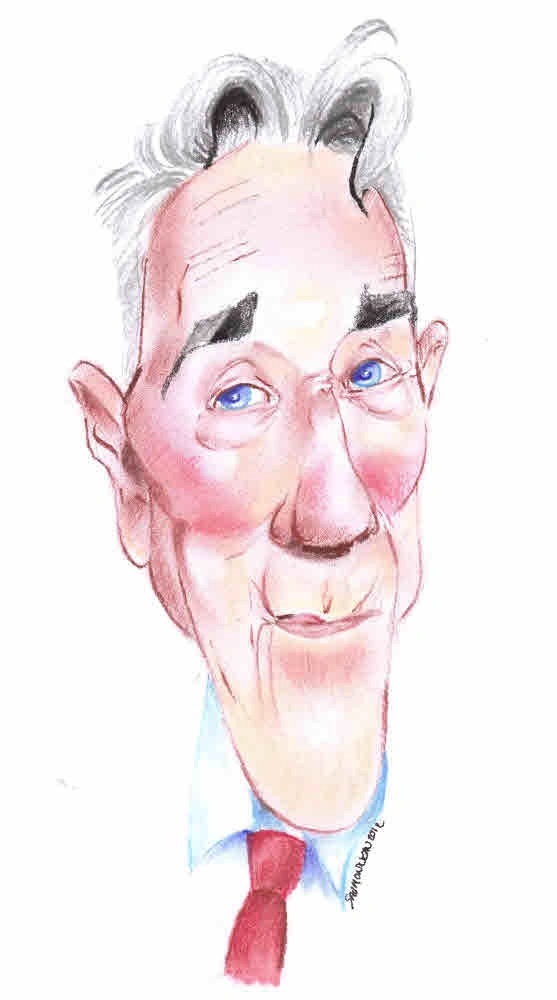
On devrait bien enseigner aux enfants l'art d'être heureux. Non pas l'art d'être heureux quand le malheur vous tombe sur la tête : je laisse cela aux stoïciens (1); mais l'art d'être heureux quand les circonstances sont passables et que toute l'amertume de la vie se réduit à de petits ennuis et à de petits malaises. La première règle serait de ne jamais parler aux autres de ses propres malheurs, présents ou passés. On devrait tenir pour une impolitesse de décrire aux autres un mal de tête, une nausée, une aigreur, une colique, quand même ce serait en termes choisis. De même pour les injustices et pour les mécomptes. Il faudrait expliquer aux enfants et aux jeunes gens, aux hommes aussi, quelque chose qu'ils oublient trop, il me semble, c'est que les plaintes sur soi ne peuvent qu'attrister les autres, c'est-à-dire en fin de compte leur déplaire, même s'ils cherchent de telles confidences, même s'ils semblent se plaire à consoler. Car la tristesse est comme un poison ; on peut l'aimer, mais non s'en trouver bien ; et c'est toujours le plus profond sentiment qui a raison à la fin. Chacun cherche à vivre et non à mourir; et cherche ceux qui vivent, j'entends ceux qui se disent contents, qui se montrent contents. Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes, si chacun mettait de son bois au feu, au lieu de pleurnicher sur des cendres ! Remarquez que ces règles furent celles de la société polie; et il est vrai qu'on s'y ennuyait, faute de parler librement. Notre bourgeoisie a su rendre aux propos de société tout le franc-parler qu'il y faut; et c'est très bien. Ce n'est pourtant pas une raison pour que chacun apporte ses misères au tas ; ce ne serait qu'un ennui plus noir. Et c'est une raison pour élargir la société au-delà de la famille ; car, dans le cercle de famille, souvent, par trop d'abandon, par trop de confiance, on vient à se plaindre de petites choses auxquelles on ne penserait même pas si l'on avait un peu le souci de plaire. Le plaisir d'intriguer autour des puissances vient sans doute de ce que l'on oublie alors, par nécessité, mille petits malheurs dont le récit serait ennuyeux. L'intrigant se donne, comme on dit, de la peine, et cette peine tourne à plaisir, comme celle du musicien, comme celle du peintre; mais l'intrigant est premièrement délivré de toutes les petites peines qu'il n'a point l'occasion ni le temps de raconter. Le principe est celui-ci : si tu ne parles pas de tes peines, j'entends de tes petites peines, tu n'y penseras pas longtemps. Dans cet art d'être heureux, auquel je pense, je mettrais aussi d'utiles conseils sur le bon usage du mauvais temps. Au moment où j'écris, la pluie tombe ; les tuiles sonnent; mille petites rigoles bavardent; l'air est lavé et comme filtré; les nuées ressemblent à des haillons magnifiques. Il faut apprendre à saisir ces beautés-là. « Mais, dit l'un, la pluie gâte les moissons. « Et l'autre : « La boue salit tout. « Et un troisième : « Il est si bon de s'asseoir dans l'herbe. « C'est entendu ; on le sait ; vos plaintes n'y retranchent rien, et je reçois une pluie de plaintes qui me poursuit dans la maison. Eh bien, c'est surtout en temps de pluie, que l'on veut des visages gais. Donc, bonne figure à mauvais temps. Alain, Propos sur le bonheur, 1910. 1. Vous résumerez le texte en 160 mots. Une marge de 10 % en plus ou en moins est admise. Vous indiquerez à la fin de votre résumé le nombre de mots employés.
2. Expliquez le sens dans le texte des expressions suivantes : a) de même pour les injustices et pour les mécomptes ; b) la société des hommes. 3. Pensez-vous avec l'auteur que le bonheur puisse être le résultat d'un « art d'être heureux « ?
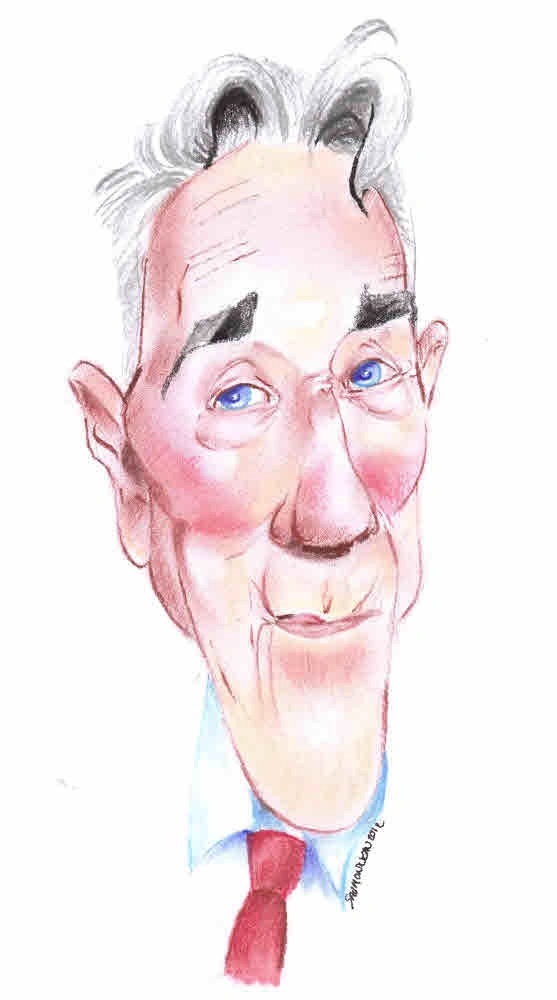
«
II.
Vocabulaire.
1.
«De même pour les injustices et pour les mécomptes ».
Alain nous conseille ici de ne pas nous plaindre de ce quinous arrive, même si nous pensons mériter mieux, et même si nous espérions beaucoup mieux.
L'injustice souligneque nous aurions eu droit à un sort plus heureux, et plus conforme à notre valeur réelle, le « mécompte » insistedavantage sur la déception, sur l'échec, sur le décalage entre ce que nous souhaitions obtenir et ce que nousavons effectivement obtenu.
2.
« La société des hommes ».
La « société » est ici synonyme de compagnie, de fréquentation, et « les hommes » désigne nos semblables, lesautres, mais pas les hommes par opposition aux femmes.
III.
Discussion.
Introduction.
1.
a) Réflexion sur le bonheur, considéré comme un « art », une technique.
b) Idée un peu paradoxale d'Alain : le bonheur considéré comme le résultat d'un « art d'être heureux ».
(Propos surle bonheur, 1910).
2.
Annonce de plan.
I.
Le bonheur ne peut pas être le résultat d'un « art d'être heureux ».
II.
« L'art d'être heureux » est cependant concevable, comme un art difficile et un art individuel.
I.
Le bonheur ne peut pas être le résultat d'un « art d'être heureux ».
A.
Bonheur : chance, hasard, destin...
1.
On ne peut rien pour ou contre ce qui nous arrive.
Idée répandue :
• l'individu : santé, rencontre, réussite professionnelle ;
• l'entourage : accident, deuil, soucis pour ses enfants...
ou bien moments où tout réussit ;
• la société : chômage ou plein emploi, guerre ou paix, insécurité ou sécurité.
2.
Donc caractère paradoxal de la formule : comment concevoir un art pour quelque chose qui est donné ?
a) — Idée du destin dans l'Antiquité (avyxr], fatum).
— Idée de la malchance : du Bellay (Les Regrets).
— Idée de la prédestination au xvne siècle (Racine, Phèdre).
— Idée du sort qui s'acharne sur l'homme voué au malheur (Romantiques).
b) Idée
• que l'on naît beau, riche, bien portant, aimé et on est heureux sans art ;
• ou que l'on naît laid, pauvre, maladif, rejeté par tous, et on est malheureux de toute façon : l'art n'y changerarien.
B.
Si cet art existait, tout le monde serait heureux.
1.
On l'apprendrait comme une technique, un savoir-faire.
On donnerait des recettes : comment être heureux en dixleçons, comme pour la cuisine ou le bricolage, ou même comme pour vaincre la timidité.
2.
Cet art serait le même pour tous.
— Pour les vieillards et les enfants, les hommes et les femmes.
— Pour toutes les époques.
— Pour toutes les civilisations..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Alain, Propos sur le bonheur (extrait) - anthologie.
- Alain - Propos sur le Bonheur ?
- Alain-Fournier, dans son roman, Le Grand Meaulnes, fait dire à l'un de ses personnages : « Et puis j'apprendrais aux garçons à être sages... Je ne leur donnerais pas le désir de courir le monde... Je leur enseignerais à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air .» Où trouve-t-on, à votre avis, le bonheur ? Est-ce dans l'aventure, ou le découvre-t-on, proche et caché, dans la vie quotidienne ?
- ALAIN, Emile-Auguste Chartier, dit (1868-1951) Philosophe, il développe un humanisme cartésien, en accordant la suprématie au rôle de la raison sur l'affectivité : Système des Beaux-Arts, Propos sur le bonheur.
- Pensez-vous avec Alain que le bonheur puisse être le résultat d'un « art d'être heureux » ?