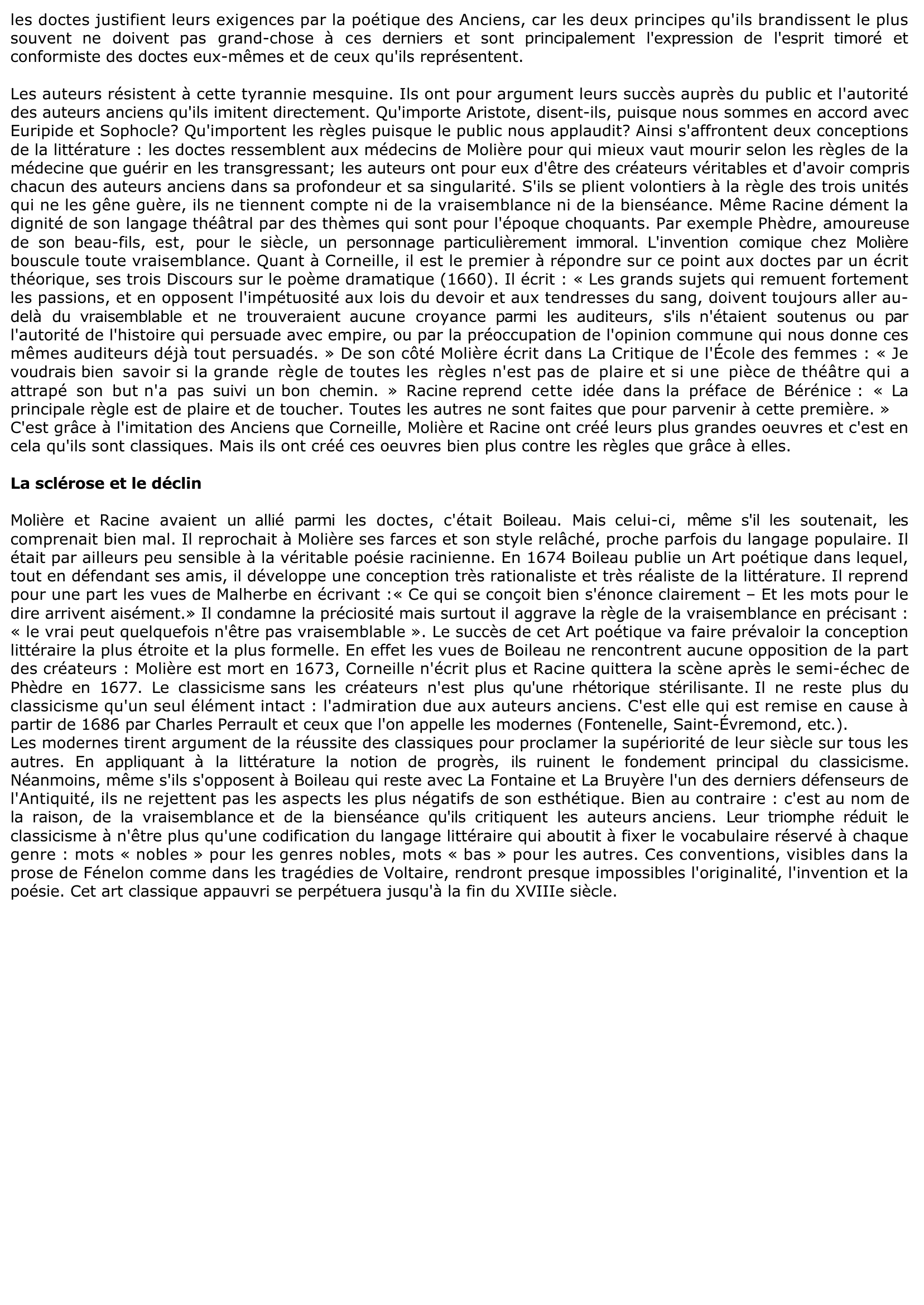Le CLASSICISME en littérature
Publié le 11/06/2009

Extrait du document
La difficulté de définir cette doctrine vient de ce qu'elle n'a reçu que des formulations partielles et successives. L'essentiel en elle est resté informulé. La raison en est que ni pour s'instaurer ni pour se maintenir le classicisme n'eut à s'affirmer contre des doctrines rivales cohérentes. Le terme même de classicisme n'est pas utilisé pendant le XVIIe siècle. C'est Voltaire, dans Le Siècle de Louis XIV, qui l'applique pour la première fois à Corneille, Molière et Racine, en lui donnant son sens latin (« classicus « : de première classe). En fait le classicisme est l'application au domaine littéraire d'une certaine philosophie léguée par l'Antiquité païenne et que l'on peut résumer ainsi : la nature de l'homme et celle de l'univers, les règles de l'art et les lois de la beauté sont immuables et éternelles. Après la longue parenthèse du Moyen Age, la Renaissance a le double effet de remettre cette philosophie au premier plan et de lui apporter une confirmation par les faits : si le passé peut renaître, c'est bien que l'histoire est une illusion. Le but de ceux qu'on appellera plus tard les classiques est de peindre une vérité qui n'a pas changé, dans un langage qui, lui, a changé. En effet les classiques ne sont pas entièrement aveugles à la réalité de l'histoire; ils savent que chaque siècle a ses moeurs, ses coutumes et son langage particulier. Mais ils n'accordent à cette évolution que peu d'importance; elle est à leurs yeux superficielle, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que la surface des choses; ce qui change, c'est l'apparence extérieure mais non l'homme lui-même. La société elle aussi leur semble stable; ils n'ont aucune peine à établir une équivalence entre les conditions sociales de l'Antiquité et celles de leur temps : il y a toujours des princes et des paysans, des soldats et des commerçants, des rois et des sujets. Racine dans Les Plaideurs transporte sans effort les juges du tribunal d'Athènes dans le Paris de son époque. Ils n'y sont pas déplacés. Le seul problème est donc, pour un écrivain, un problème de traduction : il faut exprimer en français du XVIe et du XVIIe siècle ce que d'autres ont dit jadis en grec ou en latin, et il faut l'exprimer aussi bien. Pure répétition? non, car cette même vérité qu'il faut redire n'est pas évidente. Il faut, pour la voir et la faire voir, rendre transparents les habits modernes qui la dissimulent. Cette conception de l'histoire et de l'art constitue pour les générations classiques un ensemble d'évidences implicites. Mais même si elle fut sentie globalement par tous, la doctrine classique n'a été codifiée que progressivement et toujours de manière partielle. Le classicisme a donc une histoire; elle le conduira de la fécondité à la stérilité.
«
les doctes justifient leurs exigences par la poétique des Anciens, car les deux principes qu'ils brandissent le plussouvent ne doivent pas grand-chose à ces derniers et sont principalement l'expression de l'esprit timoré etconformiste des doctes eux-mêmes et de ceux qu'ils représentent.
Les auteurs résistent à cette tyrannie mesquine.
Ils ont pour argument leurs succès auprès du public et l'autoritédes auteurs anciens qu'ils imitent directement.
Qu'importe Aristote, disent-ils, puisque nous sommes en accord avecEuripide et Sophocle? Qu'importent les règles puisque le public nous applaudit? Ainsi s'affrontent deux conceptionsde la littérature : les doctes ressemblent aux médecins de Molière pour qui mieux vaut mourir selon les règles de lamédecine que guérir en les transgressant; les auteurs ont pour eux d'être des créateurs véritables et d'avoir comprischacun des auteurs anciens dans sa profondeur et sa singularité.
S'ils se plient volontiers à la règle des trois unitésqui ne les gêne guère, ils ne tiennent compte ni de la vraisemblance ni de la bienséance.
Même Racine dément ladignité de son langage théâtral par des thèmes qui sont pour l'époque choquants.
Par exemple Phèdre, amoureusede son beau-fils, est, pour le siècle, un personnage particulièrement immoral.
L'invention comique chez Molièrebouscule toute vraisemblance.
Quant à Corneille, il est le premier à répondre sur ce point aux doctes par un écritthéorique, ses trois Discours sur le poème dramatique (1660).
Il écrit : « Les grands sujets qui remuent fortementles passions, et en opposent l'impétuosité aux lois du devoir et aux tendresses du sang, doivent toujours aller au-delà du vraisemblable et ne trouveraient aucune croyance parmi les auditeurs, s'ils n'étaient soutenus ou parl'autorité de l'histoire qui persuade avec empire, ou par la préoccupation de l'opinion commune qui nous donne cesmêmes auditeurs déjà tout persuadés.
» De son côté Molière écrit dans La Critique de l'École des femmes : « Jevoudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire et si une pièce de théâtre qui aattrapé son but n'a pas suivi un bon chemin.
» Racine reprend cette idée dans la préface de Bérénice : « Laprincipale règle est de plaire et de toucher.
Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première.
»C'est grâce à l'imitation des Anciens que Corneille, Molière et Racine ont créé leurs plus grandes oeuvres et c'est encela qu'ils sont classiques.
Mais ils ont créé ces oeuvres bien plus contre les règles que grâce à elles.
La sclérose et le déclin
Molière et Racine avaient un allié parmi les doctes, c'était Boileau.
Mais celui-ci, même s'il les soutenait, lescomprenait bien mal.
Il reprochait à Molière ses farces et son style relâché, proche parfois du langage populaire.
Ilétait par ailleurs peu sensible à la véritable poésie racinienne.
En 1674 Boileau publie un Art poétique dans lequel,tout en défendant ses amis, il développe une conception très rationaliste et très réaliste de la littérature.
Il reprendpour une part les vues de Malherbe en écrivant :« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement – Et les mots pour ledire arrivent aisément.» Il condamne la préciosité mais surtout il aggrave la règle de la vraisemblance en précisant :« le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable ».
Le succès de cet Art poétique va faire prévaloir la conceptionlittéraire la plus étroite et la plus formelle.
En effet les vues de Boileau ne rencontrent aucune opposition de la partdes créateurs : Molière est mort en 1673, Corneille n'écrit plus et Racine quittera la scène après le semi-échec dePhèdre en 1677.
Le classicisme sans les créateurs n'est plus qu'une rhétorique stérilisante.
Il ne reste plus duclassicisme qu'un seul élément intact : l'admiration due aux auteurs anciens.
C'est elle qui est remise en cause àpartir de 1686 par Charles Perrault et ceux que l'on appelle les modernes (Fontenelle, Saint-Évremond, etc.).Les modernes tirent argument de la réussite des classiques pour proclamer la supériorité de leur siècle sur tous lesautres.
En appliquant à la littérature la notion de progrès, ils ruinent le fondement principal du classicisme.Néanmoins, même s'ils s'opposent à Boileau qui reste avec La Fontaine et La Bruyère l'un des derniers défenseurs del'Antiquité, ils ne rejettent pas les aspects les plus négatifs de son esthétique.
Bien au contraire : c'est au nom dela raison, de la vraisemblance et de la bienséance qu'ils critiquent les auteurs anciens.
Leur triomphe réduit leclassicisme à n'être plus qu'une codification du langage littéraire qui aboutit à fixer le vocabulaire réservé à chaquegenre : mots « nobles » pour les genres nobles, mots « bas » pour les autres.
Ces conventions, visibles dans laprose de Fénelon comme dans les tragédies de Voltaire, rendront presque impossibles l'originalité, l'invention et lapoésie.
Cet art classique appauvri se perpétuera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le baroque (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée) ENTRE RENAISSANCE ET CLASSICISME
- LE CLASSICISME FRANÇAIS (Exposé – Art & Littérature – Collège/Lycée)
- classicisme - littérature.
- Bergson, dans un article publié en 1923, estime la France "prénétrée de classicisme, d'un classicisme qui a fait la netteté de son romantisme". Vous semble-t-il que la littérature française ait en effet toujours préservé l'essentiel de l'apport classique ?
- Paul Valéry donne à l'écrivain ce conseil : « Entre deux mots, il faut choisir le moindre» (Tel Quel, Littérature, 1929). Vous rapprocherez cette boutade de la définition qu'André Gide propose du classicisme : « Le classicisme - et par là j'entends : le classicisme français - tend tout entier vers la litote. C'est l'art d'exprimer le plus en disant le moins. » (Billets à Angèle, 1921, dans Incidences.) Vous vous demanderez quel aspect du classicisme et, d'une façon générale, quelles po