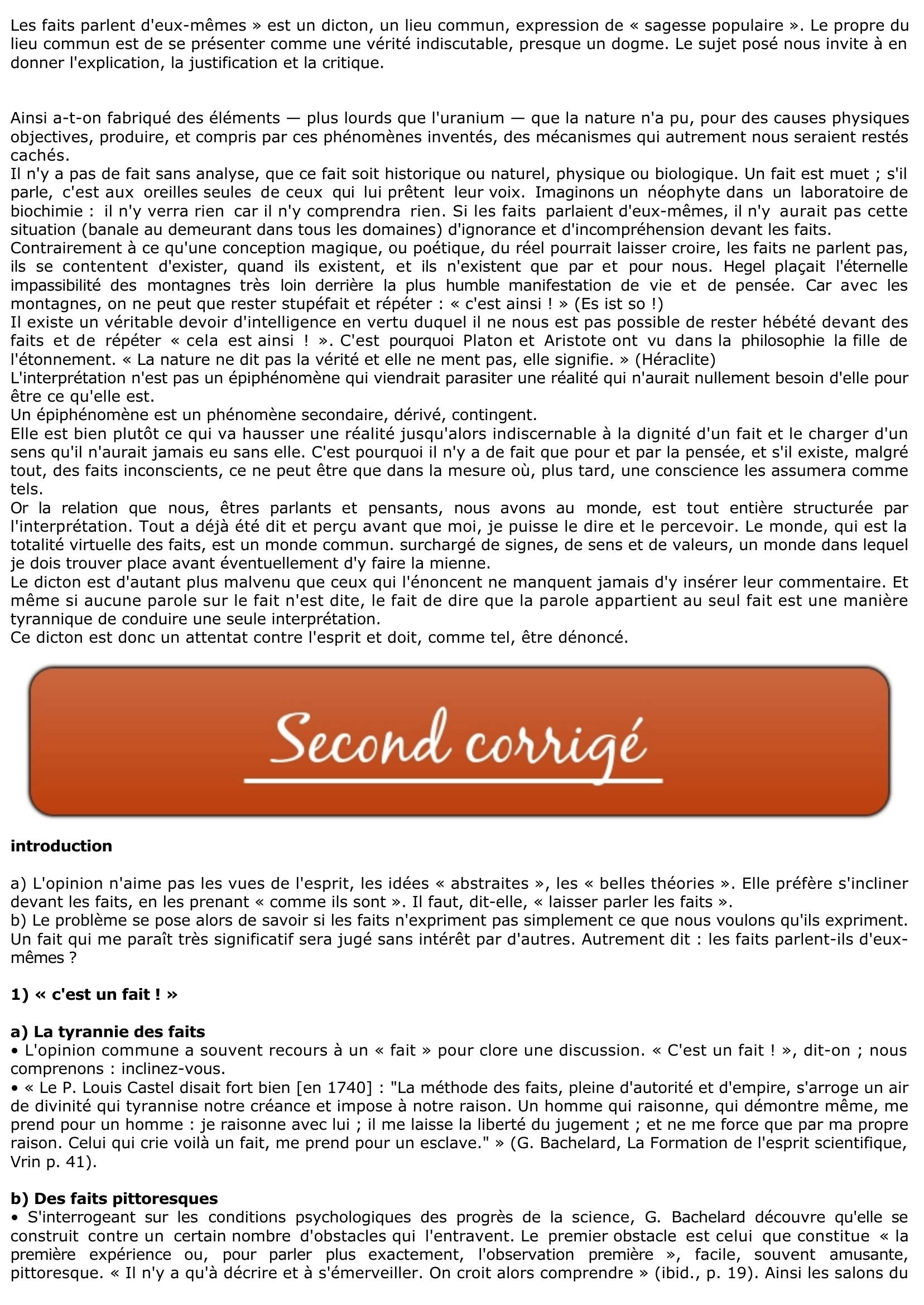Les faits parlent-ils d'eux-mêmes ?
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
- I) Les faits parlent d'eux-mêmes.
- II) Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes.
«
Les faits parlent d'eux-mêmes » est un dicton, un lieu commun, expression de « sagesse populaire ».
Le propre dulieu commun est de se présenter comme une vérité indiscutable, presque un dogme.
Le sujet posé nous invite à endonner l'explication, la justification et la critique.
Ainsi a-t-on fabriqué des éléments — plus lourds que l'uranium — que la nature n'a pu, pour des causes physiquesobjectives, produire, et compris par ces phénomènes inventés, des mécanismes qui autrement nous seraient restéscachés.Il n'y a pas de fait sans analyse, que ce fait soit historique ou naturel, physique ou biologique.
Un fait est muet ; s'ilparle, c'est aux oreilles seules de ceux qui lui prêtent leur voix.
Imaginons un néophyte dans un laboratoire debiochimie : il n'y verra rien car il n'y comprendra rien.
Si les faits parlaient d'eux-mêmes, il n'y aurait pas cettesituation (banale au demeurant dans tous les domaines) d'ignorance et d'incompréhension devant les faits.Contrairement à ce qu'une conception magique, ou poétique, du réel pourrait laisser croire, les faits ne parlent pas,ils se contentent d'exister, quand ils existent, et ils n'existent que par et pour nous.
Hegel plaçait l'éternelleimpassibilité des montagnes très loin derrière la plus humble manifestation de vie et de pensée.
Car avec lesmontagnes, on ne peut que rester stupéfait et répéter : « c'est ainsi ! » (Es ist so !)Il existe un véritable devoir d'intelligence en vertu duquel il ne nous est pas possible de rester hébété devant desfaits et de répéter « cela est ainsi ! ».
C'est pourquoi Platon et Aristote ont vu dans la philosophie la fille del'étonnement.
« La nature ne dit pas la vérité et elle ne ment pas, elle signifie.
» (Héraclite)L'interprétation n'est pas un épiphénomène qui viendrait parasiter une réalité qui n'aurait nullement besoin d'elle pourêtre ce qu'elle est.Un épiphénomène est un phénomène secondaire, dérivé, contingent.Elle est bien plutôt ce qui va hausser une réalité jusqu'alors indiscernable à la dignité d'un fait et le charger d'unsens qu'il n'aurait jamais eu sans elle.
C'est pourquoi il n'y a de fait que pour et par la pensée, et s'il existe, malgrétout, des faits inconscients, ce ne peut être que dans la mesure où, plus tard, une conscience les assumera commetels.Or la relation que nous, êtres parlants et pensants, nous avons au monde, est tout entière structurée parl'interprétation.
Tout a déjà été dit et perçu avant que moi, je puisse le dire et le percevoir.
Le monde, qui est latotalité virtuelle des faits, est un monde commun.
surchargé de signes, de sens et de valeurs, un monde dans lequelje dois trouver place avant éventuellement d'y faire la mienne.Le dicton est d'autant plus malvenu que ceux qui l'énoncent ne manquent jamais d'y insérer leur commentaire.
Etmême si aucune parole sur le fait n'est dite, le fait de dire que la parole appartient au seul fait est une manièretyrannique de conduire une seule interprétation.Ce dicton est donc un attentat contre l'esprit et doit, comme tel, être dénoncé.
introduction
a) L'opinion n'aime pas les vues de l'esprit, les idées « abstraites », les « belles théories ».
Elle préfère s'inclinerdevant les faits, en les prenant « comme ils sont ».
Il faut, dit-elle, « laisser parler les faits ».b) Le problème se pose alors de savoir si les faits n'expriment pas simplement ce que nous voulons qu'ils expriment.Un fait qui me paraît très significatif sera jugé sans intérêt par d'autres.
Autrement dit : les faits parlent-ils d'eux-mêmes ?
1) « c'est un fait ! »
a) La tyrannie des faits• L'opinion commune a souvent recours à un « fait » pour clore une discussion.
« C'est un fait ! », dit-on ; nouscomprenons : inclinez-vous.• « Le P.
Louis Castel disait fort bien [en 1740] : "La méthode des faits, pleine d'autorité et d'empire, s'arroge un airde divinité qui tyrannise notre créance et impose à notre raison.
Un homme qui raisonne, qui démontre même, meprend pour un homme : je raisonne avec lui ; il me laisse la liberté du jugement ; et ne me force que par ma propreraison.
Celui qui crie voilà un fait, me prend pour un esclave." » (G.
Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique,Vrin p.
41).
b) Des faits pittoresques• S'interrogeant sur les conditions psychologiques des progrès de la science, G.
Bachelard découvre qu'elle seconstruit contre un certain nombre d'obstacles qui l'entravent.
Le premier obstacle est celui que constitue « lapremière expérience ou, pour parler plus exactement, l'observation première », facile, souvent amusante,pittoresque.
« Il n'y a qu'à décrire et à s'émerveiller.
On croit alors comprendre » (ibid., p.
19).
Ainsi les salons du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- [L'historien doit choisir entre les faits] Valéry
- ln medias res / Au milieu des faits
- pourquoi la littérature s’est-elle passionnée pour les récits de faits divers ? Qu’apporte le point de vue de l’écrivain ?
- pourquoi la littérature s’est-elle passionnée pour les récits de faits divers ? Qu’apporte le point de vue de l’écrivain ?
- PANTAGRUEL (les Horribles et Épouvantables Faits et Prouesses du très renommé).