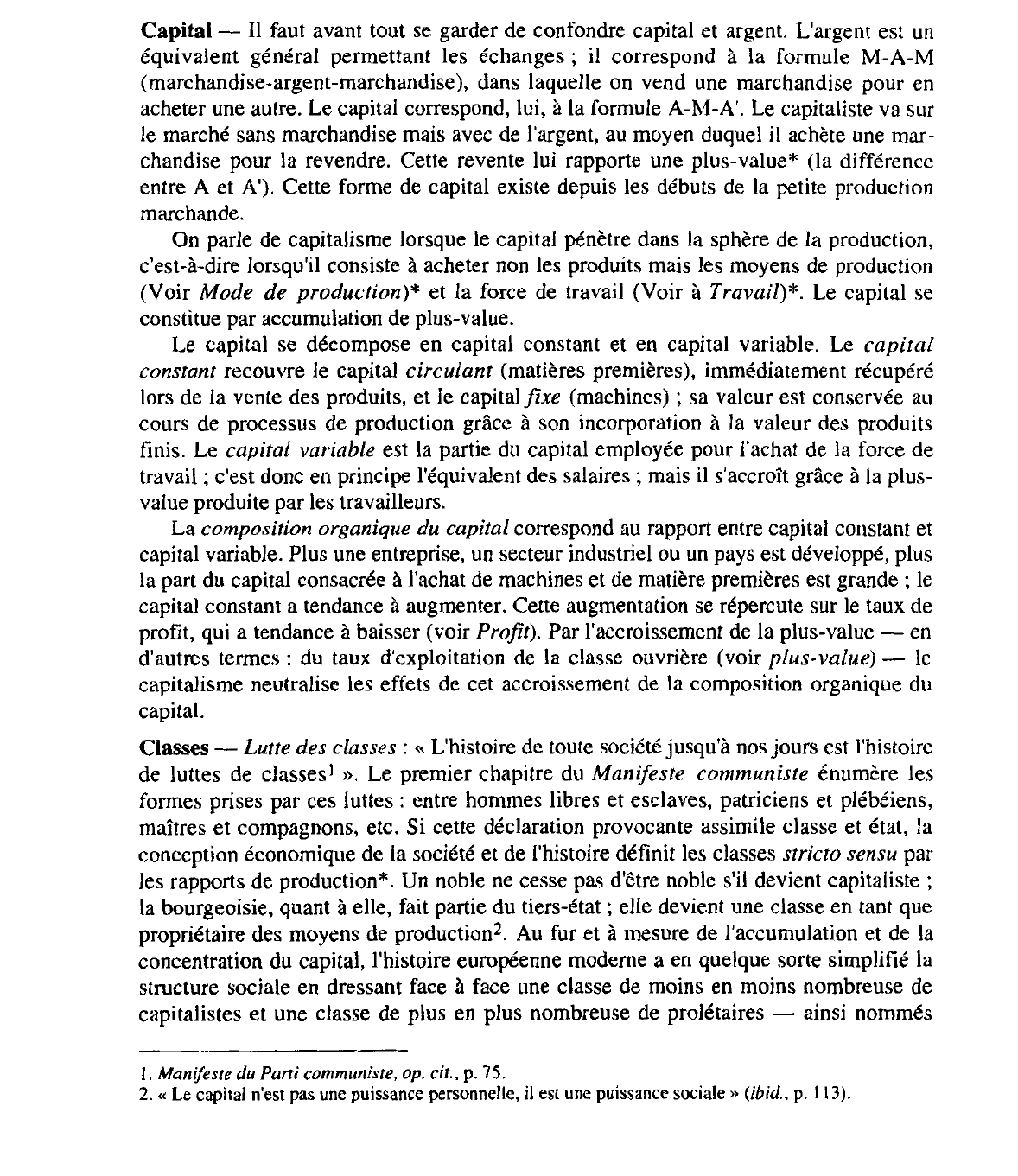Les grands concepts de la pensée de Marx
Publié le 22/03/2015

Extrait du document
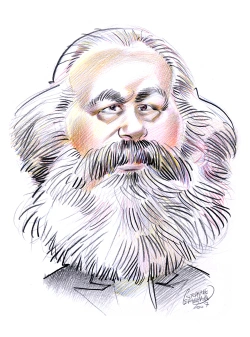
Dans la Contribution à la critique de l'économie politique Marx parle plus précisément de la «structure économique de la société« constituée par les rapports de production*.
Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en général.
Il ne faut pas pour autant faire de la superstructure le simple reflet ; la conscience s'explique «par les contradictions de la vie matérielles« et traduit ces contradictions dans son propre langage, selon ses propres catégories.
Aussi la superstructure possède-t-elle une autonomie relative, qui se traduit par un rythme de transformation propre.
Voir l'introduction théorique, en particulier pp. 13 sq et 20 sq.
Contribution à la critique de l'économie politique, op.
Capital --- Il faut avant tout se garder de confondre capital et argent.
L'argent est un équivalent général permettant les échanges ; il correspond à la formule M-A-M (marchandise-argent-marchandise), dans laquelle on vend une marchandise pour en acheter une autre.
Le capital correspond, lui, à la formule A-M-A.
Le capitaliste va sur le marché sans marchandise mais avec de l'argent, au moyen duquel il achète une marchandise pour la revendre.
Cette revente lui rapporte une plus-value* (la différence entre A et A).
Cette forme de capital existe depuis les débuts de la petite production marchande.
On parle de capitalisme lorsque le capital pénètre dans la sphère de la production, c'est-à-dire lorsqu'il consiste à acheter non les produits mais les moyens de production (Voir Mode de production)* et la force de travail (Voir à Travail)*.
Le capital se constitue par accumulation de plus-value.
Le capital se décompose en capital constant et en capital variable.
Le capital constant recouvre le capital circulant (matières premières), immédiatement récupéré lors de la vente des produits, et le capital fixe (machines) ; sa valeur est conservée au cours de processus de production grâce à son incorporation à la valeur des produits finis.
Le capital variable est la partie du capital employée pour l'achat de la force de travail ; c'est donc en principe l'équivalent des salaires ; mais il s'accroît grâce à la plus-value produite par les travailleurs.
Par l'accroissement de la plus-value --- en d'autres termes : du taux d'exploitation de la classe ouvrière (voir plus-value) --- le capitalisme neutralise les effets de cet accroissement de la composition organique du capital.
Classes --- Lutte des classes : «L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de luttes de classes«.
Dans la démarche hégélienne de l'Introduction, la classe en soi (économique) doit devenir classe pour soi (consciente de soi, apte à s'organiser et à agir) ; le Manifeste définit de même ainsi la lutte de classes : «Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis prolétariens : constitution du prolétariat en classe, renversement de la domination de la bourgeoisie, conquête du pouvoir politique par le prolétariat«.
Communisme --- «Le communisme se distingue de tous les mouvements qui l'ont précédé jusqu'ici en ce qu'il bouleverse la base de tous les rapports de production* et d'échanges antérieurs et que, pour la première fois, il traite consciemment toutes les conditions naturelles préalables comme des créations des hommes qui nous ont précédés jusqu'ici, qu'il dépouille celles-ci de leur caractère naturel et les soumet à la puissance des individus unis3«.
ralité spécifique et jouit donc d'une autonomie relative ; il peut donc non seulement y avoir (il y a toujours) des décalages entre l'économique, le politique et l'idéologique mais ces décalages sont des composantes essentielles des contradictions qui constituent le moteur de la marche dialectique de l'histoire.
L'économie de l'homme étant la clef de l'économie du singe, le stade le plus développé de l'évolution portant donc cette dernière vers sa forme la plus caractéristique.
Marx propose du mode de production une définition reposant sur la détermination en dernière instance par l'économique, telle qu'elle se manifeste sans voile idéologique ou politique dans le capitalisme.
Le mode de production se définit donc, à la lumière de ce dernier, par une relation triangulaire entre le travailleur, le non-travailleur et les moyens de production.
Ces derniers recouvrent les objets du travail (les matières premières) et les moyens du travail (outils, machines, etc.).
La relation entre le non-travailleur et les moyens de production est de tout autre nature : c'est une relation de propriété.
Or, cette seconde relation en entraîne inévitablement une troisième : entre le travailleur et le non-travailleur.
Tandis que la première relation recouvre les forces productives*, cette troisième relation introduit comme caractéristique constitutive de tout mode de production des rapports de production* déterminés.
Les modes de production qui se sont succédés dans l'histoire se laissent définir par une économie à chaque fois différente des relations entre travailleur, non-travailleur et moyens de production.
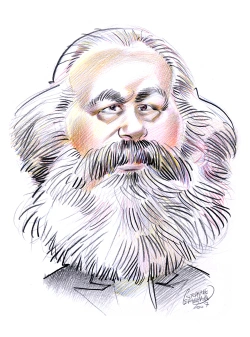
«
Vocabulaire 57
Capital - Il faut avant tout se garder de confondre capital et argent.
L'argent est un
équivalent général permettant les échanges; il correspond à la formule M-A-M
(marchandise-argent-marchandise), dans laquelle on vend une marchandise pour en
acheter une autre.
Le capital correspond, lui, à la formule A-M-A'.
Le capitaliste va sur
le marché sans marchandise mais avec de l'argent, au moyen duquel il achète une mar
chandise pour la revendre.
Cette revente lui rapporte une plus-value* (la différence
entre A et A').
Cette forme de capital existe depuis les débuts de la petite production
marchande.
On parle de capitalisme lorsque le capital pénètre dans la sphère de la production,
c'est-à-dire lorsqu'il consiste à acheter non les produits mais les moyens de production
(Voir
Mode de production)* et la force de travail (Voir à Travail)*.
Le capital se
constitue par accumulation de plus-value.
Le capital se décompose en capital constant et en capital variable.
Le
capital
constant recouvre le capital circulant (matières premières), immédiatement récupéré
lors de la vente des produits, et le capital
fixe (machines) ; sa valeur est conservée au
cours de processus de production grâce à son incorporation à la valeur des produits
finis.
Le
capital variable est la partie du capital employée pour l'achat de la force de
travail ; c'est donc en principe l'équivalent des salaires ; mais
il s'accroît grâce à la plus
value produite par les travailleurs.
La
composition organique du capital correspond au rapport entre capital constant et
capital variable.
Plus une entreprise, un secteur industriel ou un pays est développé, plus
la part
du capital consacrée à l'achat de machines et de matière premières est grande ; le
capital constant a tendance à augmenter.
Cette augmentation se répercute sur
le taux de
profit, qui a tendance à baisser (voir
Profit).
Par l'accroissement de la plus-value -en
d'autres termes :
du taux d'exploitation de la classe ouvrière (voir plus-value) - le
capitalisme neutralise les effets de cet accroissement de la composition organique
du
capital.
Classes - Lutte des classes : « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire
de luttes de classes!
».
Le premier chapitre du Manifeste communiste énumère les
formes prises par ces luttes : entre hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens,
maîtres et compagnons, etc.
Si cette déclaration
provocante assimile classe et état, la
conception économique de la société et de l'histoire définit les classes
stricto sensu par
les rapports de production*.
Un noble ne cesse pas d'être noble s'il devient capitaliste ;
la bourgeoisie, quant à elle, fait partie
du tiers-état ; elle devient une classe en tant que
propriétaire des moyens de production2.
Au fur et à mesure de l'accumulation et de la
concentration du capital, l'histoire européenne moderne a en quelque sorte simplifié la
structure sociale en dressant face à face une classe de moins en moins nombreuse de
capitalistes et une classe de plus en plus nombreuse de prolétaires -ainsi nommés
1.
Manifeste du Parti communiste, op.
cit., p.
75.
2.
«Le capital n'est pas une puissance personnelle, il est une puissance sociale» (ibid., p.
113)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commenter ou discuter cette pensée de Renouvier : « La morale et les mathématiques ont cela de commun que, pour exister en tant que sciences, elles doivent se fonder sur de purs concepts. L'expérience et l’histoire sont plus loin de représenter les lois de la morale que la nature ne l’est de réaliser exactement les Idées mathématiques »
- Les concepts de la pensée de Hegel: définitions
- Les concepts de la pensée de David Hume
- Les concepts de la pensée d'Aristote
- Concepts de la pensée de Rousseau