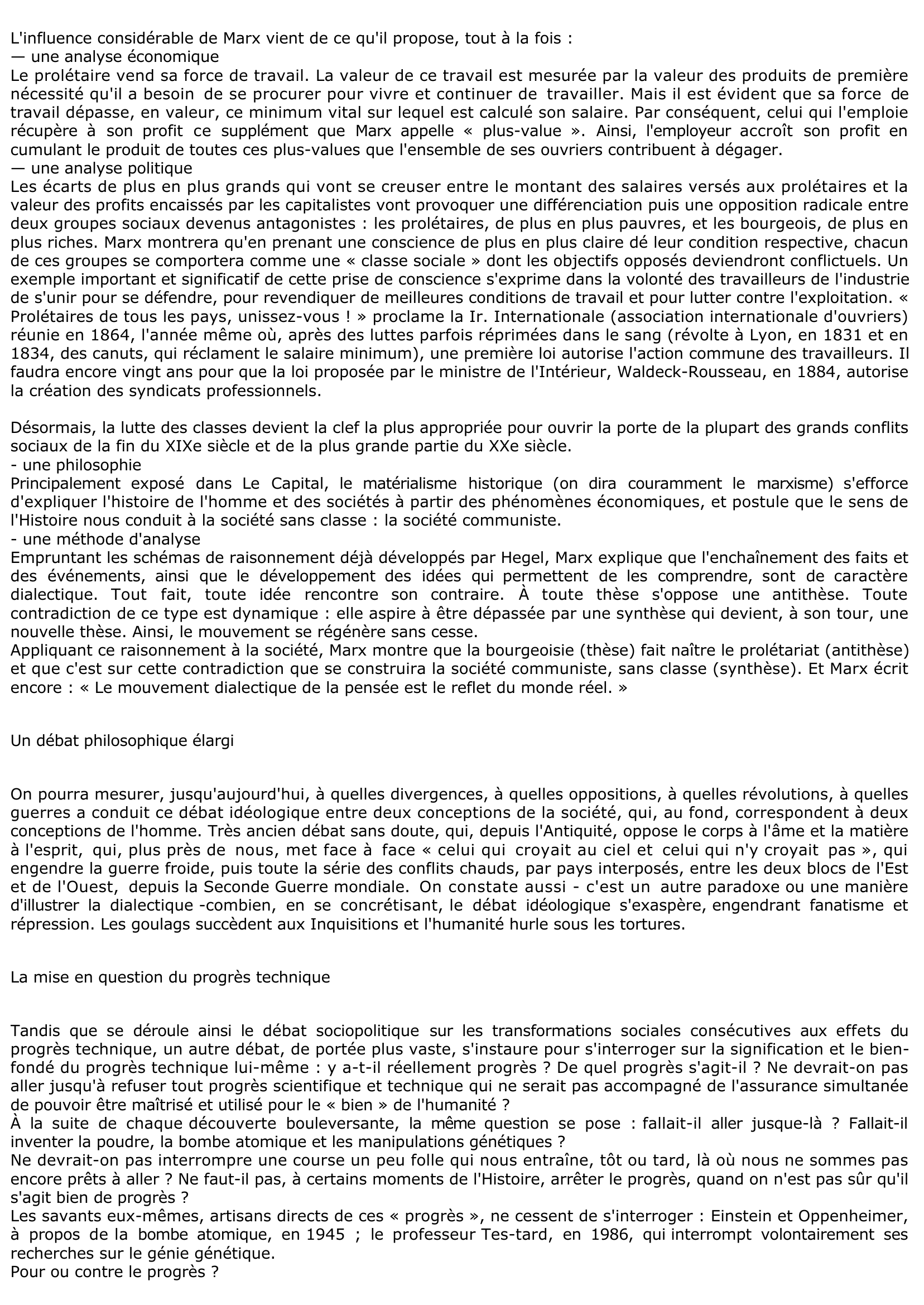LES PROBLÈMES DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
Publié le 12/06/2011

Extrait du document
Dans ces conditions, la rançon du progrès paraît tellement lourde et insupportable à payer, que les premières réactions sociales vont apparaître, dès le début du XIXe siècle. Les masses ouvrières, prenant peu à peu conscience de l'exploitation dont elles sont l'objet, vont réagir. Par ailleurs, un certain nombre de penseurs vont exprimer une opposition politique et idéologique de plus en plus ferme et active à l'égard d'une organisation sociale qui renforce la puissance des uns en accroissant la soumission des autres. Les thèmes principaux de la Révolution de 1789, évoquant la justice, l'égalité et la liberté, se trouveront repris et ravivés lors des révoltes ou révolutions de 1830, 1848 et 1870. Une idéologie socialiste, dénonçant les inégalités sociales et proposant une société démocratique, s'exprime pour s'opposer de plus en plus ouvertement à une philosophie représentative des valeurs traditionnelles (religion et royauté), et soucieuse de préserver les privilèges substantiels acquis au nom d'une politique expansionniste libérale. Le débat philosophique, ainsi engendré, sera profond et durable. Après plus d'un siècle, il continue d'animer la vie intellectuelle et politique occidentale.
«
L'influence considérable de Marx vient de ce qu'il propose, tout à la fois :— une analyse économiqueLe prolétaire vend sa force de travail.
La valeur de ce travail est mesurée par la valeur des produits de premièrenécessité qu'il a besoin de se procurer pour vivre et continuer de travailler.
Mais il est évident que sa force detravail dépasse, en valeur, ce minimum vital sur lequel est calculé son salaire.
Par conséquent, celui qui l'emploierécupère à son profit ce supplément que Marx appelle « plus-value ».
Ainsi, l'employeur accroît son profit encumulant le produit de toutes ces plus-values que l'ensemble de ses ouvriers contribuent à dégager.— une analyse politiqueLes écarts de plus en plus grands qui vont se creuser entre le montant des salaires versés aux prolétaires et lavaleur des profits encaissés par les capitalistes vont provoquer une différenciation puis une opposition radicale entredeux groupes sociaux devenus antagonistes : les prolétaires, de plus en plus pauvres, et les bourgeois, de plus enplus riches.
Marx montrera qu'en prenant une conscience de plus en plus claire dé leur condition respective, chacunde ces groupes se comportera comme une « classe sociale » dont les objectifs opposés deviendront conflictuels.
Unexemple important et significatif de cette prise de conscience s'exprime dans la volonté des travailleurs de l'industriede s'unir pour se défendre, pour revendiquer de meilleures conditions de travail et pour lutter contre l'exploitation.
«Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » proclame la Ir.
Internationale (association internationale d'ouvriers)réunie en 1864, l'année même où, après des luttes parfois réprimées dans le sang (révolte à Lyon, en 1831 et en1834, des canuts, qui réclament le salaire minimum), une première loi autorise l'action commune des travailleurs.
Ilfaudra encore vingt ans pour que la loi proposée par le ministre de l'Intérieur, Waldeck-Rousseau, en 1884, autorisela création des syndicats professionnels.
Désormais, la lutte des classes devient la clef la plus appropriée pour ouvrir la porte de la plupart des grands conflitssociaux de la fin du XIXe siècle et de la plus grande partie du XXe siècle.- une philosophiePrincipalement exposé dans Le Capital, le matérialisme historique (on dira couramment le marxisme) s'efforced'expliquer l'histoire de l'homme et des sociétés à partir des phénomènes économiques, et postule que le sens del'Histoire nous conduit à la société sans classe : la société communiste.- une méthode d'analyseEmpruntant les schémas de raisonnement déjà développés par Hegel, Marx explique que l'enchaînement des faits etdes événements, ainsi que le développement des idées qui permettent de les comprendre, sont de caractèredialectique.
Tout fait, toute idée rencontre son contraire.
À toute thèse s'oppose une antithèse.
Toutecontradiction de ce type est dynamique : elle aspire à être dépassée par une synthèse qui devient, à son tour, unenouvelle thèse.
Ainsi, le mouvement se régénère sans cesse.Appliquant ce raisonnement à la société, Marx montre que la bourgeoisie (thèse) fait naître le prolétariat (antithèse)et que c'est sur cette contradiction que se construira la société communiste, sans classe (synthèse).
Et Marx écritencore : « Le mouvement dialectique de la pensée est le reflet du monde réel.
»
Un débat philosophique élargi
On pourra mesurer, jusqu'aujourd'hui, à quelles divergences, à quelles oppositions, à quelles révolutions, à quellesguerres a conduit ce débat idéologique entre deux conceptions de la société, qui, au fond, correspondent à deuxconceptions de l'homme.
Très ancien débat sans doute, qui, depuis l'Antiquité, oppose le corps à l'âme et la matièreà l'esprit, qui, plus près de nous, met face à face « celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas », quiengendre la guerre froide, puis toute la série des conflits chauds, par pays interposés, entre les deux blocs de l'Estet de l'Ouest, depuis la Seconde Guerre mondiale.
On constate aussi - c'est un autre paradoxe ou une manièred'illustrer la dialectique -combien, en se concrétisant, le débat idéologique s'exaspère, engendrant fanatisme etrépression.
Les goulags succèdent aux Inquisitions et l'humanité hurle sous les tortures.
La mise en question du progrès technique
Tandis que se déroule ainsi le débat sociopolitique sur les transformations sociales consécutives aux effets duprogrès technique, un autre débat, de portée plus vaste, s'instaure pour s'interroger sur la signification et le bien-fondé du progrès technique lui-même : y a-t-il réellement progrès ? De quel progrès s'agit-il ? Ne devrait-on pasaller jusqu'à refuser tout progrès scientifique et technique qui ne serait pas accompagné de l'assurance simultanéede pouvoir être maîtrisé et utilisé pour le « bien » de l'humanité ?À la suite de chaque découverte bouleversante, la même question se pose : fallait-il aller jusque-là ? Fallait-ilinventer la poudre, la bombe atomique et les manipulations génétiques ?Ne devrait-on pas interrompre une course un peu folle qui nous entraîne, tôt ou tard, là où nous ne sommes pasencore prêts à aller ? Ne faut-il pas, à certains moments de l'Histoire, arrêter le progrès, quand on n'est pas sûr qu'ils'agit bien de progrès ?Les savants eux-mêmes, artisans directs de ces « progrès », ne cessent de s'interroger : Einstein et Oppenheimer,à propos de la bombe atomique, en 1945 ; le professeur Tes-tard, en 1986, qui interrompt volontairement sesrecherches sur le génie génétique.Pour ou contre le progrès ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- D’une société industrielle vers une société de communication.
- Solitude, société, communauté. Des problèmes que posent ces trois notions.
- SEITA (Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes).
- Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes [Seita] (entreprise).
- L'affiche est un moyen de communication de masse créé par la société industrielle.