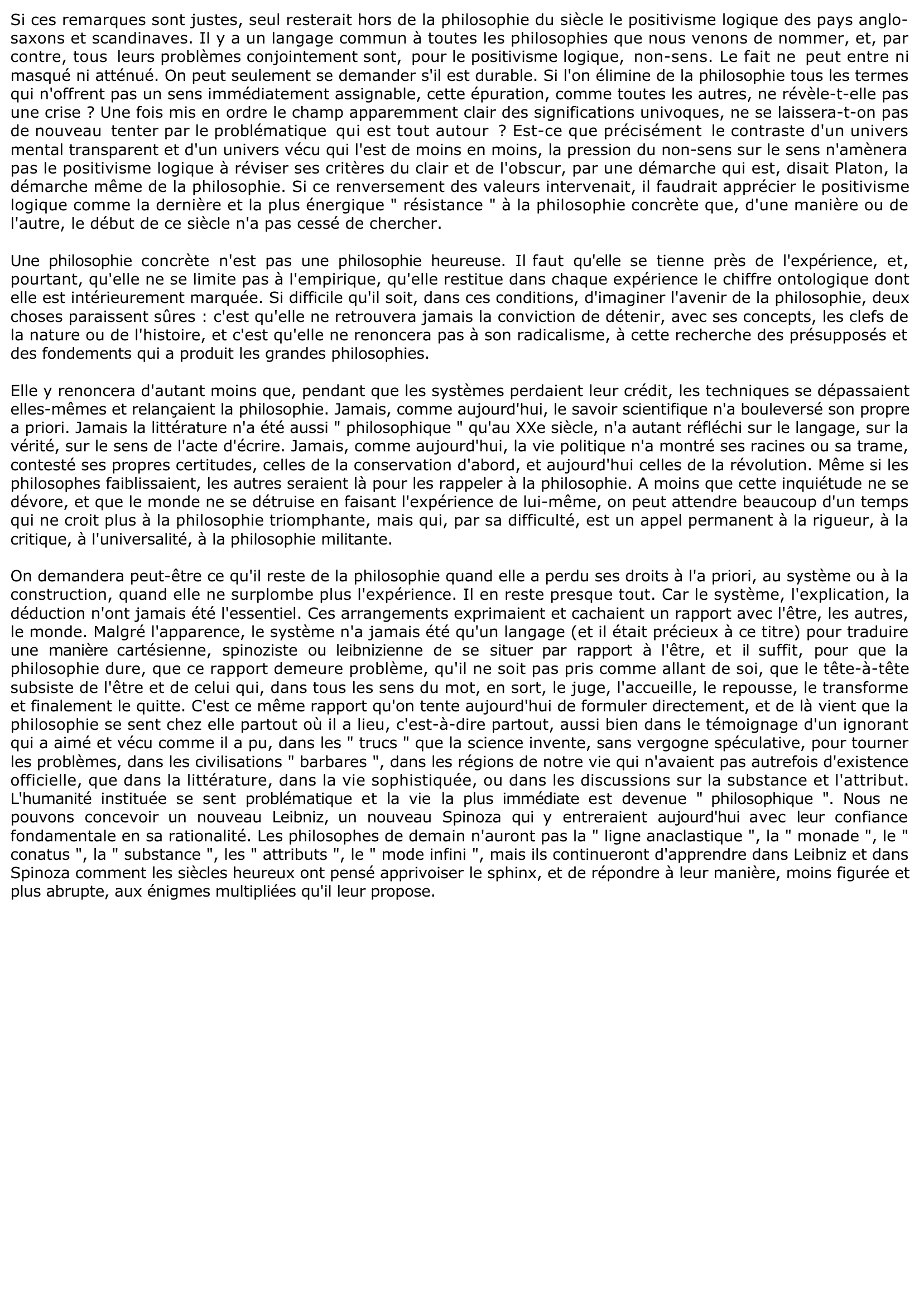L'existence et la dialectique
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
Si ces remarques sont justes, seul resterait hors de la philosophie du siècle le positivisme logique des pays anglo-saxons et scandinaves.
Il y a un langage commun à toutes les philosophies que nous venons de nommer, et, parcontre, tous leurs problèmes conjointement sont, pour le positivisme logique, non-sens.
Le fait ne peut entre nimasqué ni atténué.
On peut seulement se demander s'il est durable.
Si l'on élimine de la philosophie tous les termesqui n'offrent pas un sens immédiatement assignable, cette épuration, comme toutes les autres, ne révèle-t-elle pasune crise ? Une fois mis en ordre le champ apparemment clair des significations univoques, ne se laissera-t-on pasde nouveau tenter par le problématique qui est tout autour ? Est-ce que précisément le contraste d'un universmental transparent et d'un univers vécu qui l'est de moins en moins, la pression du non-sens sur le sens n'amènerapas le positivisme logique à réviser ses critères du clair et de l'obscur, par une démarche qui est, disait Platon, ladémarche même de la philosophie.
Si ce renversement des valeurs intervenait, il faudrait apprécier le positivismelogique comme la dernière et la plus énergique " résistance " à la philosophie concrète que, d'une manière ou del'autre, le début de ce siècle n'a pas cessé de chercher.
Une philosophie concrète n'est pas une philosophie heureuse.
Il faut qu'elle se tienne près de l'expérience, et,pourtant, qu'elle ne se limite pas à l'empirique, qu'elle restitue dans chaque expérience le chiffre ontologique dontelle est intérieurement marquée.
Si difficile qu'il soit, dans ces conditions, d'imaginer l'avenir de la philosophie, deuxchoses paraissent sûres : c'est qu'elle ne retrouvera jamais la conviction de détenir, avec ses concepts, les clefs dela nature ou de l'histoire, et c'est qu'elle ne renoncera pas à son radicalisme, à cette recherche des présupposés etdes fondements qui a produit les grandes philosophies.
Elle y renoncera d'autant moins que, pendant que les systèmes perdaient leur crédit, les techniques se dépassaientelles-mêmes et relançaient la philosophie.
Jamais, comme aujourd'hui, le savoir scientifique n'a bouleversé son proprea priori.
Jamais la littérature n'a été aussi " philosophique " qu'au XXe siècle, n'a autant réfléchi sur le langage, sur lavérité, sur le sens de l'acte d'écrire.
Jamais, comme aujourd'hui, la vie politique n'a montré ses racines ou sa trame,contesté ses propres certitudes, celles de la conservation d'abord, et aujourd'hui celles de la révolution.
Même si lesphilosophes faiblissaient, les autres seraient là pour les rappeler à la philosophie.
A moins que cette inquiétude ne sedévore, et que le monde ne se détruise en faisant l'expérience de lui-même, on peut attendre beaucoup d'un tempsqui ne croit plus à la philosophie triomphante, mais qui, par sa difficulté, est un appel permanent à la rigueur, à lacritique, à l'universalité, à la philosophie militante.
On demandera peut-être ce qu'il reste de la philosophie quand elle a perdu ses droits à l'a priori, au système ou à laconstruction, quand elle ne surplombe plus l'expérience.
Il en reste presque tout.
Car le système, l'explication, ladéduction n'ont jamais été l'essentiel.
Ces arrangements exprimaient et cachaient un rapport avec l'être, les autres,le monde.
Malgré l'apparence, le système n'a jamais été qu'un langage (et il était précieux à ce titre) pour traduireune manière cartésienne, spinoziste ou leibnizienne de se situer par rapport à l'être, et il suffit, pour que laphilosophie dure, que ce rapport demeure problème, qu'il ne soit pas pris comme allant de soi, que le tête-à-têtesubsiste de l'être et de celui qui, dans tous les sens du mot, en sort, le juge, l'accueille, le repousse, le transformeet finalement le quitte.
C'est ce même rapport qu'on tente aujourd'hui de formuler directement, et de là vient que laphilosophie se sent chez elle partout où il a lieu, c'est-à-dire partout, aussi bien dans le témoignage d'un ignorantqui a aimé et vécu comme il a pu, dans les " trucs " que la science invente, sans vergogne spéculative, pour tournerles problèmes, dans les civilisations " barbares ", dans les régions de notre vie qui n'avaient pas autrefois d'existenceofficielle, que dans la littérature, dans la vie sophistiquée, ou dans les discussions sur la substance et l'attribut.L'humanité instituée se sent problématique et la vie la plus immédiate est devenue " philosophique ".
Nous nepouvons concevoir un nouveau Leibniz, un nouveau Spinoza qui y entreraient aujourd'hui avec leur confiancefondamentale en sa rationalité.
Les philosophes de demain n'auront pas la " ligne anaclastique ", la " monade ", le "conatus ", la " substance ", les " attributs ", le " mode infini ", mais ils continueront d'apprendre dans Leibniz et dansSpinoza comment les siècles heureux ont pensé apprivoiser le sphinx, et de répondre à leur manière, moins figurée etplus abrupte, aux énigmes multipliées qu'il leur propose..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'existence et la dialectique par Maurice Merleau-Ponty Professeur au Collège de France On connaît le malaise de l'écrivain quand il lui est demandé de faire l'histoire de ses pensées.
- Dans l'existence le plus important c'est d'avoir la santé
- Choisissons nous notre existence ?
- PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU (LES), ou CONFÉRENCES SUR LES PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU
- EN DÉCOUVRANT L’EXISTENCE AVEC HUSSERL ET HEIDEGGER, 1949. Emmanuel Levinas