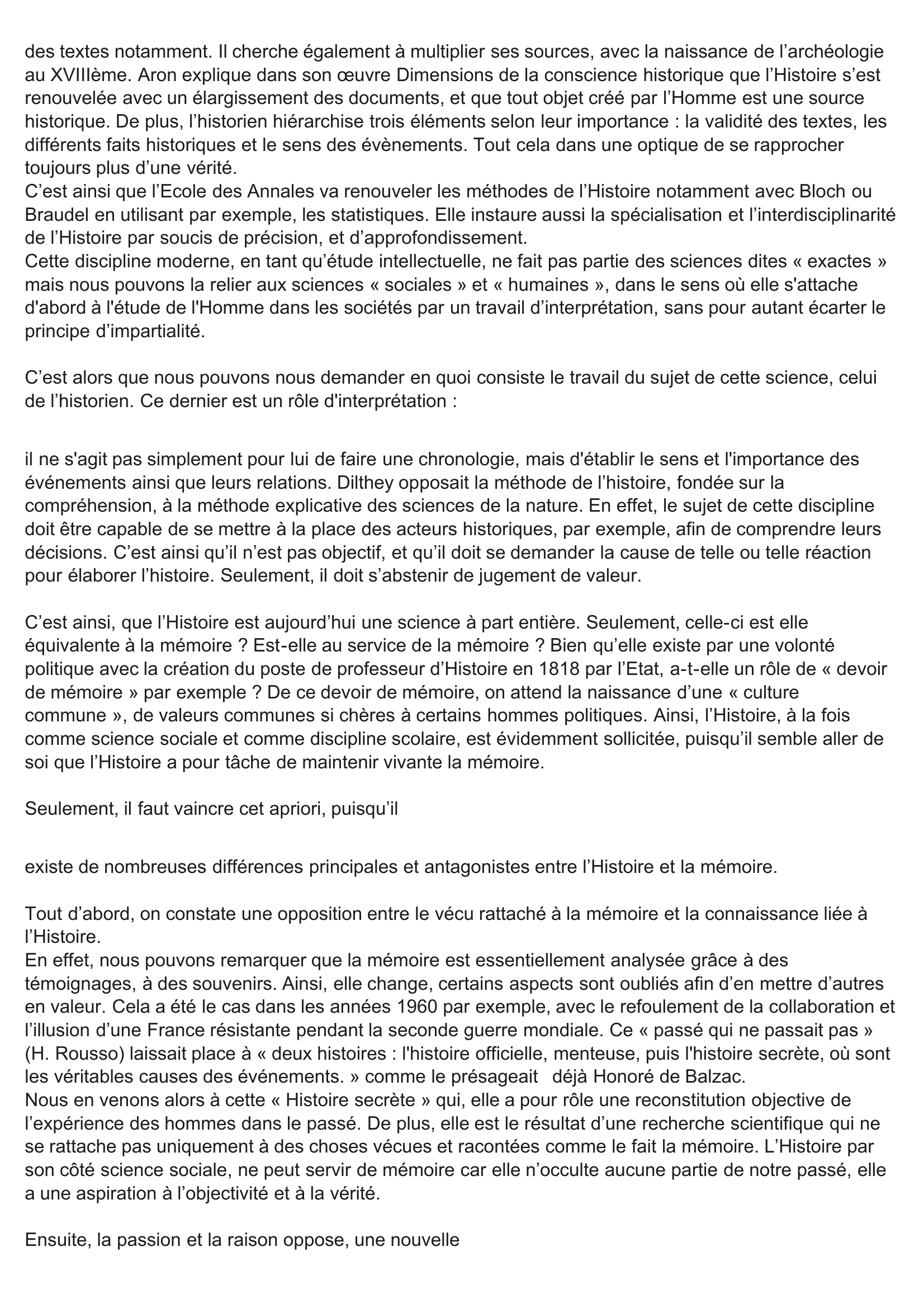L'Histoire peut elle nous servir de mémoire ?
Publié le 11/11/2012

Extrait du document

Enfin, contrairement à cette science sociale, la mémoire suppose l’oubli.
En effet, on ne peut se souvenir qu’en sélectionnant ce qui doit être oublié. En psychanalyse, et
notamment avec Freud, l'oubli est une condition de la mémoire, bien plus qu'il n'en est un défaut. On ne
peut se rappeler de tout. Ainsi, la mémoire sélectionne ses souvenirs, et c’est là que se trouve le danger :
l’oubli est quelque fois « commandé «, par exemple pour des raisons politiques, religieuses, etc. La
mémoire collective trie les évènements et ne gardent que ceux qu’elle désire.
Cependant, l’Histoire s’oppose à ce processus. En effet, tout comme en psychanalyse, cette discipline
vise à faire revenir ce qui a été oublié.
C’est ainsi que Braudel affirme que cette science doit être une « Histoire totale «.

«
des textes notamment.
Il cherche également à multiplier ses sources, avec la naissance de l’archéologie
au XVIIIème.
Aron explique dans son œuvre Dimensions de la conscience historique que l’Histoire s’est
renouvelée avec un élargissement des documents, et que tout objet créé par l’Homme est une source
historique.
De plus, l’historien hiérarchise trois éléments selon leur importance : la validité des textes, les
différents faits historiques et le sens des évènements.
Tout cela dans une optique de se rapprocher
toujours plus d’une vérité.
C’est ainsi que l’Ecole des Annales va renouveler les méthodes de l’Histoire notamment avec Bloch ou
Braudel en utilisant par exemple, les statistiques.
Elle instaure aussi la spécialisation et l’interdisciplinarité
de l’Histoire par soucis de précision, et d’approfondissement.
Cette discipline moderne, en tant qu’étude intellectuelle, ne fait pas partie des sciences dites « exactes »
mais nous pouvons la relier aux sciences « sociales » et « humaines », dans le sens où elle s'attache
d'abord à l'étude de l'Homme dans les sociétés par un travail d’interprétation, sans pour autant écarter le
principe d’impartialité.
C’est alors que nous pouvons nous demander en quoi consiste le travail du sujet de cette science, celui
de l’historien.
Ce dernier est un rôle d'interprétation :
il ne s'agit pas simplement pour lui de faire une chronologie, mais d'établir le sens et l'importance des
événements ainsi que leurs relations.
Dilthey opposait la méthode de l’histoire, fondée sur la
compréhension, à la méthode explicative des sciences de la nature.
En effet, le sujet de cette discipline
doit être capable de se mettre à la place des acteurs historiques, par exemple, afin de comprendre leurs
décisions.
C’est ainsi qu’il n’est pas objectif, et qu’il doit se demander la cause de telle ou telle réaction
pour élaborer l’histoire.
Seulement, il doit s’abstenir de jugement de valeur.
C’est ainsi, que l’Histoire est aujourd’hui une science à part entière.
Seulement, celle-ci est elle
équivalente à la mémoire ? Est -elle au service de la mémoire ? Bien qu’elle existe par une volonté
politique avec la création du poste de professeur d’Histoire en 1818 par l’Etat, a-t-elle un rôle de « devoir
de mémoire » par exemple ? De ce devoir de mémoire, on attend la naissance d’une « culture
commune », de valeurs communes si chères à certains hommes politiques.
Ainsi, l’Histoire, à la fois
comme science sociale et comme discipline scolaire, est évidemment sollicitée, puisqu’il semble aller de
soi que l’Histoire a pour tâche de maintenir vivante la mémoire.
Seulement, il faut vaincre cet apriori, puisqu’il
existe de nombreuses différences principales et antagonistes entre l’Histoire et la mémoire.
Tout d’abord, on constate une opposition entre le vécu rattaché à la mémoire et la connaissance liée à
l’Histoire.
En effet, nous pouvons remarquer que la mémoire est essentiellement analysée grâce à des
témoignages, à des souvenirs.
Ainsi, elle change, certains aspects sont oubliés afin d’en mettre d’autres
en valeur.
Cela a été le cas dans les années 1960 par exemple, avec le refoulement de la collaboration et
l’illusion d’une France résistante pendant la seconde guerre mondiale.
Ce « passé qui ne passait pas »
(H.
Rousso) laissait place à « deux histoires : l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont
les véritables causes des événements.
» comme le présageait déjà Honoré de Balzac.
Nous en venons alors à cette « Histoire secrète » qui, elle a pour rôle une reconstitution objective de
l’expérience des hommes dans le passé.
De plus, elle est le résultat d’une recherche scientifique qui ne
se rattache pas uniquement à des choses vécues et racontées comme le fait la mémoire.
L’Histoire par
son côté science sociale, ne peut servir de mémoire car elle n’occulte aucune partie de notre passé, elle
a une aspiration à l’objectivité et à la vérité.
Ensuite, la passion et la raison oppose, une nouvelle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mémoire, histoire et écriture dans l'invention du désert
- Thème 3 : Histoire et mémoire
- MÉMOIRES POUR SERVIR A L’HISTOIRE D’ANNE D’AUTRICHE de Françoise de Motteville - résumé, analyse
- MÉMOIRES SECRETS POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES de Louis Petit de Bachaumont
- MÉMOIRES POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE MA VIE Giuseppe Gorani - résumé, analyse