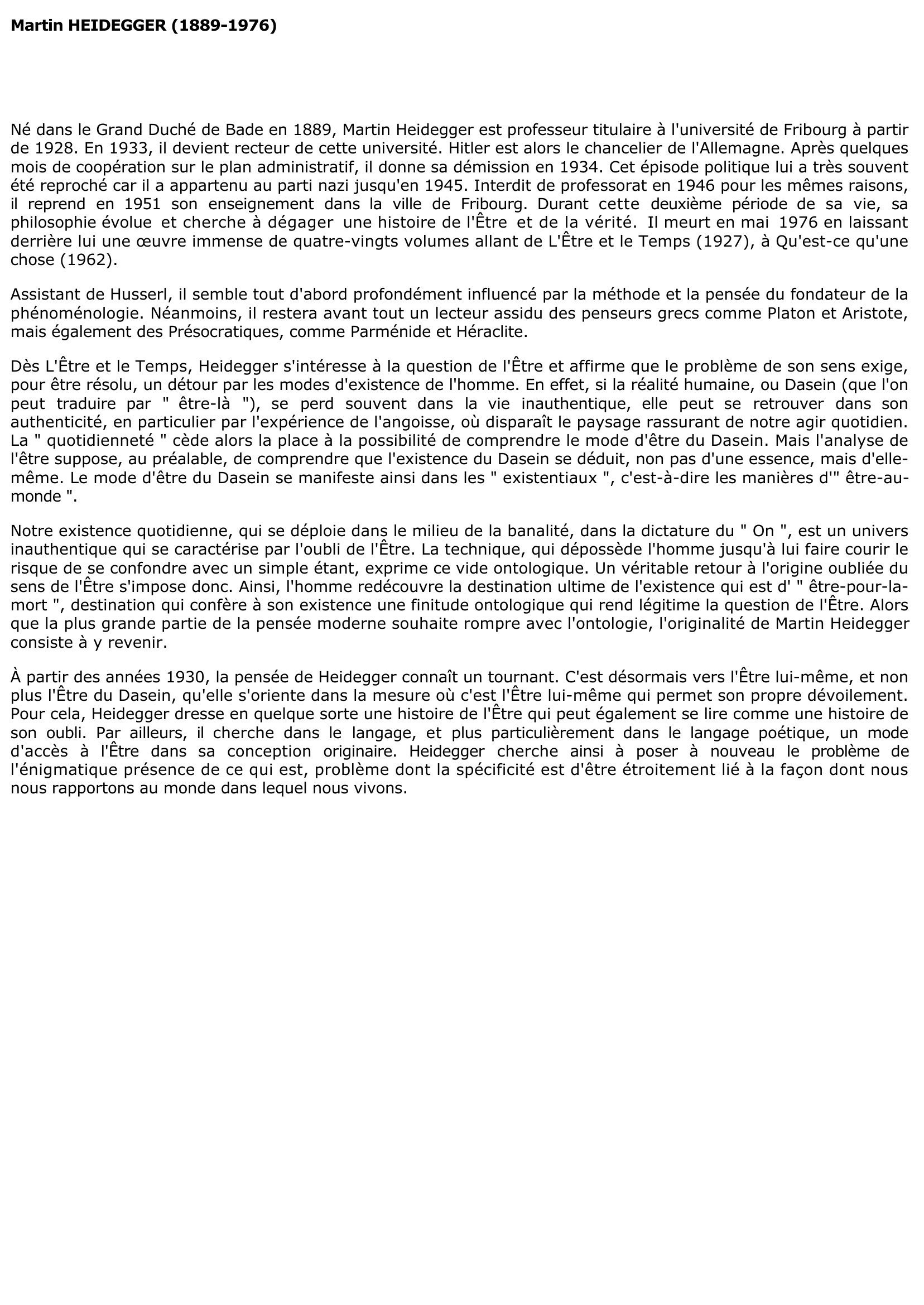Martin Heidegger: vie et oeuvre
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
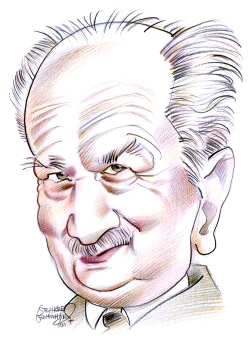
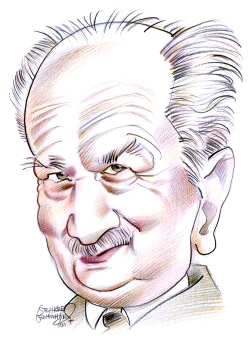
«
Martin HEIDEGGER (1889-1976)
Né dans le Grand Duché de Bade en 1889, Martin Heidegger est professeur titulaire à l'université de Fribourg à partirde 1928.
En 1933, il devient recteur de cette université.
Hitler est alors le chancelier de l'Allemagne.
Après quelquesmois de coopération sur le plan administratif, il donne sa démission en 1934.
Cet épisode politique lui a très souventété reproché car il a appartenu au parti nazi jusqu'en 1945.
Interdit de professorat en 1946 pour les mêmes raisons,il reprend en 1951 son enseignement dans la ville de Fribourg.
Durant cette deuxième période de sa vie, saphilosophie évolue et cherche à dégager une histoire de l'Être et de la vérité.
Il meurt en mai 1976 en laissantderrière lui une œuvre immense de quatre-vingts volumes allant de L'Être et le Temps (1927), à Qu'est-ce qu'unechose (1962).
Assistant de Husserl, il semble tout d'abord profondément influencé par la méthode et la pensée du fondateur de laphénoménologie.
Néanmoins, il restera avant tout un lecteur assidu des penseurs grecs comme Platon et Aristote,mais également des Présocratiques, comme Parménide et Héraclite.
Dès L'Être et le Temps, Heidegger s'intéresse à la question de l'Être et affirme que le problème de son sens exige,pour être résolu, un détour par les modes d'existence de l'homme.
En effet, si la réalité humaine, ou Dasein (que l'onpeut traduire par " être-là "), se perd souvent dans la vie inauthentique, elle peut se retrouver dans sonauthenticité, en particulier par l'expérience de l'angoisse, où disparaît le paysage rassurant de notre agir quotidien.La " quotidienneté " cède alors la place à la possibilité de comprendre le mode d'être du Dasein.
Mais l'analyse del'être suppose, au préalable, de comprendre que l'existence du Dasein se déduit, non pas d'une essence, mais d'elle-même.
Le mode d'être du Dasein se manifeste ainsi dans les " existentiaux ", c'est-à-dire les manières d'" être-au-monde ".
Notre existence quotidienne, qui se déploie dans le milieu de la banalité, dans la dictature du " On ", est un universinauthentique qui se caractérise par l'oubli de l'Être.
La technique, qui dépossède l'homme jusqu'à lui faire courir lerisque de se confondre avec un simple étant, exprime ce vide ontologique.
Un véritable retour à l'origine oubliée dusens de l'Être s'impose donc.
Ainsi, l'homme redécouvre la destination ultime de l'existence qui est d' " être-pour-la-mort ", destination qui confère à son existence une finitude ontologique qui rend légitime la question de l'Être.
Alorsque la plus grande partie de la pensée moderne souhaite rompre avec l'ontologie, l'originalité de Martin Heideggerconsiste à y revenir.
À partir des années 1930, la pensée de Heidegger connaît un tournant.
C'est désormais vers l'Être lui-même, et nonplus l'Être du Dasein, qu'elle s'oriente dans la mesure où c'est l'Être lui-même qui permet son propre dévoilement.Pour cela, Heidegger dresse en quelque sorte une histoire de l'Être qui peut également se lire comme une histoire deson oubli.
Par ailleurs, il cherche dans le langage, et plus particulièrement dans le langage poétique, un moded'accès à l'Être dans sa conception originaire.
Heidegger cherche ainsi à poser à nouveau le problème del'énigmatique présence de ce qui est, problème dont la spécificité est d'être étroitement lié à la façon dont nousnous rapportons au monde dans lequel nous vivons..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- QU’EST-CE QU’UNE CHOSE?, Martin Heidegger (résumé)
- Lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger (résumé et analyse)
- LETTRE SUR L’HUMANISME, Martin Heidegger - résumé de l'oeuvre
- KANT ET LE PROBLÈME DE LA MÉTAPHYSIQUE, Martin Heidegger - résumé de l'oeuvre
- QUESTIONS I ET II, 1968 et 1970. Martin Heidegger (résumé)