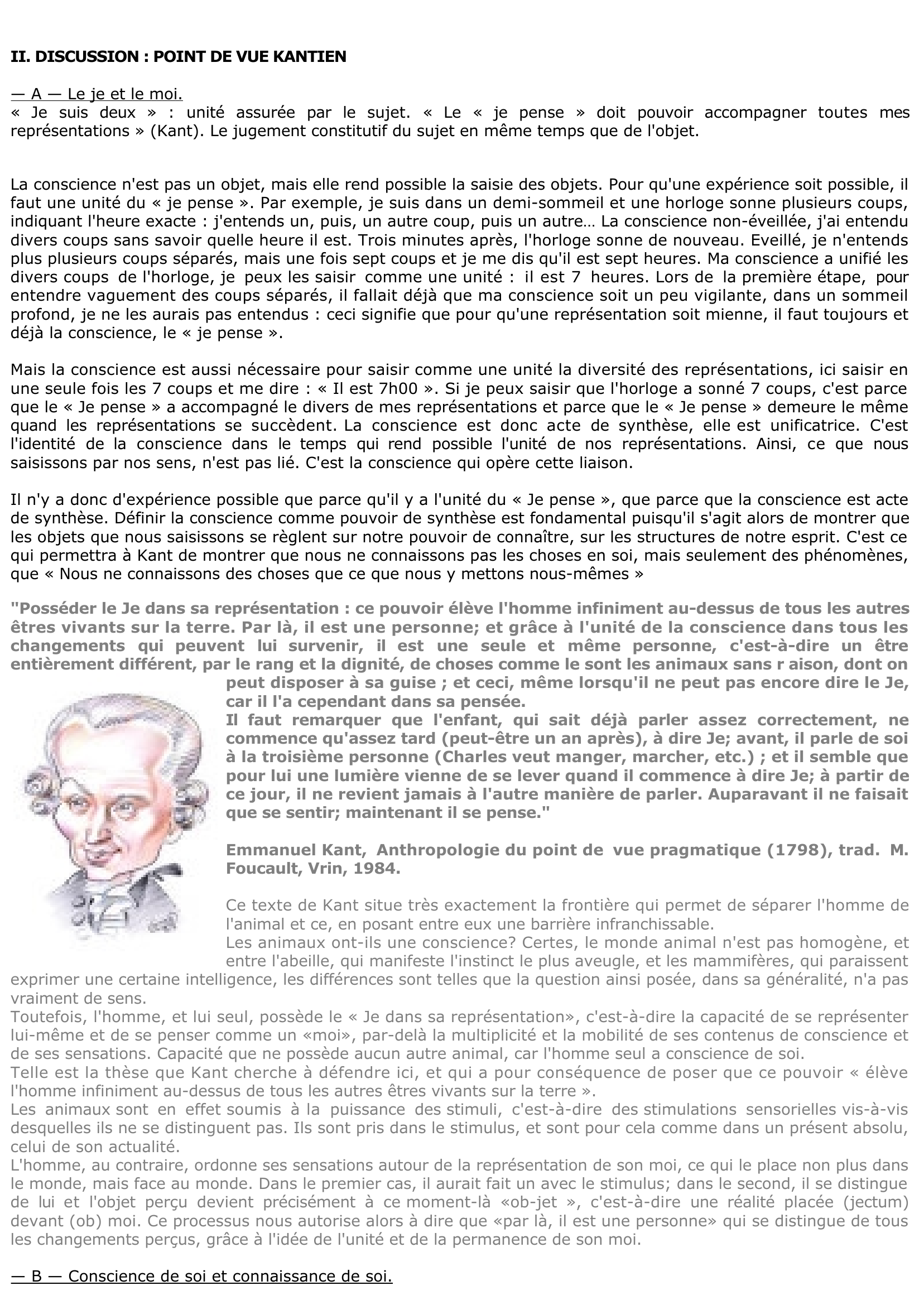« On sait bien Qu'on est le même, mais on serait fort en peine de le démontrer. Le «moi» n'est peut-être Qu'une notation commode» (Valéry).
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
II.
DISCUSSION : POINT DE VUE KANTIEN
— A — Le je et le moi.« Je suis deux » : unité assurée par le sujet.
« Le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mesreprésentations » (Kant).
Le jugement constitutif du sujet en même temps que de l'objet.
La conscience n'est pas un objet, mais elle rend possible la saisie des objets.
Pour qu'une expérience soit possible, ilfaut une unité du « je pense ».
Par exemple, je suis dans un demi-sommeil et une horloge sonne plusieurs coups,indiquant l'heure exacte : j'entends un, puis, un autre coup, puis un autre… La conscience non-éveillée, j'ai entendudivers coups sans savoir quelle heure il est.
Trois minutes après, l'horloge sonne de nouveau.
Eveillé, je n'entendsplus plusieurs coups séparés, mais une fois sept coups et je me dis qu'il est sept heures.
Ma conscience a unifié lesdivers coups de l'horloge, je peux les saisir comme une unité : il est 7 heures.
Lors de la première étape, pourentendre vaguement des coups séparés, il fallait déjà que ma conscience soit un peu vigilante, dans un sommeilprofond, je ne les aurais pas entendus : ceci signifie que pour qu'une représentation soit mienne, il faut toujours etdéjà la conscience, le « je pense ».
Mais la conscience est aussi nécessaire pour saisir comme une unité la diversité des représentations, ici saisir enune seule fois les 7 coups et me dire : « Il est 7h00 ».
Si je peux saisir que l'horloge a sonné 7 coups, c'est parceque le « Je pense » a accompagné le divers de mes représentations et parce que le « Je pense » demeure le mêmequand les représentations se succèdent.
La conscience est donc acte de synthèse, elle est unificatrice.
C'estl'identité de la conscience dans le temps qui rend possible l'unité de nos représentations.
Ainsi, ce que noussaisissons par nos sens, n'est pas lié.
C'est la conscience qui opère cette liaison.
Il n'y a donc d'expérience possible que parce qu'il y a l'unité du « Je pense », que parce que la conscience est actede synthèse.
Définir la conscience comme pouvoir de synthèse est fondamental puisqu'il s'agit alors de montrer queles objets que nous saisissons se règlent sur notre pouvoir de connaître, sur les structures de notre esprit.
C'est cequi permettra à Kant de montrer que nous ne connaissons pas les choses en soi, mais seulement des phénomènes,que « Nous ne connaissons des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes »
"Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autresêtres vivants sur la terre.
Par là, il est une personne; et grâce à l'unité de la conscience dans tous leschangements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un êtreentièrement différent, par le rang et la dignité, de choses comme le sont les animaux sans r aison, dont on peut disposer à sa guise ; et ceci, même lorsqu'il ne peut pas encore dire le Je,car il l'a cependant dans sa pensée.Il faut remarquer que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, necommence qu'assez tard (peut-être un an après), à dire Je; avant, il parle de soià la troisième personne (Charles veut manger, marcher, etc.) ; et il semble quepour lui une lumière vienne de se lever quand il commence à dire Je; à partir dece jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler.
Auparavant il ne faisaitque se sentir; maintenant il se pense."
Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), trad.
M.Foucault, Vrin, 1984.
Ce texte de Kant situe très exactement la frontière qui permet de séparer l'homme del'animal et ce, en posant entre eux une barrière infranchissable.Les animaux ont-ils une conscience? Certes, le monde animal n'est pas homogène, etentre l'abeille, qui manifeste l'instinct le plus aveugle, et les mammifères, qui paraissent exprimer une certaine intelligence, les différences sont telles que la question ainsi posée, dans sa généralité, n'a pasvraiment de sens.Toutefois, l'homme, et lui seul, possède le « Je dans sa représentation», c'est-à-dire la capacité de se représenterlui-même et de se penser comme un «moi», par-delà la multiplicité et la mobilité de ses contenus de conscience etde ses sensations.
Capacité que ne possède aucun autre animal, car l'homme seul a conscience de soi.Telle est la thèse que Kant cherche à défendre ici, et qui a pour conséquence de poser que ce pouvoir « élèvel'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre ».Les animaux sont en effet soumis à la puissance des stimuli, c'est-à-dire des stimulations sensorielles vis-à-visdesquelles ils ne se distinguent pas.
Ils sont pris dans le stimulus, et sont pour cela comme dans un présent absolu,celui de son actualité.L'homme, au contraire, ordonne ses sensations autour de la représentation de son moi, ce qui le place non plus dansle monde, mais face au monde.
Dans le premier cas, il aurait fait un avec le stimulus; dans le second, il se distinguede lui et l'objet perçu devient précisément à ce moment-là «ob-jet », c'est-à-dire une réalité placée (jectum)devant (ob) moi.
Ce processus nous autorise alors à dire que «par là, il est une personne» qui se distingue de tousles changements perçus, grâce à l'idée de l'unité et de la permanence de son moi.
— B — Conscience de soi et connaissance de soi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Examinez cette pensée de Valéry : « On sait bien qu'on est le même, mais on serait fort en peine de le démontrer. Le moi n'est peut-être qu'une notation commode. » ?
- Le moi n'est-il qu'une notation commode ?
- Paul Valéry écrit dans le Préambule pour le Catalogue
- Paul Valéry écrit dans Regards sur le monde actuel, (Propos sur le progrès, 1931 ) : « Supposé que l'immense transformation que nous vivons et qui nous meut, se développe encore, achève d'altérer ce qui subsiste des coutumes, articule tout autrement les besoins et les moyens de la vie, bientôt l'ère toute nouvelle enfantera des hommes qui ne tiendront plus au passé par aucune habitude de l'esprit. L'histoire leur offrira des récits étranges, presque incompréhensibles ; car rien dans le
- « L'homme vaut-il la peine de déranger un Dieu pour le créer » Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres. Commentez cette citation.