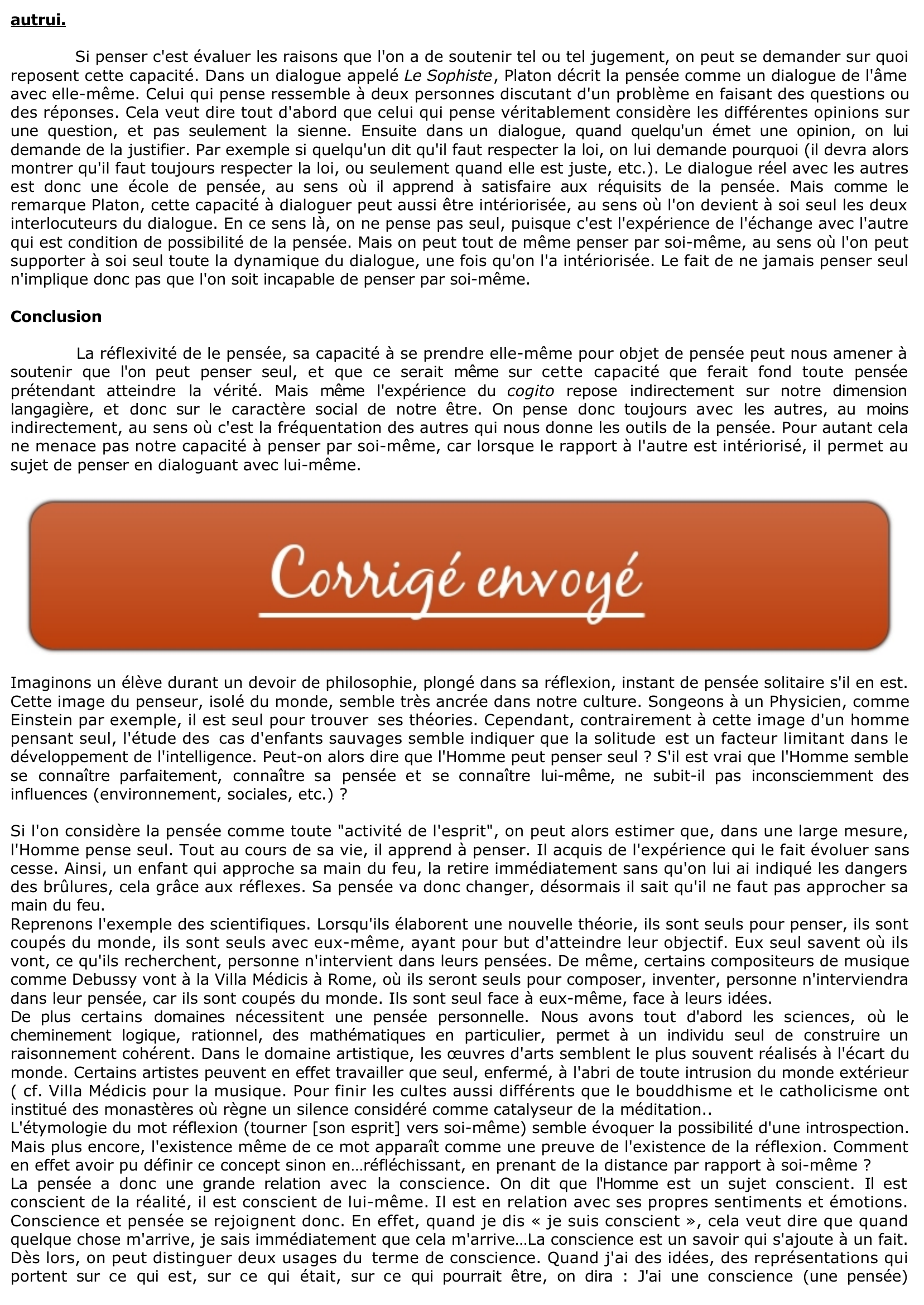Pense-t-on jamais seul?
Publié le 07/04/2005

Extrait du document
Imaginons un élève durant un devoir de philosophie, plongé dans sa réflexion, instant de pensée solitaire s’il en est. Cette image du penseur, isolé du monde, semble très ancrée dans notre culture. Songeons à un Physicien, comme Einstein par exemple, il est seul pour trouver ses théories. Cependant, contrairement à cette image d’un homme pensant seul, l’étude des cas d’enfants sauvages semble indiquer que la solitude est un facteur limitant dans le développement de l’intelligence. Peut-on alors dire que l’Homme peut penser seul ? S’il est vrai que l’Homme semble se connaître parfaitement, connaître sa pensée et se connaître lui-même, ne subit-il pas inconsciemment des influences (environnement, sociales, etc.) ?
«
autrui.
Si penser c'est évaluer les raisons que l'on a de soutenir tel ou tel jugement, on peut se demander sur quoireposent cette capacité.
Dans un dialogue appelé Le Sophiste , Platon décrit la pensée comme un dialogue de l'âme avec elle-même.
Celui qui pense ressemble à deux personnes discutant d'un problème en faisant des questions oudes réponses.
Cela veut dire tout d'abord que celui qui pense véritablement considère les différentes opinions surune question, et pas seulement la sienne.
Ensuite dans un dialogue, quand quelqu'un émet une opinion, on luidemande de la justifier.
Par exemple si quelqu'un dit qu'il faut respecter la loi, on lui demande pourquoi (il devra alorsmontrer qu'il faut toujours respecter la loi, ou seulement quand elle est juste, etc.).
Le dialogue réel avec les autresest donc une école de pensée, au sens où il apprend à satisfaire aux réquisits de la pensée.
Mais comme leremarque Platon, cette capacité à dialoguer peut aussi être intériorisée, au sens où l'on devient à soi seul les deuxinterlocuteurs du dialogue.
En ce sens là, on ne pense pas seul, puisque c'est l'expérience de l'échange avec l'autrequi est condition de possibilité de la pensée.
Mais on peut tout de même penser par soi-même, au sens où l'on peutsupporter à soi seul toute la dynamique du dialogue, une fois qu'on l'a intériorisée.
Le fait de ne jamais penser seuln'implique donc pas que l'on soit incapable de penser par soi-même.
Conclusion La réflexivité de le pensée, sa capacité à se prendre elle-même pour objet de pensée peut nous amener àsoutenir que l'on peut penser seul, et que ce serait même sur cette capacité que ferait fond toute penséeprétendant atteindre la vérité.
Mais même l'expérience du cogito repose indirectement sur notre dimension langagière, et donc sur le caractère social de notre être.
On pense donc toujours avec les autres, au moinsindirectement, au sens où c'est la fréquentation des autres qui nous donne les outils de la pensée.
Pour autant celane menace pas notre capacité à penser par soi-même, car lorsque le rapport à l'autre est intériorisé, il permet ausujet de penser en dialoguant avec lui-même.
Imaginons un élève durant un devoir de philosophie, plongé dans sa réflexion, instant de pensée solitaire s'il en est.Cette image du penseur, isolé du monde, semble très ancrée dans notre culture.
Songeons à un Physicien, commeEinstein par exemple, il est seul pour trouver ses théories.
Cependant, contrairement à cette image d'un hommepensant seul, l'étude des cas d'enfants sauvages semble indiquer que la solitude est un facteur limitant dans ledéveloppement de l'intelligence.
Peut-on alors dire que l'Homme peut penser seul ? S'il est vrai que l'Homme semblese connaître parfaitement, connaître sa pensée et se connaître lui-même, ne subit-il pas inconsciemment desinfluences (environnement, sociales, etc.) ?
Si l'on considère la pensée comme toute "activité de l'esprit", on peut alors estimer que, dans une large mesure,l'Homme pense seul.
Tout au cours de sa vie, il apprend à penser.
Il acquis de l'expérience qui le fait évoluer sanscesse.
Ainsi, un enfant qui approche sa main du feu, la retire immédiatement sans qu'on lui ai indiqué les dangersdes brûlures, cela grâce aux réflexes.
Sa pensée va donc changer, désormais il sait qu'il ne faut pas approcher samain du feu.Reprenons l'exemple des scientifiques.
Lorsqu'ils élaborent une nouvelle théorie, ils sont seuls pour penser, ils sontcoupés du monde, ils sont seuls avec eux-même, ayant pour but d'atteindre leur objectif.
Eux seul savent où ilsvont, ce qu'ils recherchent, personne n'intervient dans leurs pensées.
De même, certains compositeurs de musiquecomme Debussy vont à la Villa Médicis à Rome, où ils seront seuls pour composer, inventer, personne n'interviendradans leur pensée, car ils sont coupés du monde.
Ils sont seul face à eux-même, face à leurs idées.De plus certains domaines nécessitent une pensée personnelle.
Nous avons tout d'abord les sciences, où lecheminement logique, rationnel, des mathématiques en particulier, permet à un individu seul de construire unraisonnement cohérent.
Dans le domaine artistique, les œuvres d'arts semblent le plus souvent réalisés à l'écart dumonde.
Certains artistes peuvent en effet travailler que seul, enfermé, à l'abri de toute intrusion du monde extérieur( cf.
Villa Médicis pour la musique.
Pour finir les cultes aussi différents que le bouddhisme et le catholicisme ontinstitué des monastères où règne un silence considéré comme catalyseur de la méditation..L'étymologie du mot réflexion (tourner [son esprit] vers soi-même) semble évoquer la possibilité d'une introspection.Mais plus encore, l'existence même de ce mot apparaît comme une preuve de l'existence de la réflexion.
Commenten effet avoir pu définir ce concept sinon en…réfléchissant, en prenant de la distance par rapport à soi-même ?La pensée a donc une grande relation avec la conscience.
On dit que l'Homme est un sujet conscient.
Il estconscient de la réalité, il est conscient de lui-même.
Il est en relation avec ses propres sentiments et émotions.Conscience et pensée se rejoignent donc.
En effet, quand je dis « je suis conscient », cela veut dire que quandquelque chose m'arrive, je sais immédiatement que cela m'arrive…La conscience est un savoir qui s'ajoute à un fait.Dès lors, on peut distinguer deux usages du terme de conscience.
Quand j'ai des idées, des représentations quiportent sur ce qui est, sur ce qui était, sur ce qui pourrait être, on dira : J'ai une conscience (une pensée).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Théorie du complot : L’Homme n’a jamais marché sur la lune
- La besace du mendiant n'est jamais pleine
- Aucun juste ne s'est jamais enrichi rapidement
- Les méchants pots ne se cassent jamais
- « Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent entendre, mais souvent, tu ne sais pas, je me taisais pour donner l'exemple. »