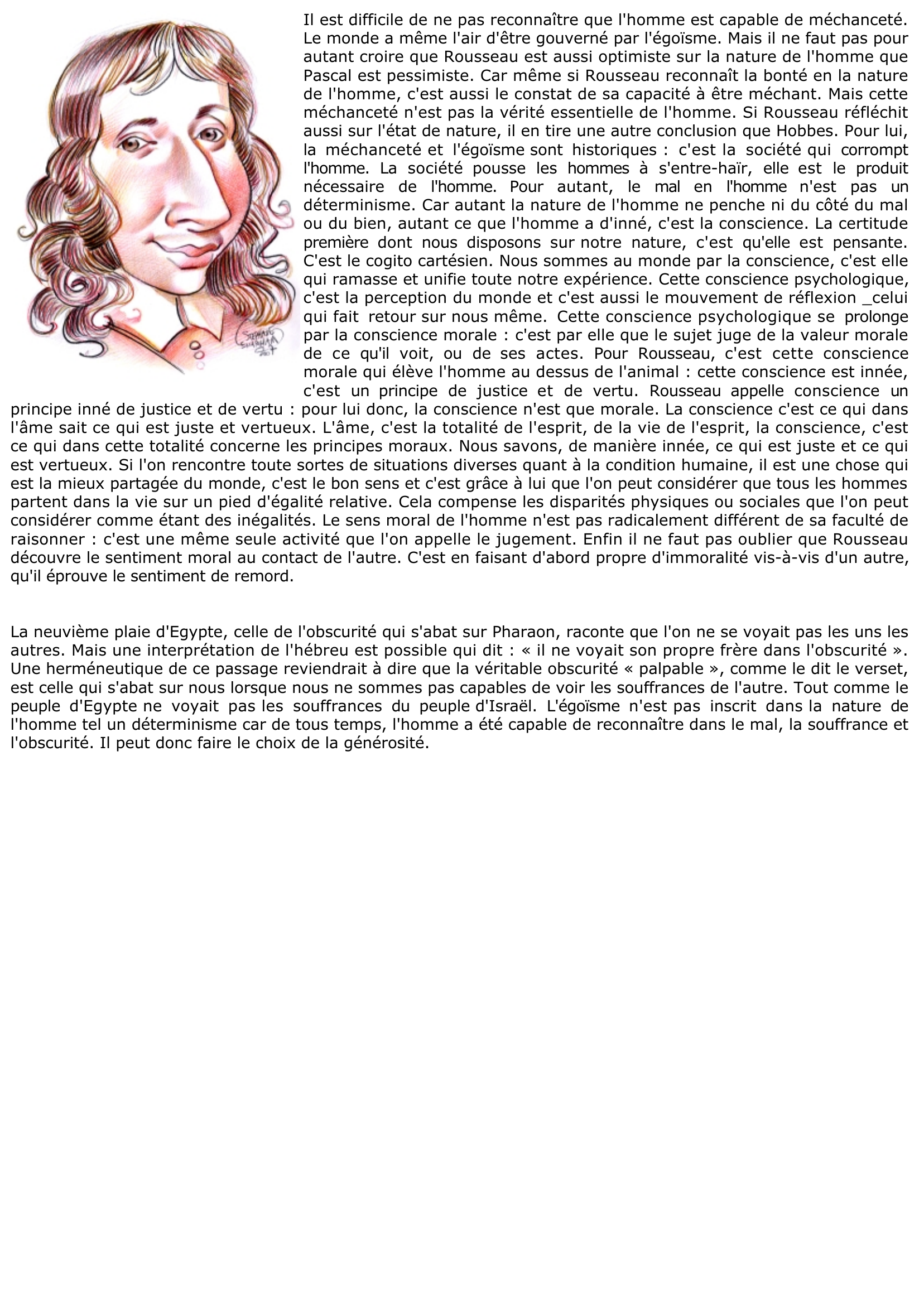Peut-on ne pas être égoïste ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
Il est difficile de ne pas reconnaître que l'homme est capable de méchanceté.Le monde a même l'air d'être gouverné par l'égoïsme.
Mais il ne faut pas pourautant croire que Rousseau est aussi optimiste sur la nature de l'homme quePascal est pessimiste.
Car même si Rousseau reconnaît la bonté en la naturede l'homme, c'est aussi le constat de sa capacité à être méchant.
Mais cetteméchanceté n'est pas la vérité essentielle de l'homme.
Si Rousseau réfléchitaussi sur l'état de nature, il en tire une autre conclusion que Hobbes.
Pour lui,la méchanceté et l'égoïsme sont historiques : c'est la société qui corromptl'homme.
La société pousse les hommes à s'entre-haïr, elle est le produitnécessaire de l'homme.
Pour autant, le mal en l'homme n'est pas undéterminisme.
Car autant la nature de l'homme ne penche ni du côté du malou du bien, autant ce que l'homme a d'inné, c'est la conscience.
La certitudepremière dont nous disposons sur notre nature, c'est qu'elle est pensante.C'est le cogito cartésien.
Nous sommes au monde par la conscience, c'est ellequi ramasse et unifie toute notre expérience.
Cette conscience psychologique,c'est la perception du monde et c'est aussi le mouvement de réflexion _celuiqui fait retour sur nous même.
Cette conscience psychologique se prolongepar la conscience morale : c'est par elle que le sujet juge de la valeur moralede ce qu'il voit, ou de ses actes.
Pour Rousseau, c'est cette consciencemorale qui élève l'homme au dessus de l'animal : cette conscience est innée,c'est un principe de justice et de vertu.
Rousseau appelle conscience un principe inné de justice et de vertu : pour lui donc, la conscience n'est que morale.
La conscience c'est ce qui dansl'âme sait ce qui est juste et vertueux.
L'âme, c'est la totalité de l'esprit, de la vie de l'esprit, la conscience, c'estce qui dans cette totalité concerne les principes moraux.
Nous savons, de manière innée, ce qui est juste et ce quiest vertueux.
Si l'on rencontre toute sortes de situations diverses quant à la condition humaine, il est une chose quiest la mieux partagée du monde, c'est le bon sens et c'est grâce à lui que l'on peut considérer que tous les hommespartent dans la vie sur un pied d'égalité relative.
Cela compense les disparités physiques ou sociales que l'on peutconsidérer comme étant des inégalités.
Le sens moral de l'homme n'est pas radicalement différent de sa faculté deraisonner : c'est une même seule activité que l'on appelle le jugement.
Enfin il ne faut pas oublier que Rousseaudécouvre le sentiment moral au contact de l'autre.
C'est en faisant d'abord propre d'immoralité vis-à-vis d'un autre,qu'il éprouve le sentiment de remord.
La neuvième plaie d'Egypte, celle de l'obscurité qui s'abat sur Pharaon, raconte que l'on ne se voyait pas les uns lesautres.
Mais une interprétation de l'hébreu est possible qui dit : « il ne voyait son propre frère dans l'obscurité ».Une herméneutique de ce passage reviendrait à dire que la véritable obscurité « palpable », comme le dit le verset,est celle qui s'abat sur nous lorsque nous ne sommes pas capables de voir les souffrances de l'autre.
Tout comme lepeuple d'Egypte ne voyait pas les souffrances du peuple d'Israël.
L'égoïsme n'est pas inscrit dans la nature del'homme tel un déterminisme car de tous temps, l'homme a été capable de reconnaître dans le mal, la souffrance etl'obscurité.
Il peut donc faire le choix de la générosité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La fille égoïste et Carline
- ÉGOÏSTE (L’) [The Egoist] (résumé) de George Meredith
- Devoir de philosophie sur la question : La recherche du bonheur est-elle un idéal égoïste ?
- Le libéralisme est-il un individualisme égoïste?
- Dans leur appréciation interviennent souvent amitié, haine, intérêt personnel ; aussi ne sont-ils plus en état de se faire une idée adéquate de la vérité et leur jugement est-il obnubilé par un sentiment égoïste de plaisir ou de peine.