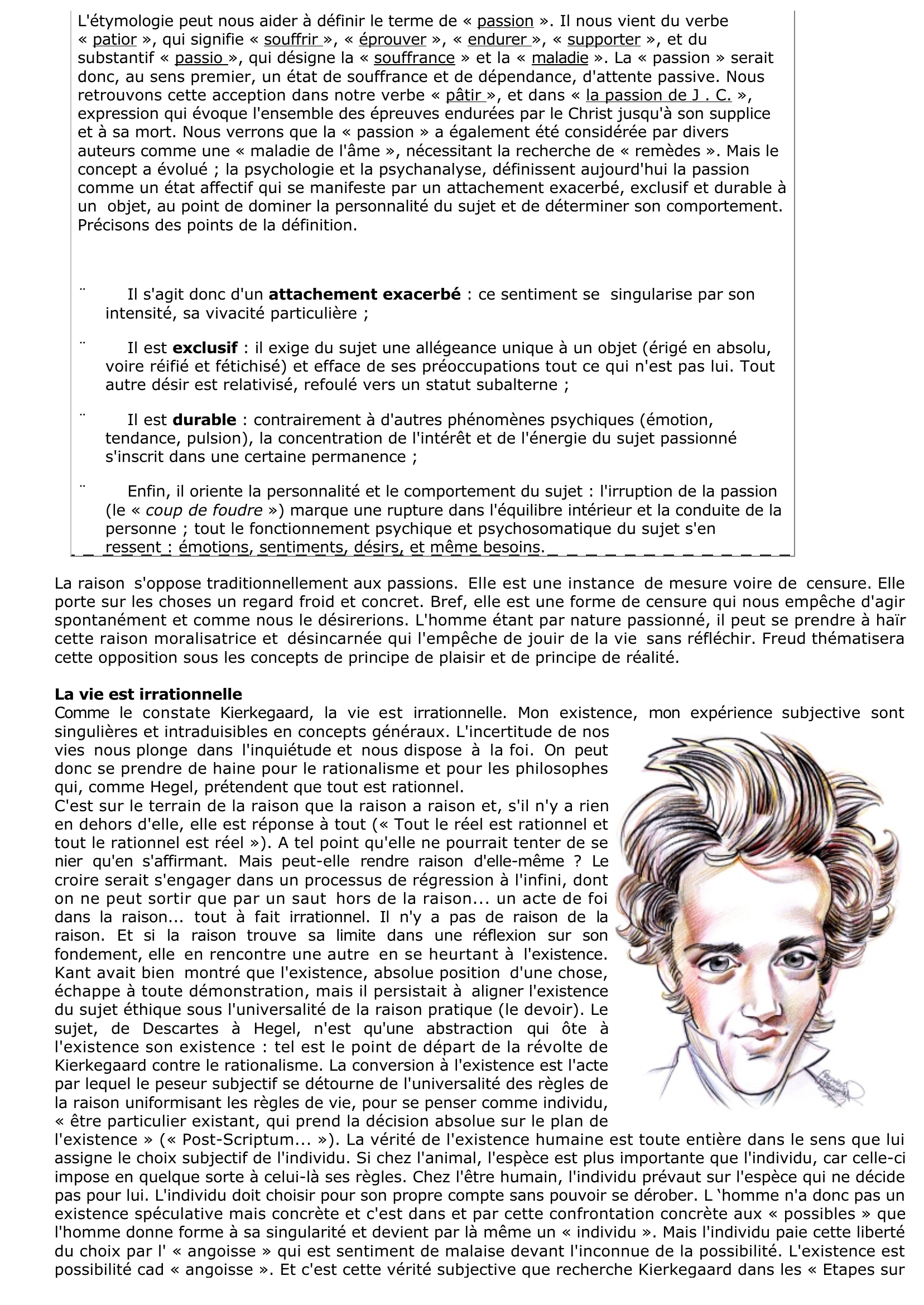Peut-on prendre en haine la raison ?
Publié le 05/03/2004

Extrait du document
- I) On peut prendre en haine la raison.
- II) On ne peut pas prendre en haine la raison.
«
L'étymologie peut nous aider à définir le terme de « passion ».
Il nous vient du verbe « patior », qui signifie « souffrir », « éprouver », « endurer », « supporter », et du substantif « passio », qui désigne la « souffrance » et la « maladie ».
La « passion » serait donc, au sens premier, un état de souffrance et de dépendance, d'attente passive.
Nousretrouvons cette acception dans notre verbe « pâtir », et dans « la passion de J .
C. », expression qui évoque l'ensemble des épreuves endurées par le Christ jusqu'à son suppliceet à sa mort.
Nous verrons que la « passion » a également été considérée par diversauteurs comme une « maladie de l'âme », nécessitant la recherche de « remèdes ».
Mais leconcept a évolué ; la psychologie et la psychanalyse, définissent aujourd'hui la passioncomme un état affectif qui se manifeste par un attachement exacerbé, exclusif et durable àun objet, au point de dominer la personnalité du sujet et de déterminer son comportement.Précisons des points de la définition.
¨ Il s'agit donc d'un attachement exacerbé : ce sentiment se singularise par son intensité, sa vivacité particulière ;
¨ Il est exclusif : il exige du sujet une allégeance unique à un objet (érigé en absolu, voire réifié et fétichisé) et efface de ses préoccupations tout ce qui n'est pas lui.
Toutautre désir est relativisé, refoulé vers un statut subalterne ;
¨ Il est durable : contrairement à d'autres phénomènes psychiques (émotion, tendance, pulsion), la concentration de l'intérêt et de l'énergie du sujet passionnés'inscrit dans une certaine permanence ;
¨ Enfin, il oriente la personnalité et le comportement du sujet : l'irruption de la passion(le « coup de foudre ») marque une rupture dans l'équilibre intérieur et la conduite de la personne ; tout le fonctionnement psychique et psychosomatique du sujet s'enressent : émotions, sentiments, désirs, et même besoins.
La raison s'oppose traditionnellement aux passions.
Elle est une instance de mesure voire de censure.
Elleporte sur les choses un regard froid et concret.
Bref, elle est une forme de censure qui nous empêche d'agirspontanément et comme nous le désirerions.
L'homme étant par nature passionné, il peut se prendre à haïrcette raison moralisatrice et désincarnée qui l'empêche de jouir de la vie sans réfléchir.
Freud thématiseracette opposition sous les concepts de principe de plaisir et de principe de réalité.
La vie est irrationnelleComme le constate Kierkegaard, la vie est irrationnelle.
Mon existence, mon expérience subjective sont singulières et intraduisibles en concepts généraux.
L'incertitude de nosvies nous plonge dans l'inquiétude et nous dispose à la foi.
On peutdonc se prendre de haine pour le rationalisme et pour les philosophesqui, comme Hegel, prétendent que tout est rationnel.C'est sur le terrain de la raison que la raison a raison et, s'il n'y a rienen dehors d'elle, elle est réponse à tout (« Tout le réel est rationnel ettout le rationnel est réel »).
A tel point qu'elle ne pourrait tenter de senier qu'en s'affirmant.
Mais peut-elle rendre raison d'elle-même ? Lecroire serait s'engager dans un processus de régression à l'infini, donton ne peut sortir que par un saut hors de la raison...
un acte de foidans la raison...
tout à fait irrationnel.
Il n'y a pas de raison de laraison.
Et si la raison trouve sa limite dans une réflexion sur sonfondement, elle en rencontre une autre en se heurtant à l'existence.Kant avait bien montré que l'existence, absolue position d'une chose,échappe à toute démonstration, mais il persistait à aligner l'existencedu sujet éthique sous l'universalité de la raison pratique (le devoir).
Lesujet, de Descartes à Hegel, n'est qu'une abstraction qui ôte àl'existence son existence : tel est le point de départ de la révolte deKierkegaard contre le rationalisme.
La conversion à l'existence est l'actepar lequel le peseur subjectif se détourne de l'universalité des règles dela raison uniformisant les règles de vie, pour se penser comme individu,« être particulier existant, qui prend la décision absolue sur le plan del'existence » (« Post-Scriptum...
»).
La vérité de l'existence humaine est toute entière dans le sens que luiassigne le choix subjectif de l'individu.
Si chez l'animal, l'espèce est plus importante que l'individu, car celle-ciimpose en quelque sorte à celui-là ses règles.
Chez l'être humain, l'individu prévaut sur l'espèce qui ne décidepas pour lui.
L'individu doit choisir pour son propre compte sans pouvoir se dérober.
L ‘homme n'a donc pas unexistence spéculative mais concrète et c'est dans et par cette confrontation concrète aux « possibles » quel'homme donne forme à sa singularité et devient par là même un « individu ».
Mais l'individu paie cette libertédu choix par l' « angoisse » qui est sentiment de malaise devant l'inconnue de la possibilité.
L'existence estpossibilité cad « angoisse ».
Et c'est cette vérité subjective que recherche Kierkegaard dans les « Etapes sur.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La croyance religieuse peut-elle (prétendre) prendre appui sur la raison ?
- « La raison doit prendre les devants » d'E. KANT
- La croyance religieuse peut-elle prendre appui sur la raison ?
- Substituer au gouvernement par la raison le gouvernement par l'amour, c'est ouvrir la voie au gouvernement par la haine, comme Socrate semble l'avoir entrevu quand il dit que la méfiance en la raison ressemble à la méfiance envers l'homme.
- Parlant du métier de romancier, François Mauriac écrit : « Les personnages fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes... Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette création d'un monde irréel grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et de pitié. » Expliquez, commentez et, si vous le