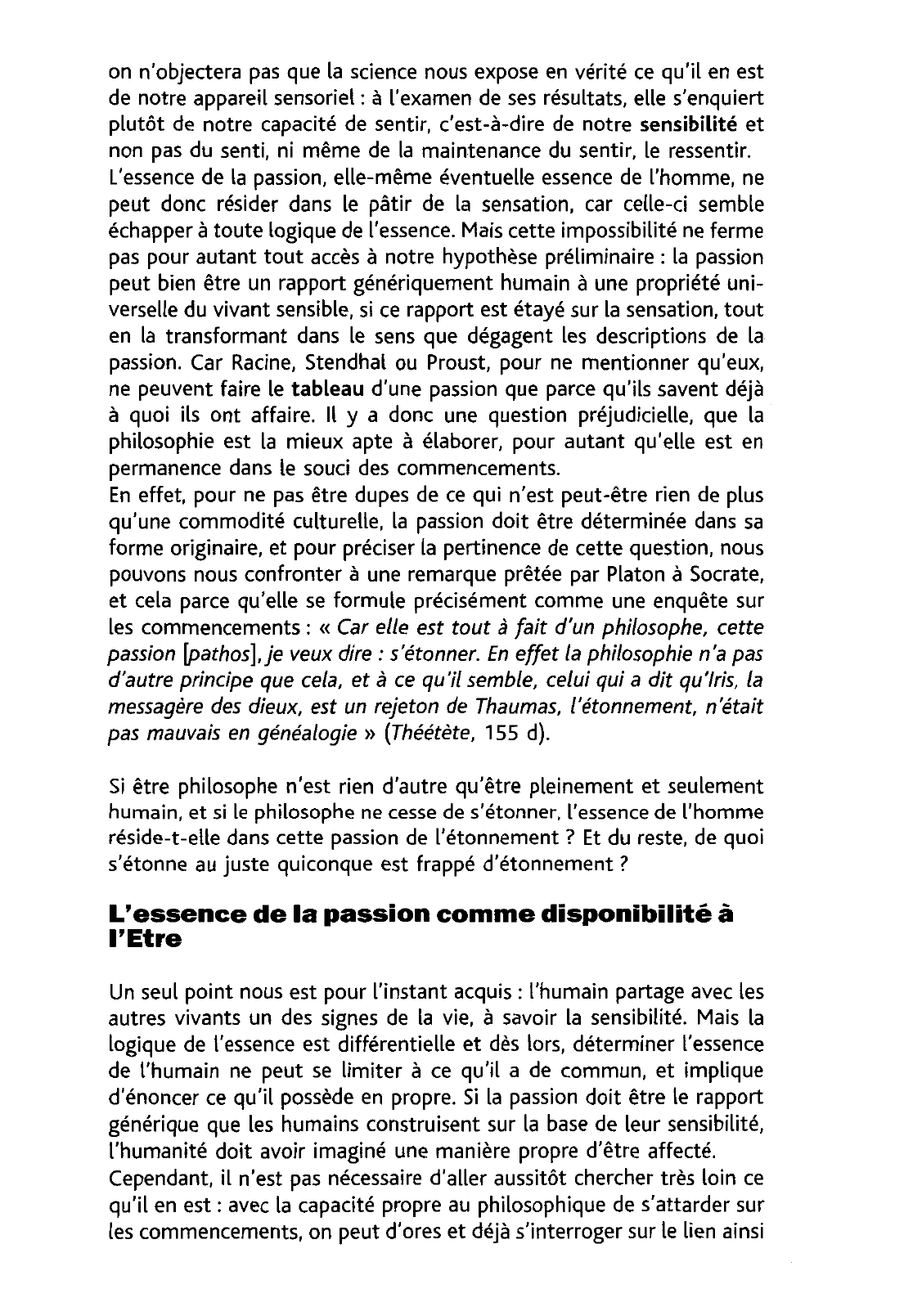Philosophie de la passion
Publié le 28/03/2015

Extrait du document

Si nous suivons les conclusions précédentes, issues de l'analyse des grands dialogues spéculatifs de Platon, nous pouvons nous contenter de la conséquence où elles nous conduisent pour l'essence de la passion, comme éventuellement coextensive de l'essence de l'humain : nous sommes voués à la passion pour autant que notre existence comporte une part de contingence, qu'il reste alors à déterminer.
Et Platon s'en était inquiété dès le premier grand dialogue de sa maturité, dans un passage où il s'agit précisément d'évaluer la précision de la définition de la mort comme séparation.
Or ne peut être séparé que ce qui était essentiellement séparable et il s'agit alors d'examiner si l'âme peut subir une telle séparation, ou si elle n'est pas assez homogène pour ne pas être, et pour cette seule raison, immortelle.
Et à propos de quoi redouter que cela en pâtisse [dedienai mè pathè auto], et pour quelle sorte d'être?
La passion doit donc avoir une condition dans l'être même de ce qui peut pâtir (le passible, cf. «Le paradoxe de la passion«, p. 7) : n'est passible que ce qui peut à son tour être scindé en un sentant et un senti.
Et si tout le pâtir affectait le passible, celui-ci disparaîtrait dans la passion qui ne pourrait donc plus être perçue comme telle.
La passion suppose donc de l'impassible dans ce qui pâtit, pour une raison analogue à celle qui veut que tout ne soit pas en mouvement, pour être en mesure de percevoir le mobile sur son fond d'immobilité.
Mais si la passion s'identifie à la sensation, nul ne pourra rien dire : il faut donc supposer, pour que la philosophie puisse introduire sa rationalité universalisante dans ce qui semble voué à la contingence, qu'il subsiste quelque chose d'invariant au fond de la passion, et que ce soit précisément cela pourtant que la passion affecte, mais alors seulement selon une modification provisoire.
Et c'est l'un des aspects du génie d'Aristote de nous avoir fourni un élément décisif pour une rationalisation du pâtir en imaginant que ce qui est l'essence sur le versant du connaître doit être compris comme substance sur te versant de l'être.
De plus, la séparation des deux versants réside dans le faîte du dire : on peut faire être seulement en disant, et connaître s'identifie à dire l'être comme il est.
Mais Aristote s'efforce de sortir de l'immobilité de l'Etre en pluralisant son dire, car c'est l'un de ses principes fondamentaux que celui qui énonce que : «L'Etre proprement dit s'entend en plusieurs façons« (Métaphysique, Livre E, chapitre 2, 1026 a 32).
Nous disposons ainsi de toutes les conditions pour pouvoir bien entendre la première définition de la passion énoncée dans te cadre de la métaphysique.
Mais pour en saisir la portée, nous devons repérer de suite la nature du déplacement opéré par Aristote en regard de l'entente usuelle de la doxa.
Aristote se croit alors fondé à discerner autant de manières d'être qu'il y a de façons de le dire, ce qui a pu conduire certains critiques à soutenir que la philosophie, dès lors fictivement universelle, avait en vérité la structure, nécessairement particulière, de la langue grecque.

«
Philosophie de la passion
on n'objectera pas que la science nous expose en vérité ce qu'il en est
de notre appareil sensoriel: à l'examen de ses résultats, elle s'enquiert
plutôt de notre capacité de sentir, c'est-à-dire de notre
sensibilité et
non pas du senti, ni même de la maintenance du sentir, le ressentir.
L'essence de
la passion, elle-même éventuelle essence de l'homme, ne
peut donc résider dans
le pâtir de la sensation, car celle-ci semble
échapper à
toute logique de l'essence.
Mais cette impossibilité ne ferme
pas pour
autant tout accès à notre hypothèse préliminaire : la passion
peut bien
être un rapport génériquement humain à une propriété uni
verselle du vivant sensible,
si ce rapport est étayé sur la sensation, tout
en la transformant dans le sens que dégagent les descriptions de la
passion.
Car Racine, Stendhal ou Proust, pour ne mentionner qu'eux,
ne peuvent faire
le tableau d'une passion que parce qu'ils savent déjà
à quoi
ils ont affaire.
Il y a donc une question préjudicielle, que la
philosophie est la mieux apte à élaborer, pour autant qu'elle est en
permanence dans
le souci des commencements.
En effet, pour ne pas être dupes de ce qui n'est peut-être rien de plus
qu'une commodité culturelle,
la passion doit être déterminée dans sa
forme originaire,
et pour préciser la pertinence de cette question, nous
pouvons nous confronter à une remarque prêtée par
Platon à Socrate,
et cela parce qu'elle se formule précisément comme une enquête sur
les
commencements : « Car elle est tout à fait d'un philosophe, cette
passion [pathos],je veux dire: s'étonner.
En effet la philosophie n'a pas
d'autre principe que cela,
et à ce qu'il semble, celui qui a dit qu'lris, la
messagère des dieux, est un rejeton de Thaumas, l'étonnement, n'était
pas mauvais en généalogie
» (Théétète, 155 d).
Si être philosophe n'est rien d'autre qu'être pleinement et seulement
humain,
et si le philosophe ne cesse de s'étonner, l'essence de l'homme
réside-t-elle dans
cette passion de l'étonnement? Et du reste, de quoi
s'étonne au juste quiconque est frappé d'étonnement?
L'essence de la passion comme disponibilité à
l'Etre
Un seul point nous est pour l'instant acquis : l'humain partage avec les
autres vivants un des signes de
la vie, à savoir la sensibilité.
Mais la
logique de l'essence est différentielle et dès lors, déterminer l'essence
de l'humain ne peut se limiter à ce qu'il a de commun,
et implique
d'énoncer ce qu'il possède en propre.
Si la passion doit être le rapport
générique que les humains construisent sur
la base de leur sensibilité,
l'humanité doit avoir imaginé une manière propre d'être affecté.
Cependant,
il n'est pas nécessaire d'aller aussitôt chercher très loin ce
qu'il en
est: avec la capacité propre au philosophique de s'attarder sur
les commencements, on peut d'ores
et déjà s'interroger sur le lien ainsi
- 63 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Ferdinand Alquié vous semble-t-il avoir bien défini l'amour surréaliste quand il écrit : « L'amour, entendons l'amour passion, prend d'emblée, dans les préoccupations surréalistes, la première place. En lui se retrouvent tous les prestiges de l'Univers, tous les pouvoirs de la conscience, toute l'agitation du sentiment: par lui s'effectue la synthèse suprême du subjectif et de l'objectif, et nous est restitué le ravissement que les déchirements surréalistes semblaient rendre impossible
- PASSION ET RAISON (cours de philosophie)
- Ferdinand Alquié vous semble-t-il avoir bien défini l'amour surréaliste quand il écrit : «L'amour, entendons l amour passion, prend d'emblée, dans les préoccupations surréalistes, la première place. En lui se retrouvent tous les prestiges de l'Univers, tous les pouvoirs de la conscience, toute l'agitation du sentiment ; par lui s'effectue la synthèse suprême du subjectif et de l'objectif, et nous est restitué le ravissement que les déchirements surréalistes semblaient rendre impossible
- Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Introduction à la Philosophie de l'Histoire Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Commentez cette citation.
- Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. [ Introduction à la Philosophie de l'Histoire ] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Commentez cette citation.