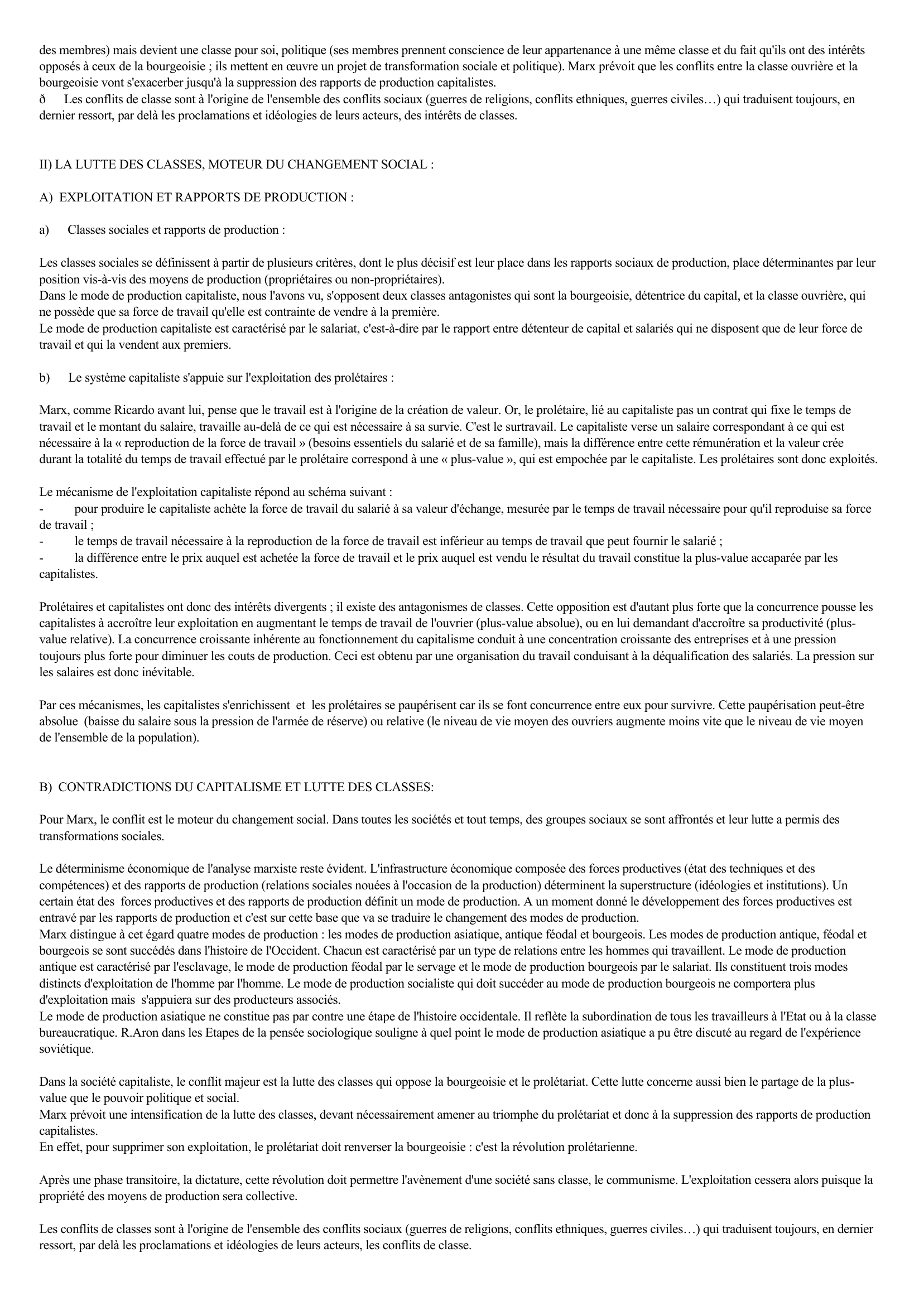Philosophie et sociologie chez Marx
Publié le 15/08/2012

Extrait du document

Les ouvriers (en tant que groupe socioprofessionnel) on vu leur effectifs et leur part dans la population active fortement diminuer depuis le milieu du XXème siècle. Le groupe socioprofessionnel des ouvriers n’est pas parfaitement homogène : ouvriers de type industriels et de type artisanal, ouvriers de la métallurgie et ouvriers travaillant dans le secteur public, par exemple, ont des condition de travail très différentes. Cependant, compte tenu de la forte hétérogénéité du groupe socioprofessionnel des employés, on peut affirmer que les ouvriers représentent le groupe social le plus important en France aujourd’hui. Or tout se passe comme si ce groupe social était devenu presque invisible et inaudible (S. Beaux et M. Pialoux Retour sur la condition ouvrière, 1999). La désindustrialisation, la déconcentration de l’appareil productif, le recul des modes d’organisation du travail tayloriens ont affaibli les "bastions ouvriers" (par exemple la métallurgie) où ceux-ci, présents en grand nombre, pouvaient mesurer leur force et s’organiser. Les nouveaux modes de rémunération (primes individuelles et d’équipe) instaurent dans le collectif de travail une logique de concurrence et de contrôle réciproque. On assiste alors à la dissolution de la solidarité contestataire d’atelier, au profit de stratégies individualistes qui consistent à entrer dans le jeux de la direction pour obtenir des évolutions de carrière et des primes.

«
des membres) mais devient une classe pour soi, politique (ses membres prennent conscience de leur appartenance à une même classe et du fait qu'ils ont des intérêtsopposés à ceux de la bourgeoisie ; ils mettent en œuvre un projet de transformation sociale et politique).
Marx prévoit que les conflits entre la classe ouvrière et labourgeoisie vont s'exacerber jusqu'à la suppression des rapports de production capitalistes.ð Les conflits de classe sont à l'origine de l'ensemble des conflits sociaux (guerres de religions, conflits ethniques, guerres civiles…) qui traduisent toujours, endernier ressort, par delà les proclamations et idéologies de leurs acteurs, des intérêts de classes.
II) LA LUTTE DES CLASSES, MOTEUR DU CHANGEMENT SOCIAL : A) EXPLOITATION ET RAPPORTS DE PRODUCTION : a) Classes sociales et rapports de production : Les classes sociales se définissent à partir de plusieurs critères, dont le plus décisif est leur place dans les rapports sociaux de production, place déterminantes par leurposition vis-à-vis des moyens de production (propriétaires ou non-propriétaires).Dans le mode de production capitaliste, nous l'avons vu, s'opposent deux classes antagonistes qui sont la bourgeoisie, détentrice du capital, et la classe ouvrière, quine possède que sa force de travail qu'elle est contrainte de vendre à la première.Le mode de production capitaliste est caractérisé par le salariat, c'est-à-dire par le rapport entre détenteur de capital et salariés qui ne disposent que de leur force detravail et qui la vendent aux premiers.
b) Le système capitaliste s'appuie sur l'exploitation des prolétaires : Marx, comme Ricardo avant lui, pense que le travail est à l'origine de la création de valeur.
Or, le prolétaire, lié au capitaliste pas un contrat qui fixe le temps detravail et le montant du salaire, travaille au-delà de ce qui est nécessaire à sa survie.
C'est le surtravail.
Le capitaliste verse un salaire correspondant à ce qui estnécessaire à la « reproduction de la force de travail » (besoins essentiels du salarié et de sa famille), mais la différence entre cette rémunération et la valeur créedurant la totalité du temps de travail effectué par le prolétaire correspond à une « plus-value », qui est empochée par le capitaliste.
Les prolétaires sont donc exploités.
Le mécanisme de l'exploitation capitaliste répond au schéma suivant :- pour produire le capitaliste achète la force de travail du salarié à sa valeur d'échange, mesurée par le temps de travail nécessaire pour qu'il reproduise sa forcede travail ;- le temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail est inférieur au temps de travail que peut fournir le salarié ;- la différence entre le prix auquel est achetée la force de travail et le prix auquel est vendu le résultat du travail constitue la plus-value accaparée par lescapitalistes.
Prolétaires et capitalistes ont donc des intérêts divergents ; il existe des antagonismes de classes.
Cette opposition est d'autant plus forte que la concurrence pousse lescapitalistes à accroître leur exploitation en augmentant le temps de travail de l'ouvrier (plus-value absolue), ou en lui demandant d'accroître sa productivité (plus-value relative).
La concurrence croissante inhérente au fonctionnement du capitalisme conduit à une concentration croissante des entreprises et à une pressiontoujours plus forte pour diminuer les couts de production.
Ceci est obtenu par une organisation du travail conduisant à la déqualification des salariés.
La pression surles salaires est donc inévitable.
Par ces mécanismes, les capitalistes s'enrichissent et les prolétaires se paupérisent car ils se font concurrence entre eux pour survivre.
Cette paupérisation peut-êtreabsolue (baisse du salaire sous la pression de l'armée de réserve) ou relative (le niveau de vie moyen des ouvriers augmente moins vite que le niveau de vie moyende l'ensemble de la population).
B) CONTRADICTIONS DU CAPITALISME ET LUTTE DES CLASSES: Pour Marx, le conflit est le moteur du changement social.
Dans toutes les sociétés et tout temps, des groupes sociaux se sont affrontés et leur lutte a permis destransformations sociales.
Le déterminisme économique de l'analyse marxiste reste évident.
L'infrastructure économique composée des forces productives (état des techniques et descompétences) et des rapports de production (relations sociales nouées à l'occasion de la production) déterminent la superstructure (idéologies et institutions).
Uncertain état des forces productives et des rapports de production définit un mode de production.
A un moment donné le développement des forces productives estentravé par les rapports de production et c'est sur cette base que va se traduire le changement des modes de production.Marx distingue à cet égard quatre modes de production : les modes de production asiatique, antique féodal et bourgeois.
Les modes de production antique, féodal etbourgeois se sont succédés dans l'histoire de l'Occident.
Chacun est caractérisé par un type de relations entre les hommes qui travaillent.
Le mode de productionantique est caractérisé par l'esclavage, le mode de production féodal par le servage et le mode de production bourgeois par le salariat.
Ils constituent trois modesdistincts d'exploitation de l'homme par l'homme.
Le mode de production socialiste qui doit succéder au mode de production bourgeois ne comportera plusd'exploitation mais s'appuiera sur des producteurs associés.Le mode de production asiatique ne constitue pas par contre une étape de l'histoire occidentale.
Il reflète la subordination de tous les travailleurs à l'Etat ou à la classebureaucratique.
R.Aron dans les Etapes de la pensée sociologique souligne à quel point le mode de production asiatique a pu être discuté au regard de l'expériencesoviétique.
Dans la société capitaliste, le conflit majeur est la lutte des classes qui oppose la bourgeoisie et le prolétariat.
Cette lutte concerne aussi bien le partage de la plus-value que le pouvoir politique et social.Marx prévoit une intensification de la lutte des classes, devant nécessairement amener au triomphe du prolétariat et donc à la suppression des rapports de productioncapitalistes.En effet, pour supprimer son exploitation, le prolétariat doit renverser la bourgeoisie : c'est la révolution prolétarienne.
Après une phase transitoire, la dictature, cette révolution doit permettre l'avènement d'une société sans classe, le communisme.
L'exploitation cessera alors puisque lapropriété des moyens de production sera collective.
Les conflits de classes sont à l'origine de l'ensemble des conflits sociaux (guerres de religions, conflits ethniques, guerres civiles…) qui traduisent toujours, en dernierressort, par delà les proclamations et idéologies de leurs acteurs, les conflits de classe..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE, Karl Marx - résumé de l'oeuvre
- MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE de Karl Marx - résumé, analyse
- CONTRIBUTION A LA CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT DE HEGEL de Karl Marx (exposé de l’oeuvre)
- La philosophie de Marx
- Karl Marx - Philosophie.