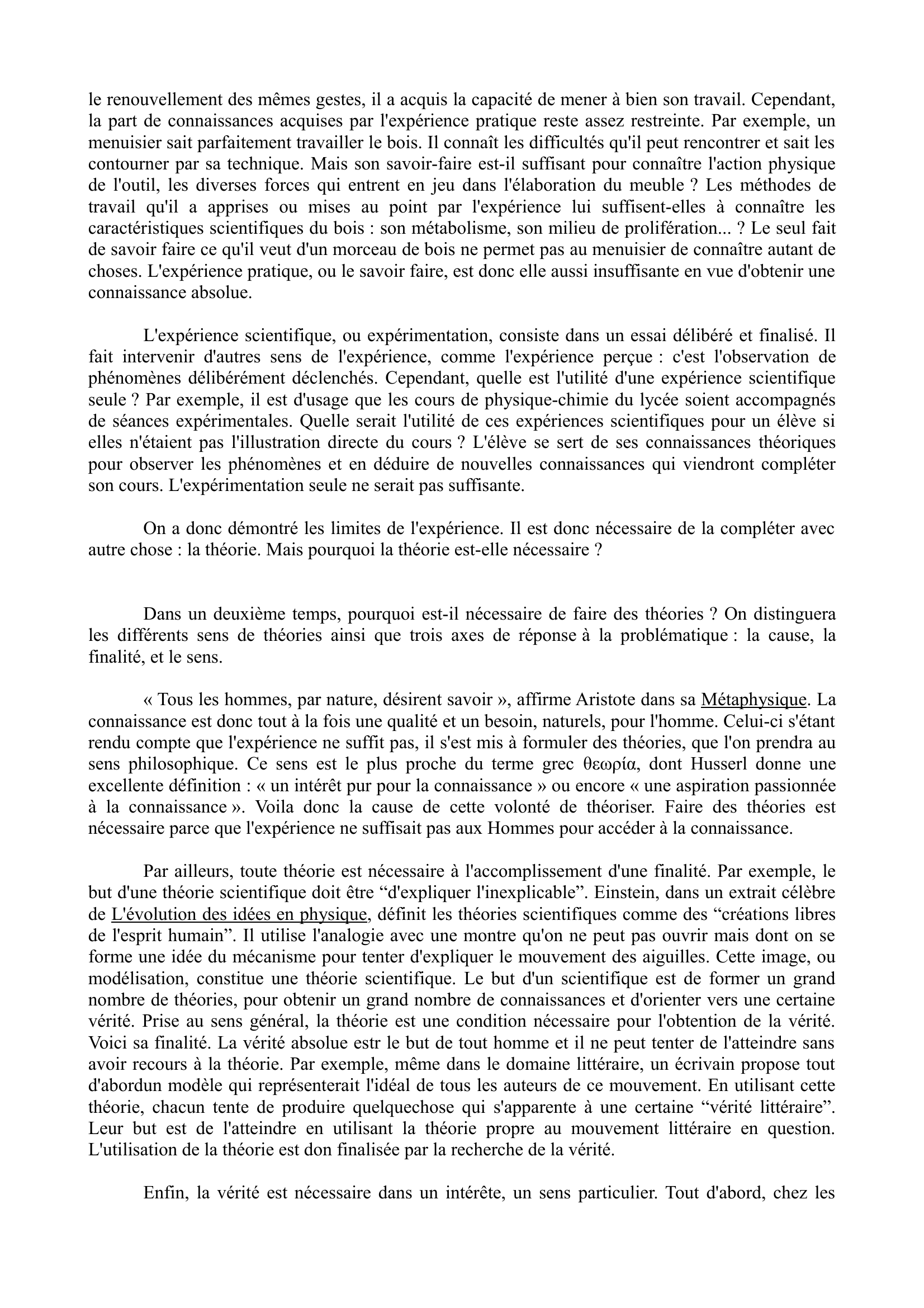Pourquoi faire des théories ?
Publié le 02/01/2013

Extrait du document
« C'est en forgeant qu'on devient forgeron «. Telle est la doxa : on apprend tout par
l'expérience. Cependant, cette position s'avère rapidement insatisfaisante : comment la simple
expérience pourrait-elle nous apporter une connaissance complète et absolue ? Nécessairement, les
hommes ont alors recours à autre chose : la théorie. Elle peut-être prise au singulier, dans un sens
général, mais aussi au pluriel, ce qui distingue un certain nombre de sens précis dans des domaines
particuliers : la théorie philosophique, scientifique, artistique, etc... On peut en dire autant de
l'expérience, qu'on peut subdiviser en différents sens. La problématique « pourquoi faire des
théories ? « s'impose alors et suppose : pourquoi faire des théories et pas « autre chose «, cet « autre
chose « serait donc la pratique, l'expérience. Compte tenu d'une opposition apparemment radicale
entre théorie et pratique, il est légitime de s'interroger sur le paradoxe : « Pourquoi faire des théories
et non se limiter à l'expérience ? «. L'enjeu est en effet le rôle de l'expérience. Les questions
essentielles seront par conséquent : est-il suffisant de faire des expériences, ou-bien les théories
sont-elles nécessaires dans l’acquisition de connaissances ? Enfin, est-il nécessaire que théorie et
pratique se rejoignent ?
«
le renouvellement des mêmes gestes, il a acquis la capacité de mener à bien son travail.
Cependant,
la part de connaissances acquises par l'expérience pratique reste assez restreinte.
Par exemple, un
menuisier sait parfaitement travailler le bois.
Il connaît les difficultés qu'il peut rencontrer et sait les
contourner par sa technique.
Mais son savoir-faire est-il suffisant pour connaître l'action physique
de l'outil, les diverses forces qui entrent en jeu dans l'élaboration du meuble ? Les méthodes de
travail qu'il a apprises ou mises au point par l'expérience lui suffisent-elles à connaître les
caractéristiques scientifiques du bois : son métabolisme, son milieu de prolifération...
? Le seul fait
de savoir faire ce qu'il veut d'un morceau de bois ne permet pas au menuisier de connaître autant de
choses.
L'expérience pratique, ou le savoir faire, est donc elle aussi insuffisante en vue d'obtenir une
connaissance absolue.
L'expérience scientifique, ou expérimentation, consiste dans un essai délibéré et finalisé.
Il
fait intervenir d'autres sens de l'expérience, comme l'expérience perçue : c'est l'observation de
phénomènes délibérément déclenchés.
Cependant, quelle est l'utilité d'une expérience scientifique
seule ? Par exemple, il est d'usage que les cours de physique-chimie du lycée soient accompagnés
de séances expérimentales.
Quelle serait l'utilité de ces expériences scientifiques pour un élève si
elles n'étaient pas l'illustration directe du cours ? L'élève se sert de ses connaissances théoriques
pour observer les phénomènes et en déduire de nouvelles connaissances qui viendront compléter
son cours.
L'expérimentation seule ne serait pas suffisante.
On a donc démontré les limites de l'expérience.
Il est donc nécessaire de la compléter avec
autre chose : la théorie.
Mais pourquoi la théorie est-elle nécessaire ?
Dans un deuxième temps, pourquoi est-il nécessaire de faire des théories ? On distinguera
les différents sens de théories ainsi que trois axes de réponse à la problématique : la cause, la
finalité, et le sens.
« Tous les hommes, par nature, désirent savoir », affirme Aristote dans sa Métaphysique .
La
connaissance est donc tout à la fois une qualité et un besoin, naturels, pour l'homme.
Celui-ci s'étant
rendu compte que l'expérience ne suffit pas, il s'est mis à formuler des théories, que l'on prendra au
sens philosophique.
Ce sens est le plus proche du terme grec θεωρία, dont Husserl donne une
excellente définition : « un intérêt pur pour la connaissance » ou encore « une aspiration passionnée
à la connaissance ».
Voila donc la cause de cette volonté de théoriser.
Faire des théories est
nécessaire parce que l'expérience ne suffisait pas aux Hommes pour accéder à la connaissance.
Par ailleurs, toute théorie est nécessaire à l'accomplissement d'une finalité.
Par exemple, le
but d'une théorie scientifique doit être “d'expliquer l'inexplicable”.
Einstein, dans un extrait célèbre
de L'évolution des idées en physique , définit les théories scientifiques comme des “créations libres
de l'esprit humain”.
Il utilise l'analogie avec une montre qu'on ne peut pas ouvrir mais dont on se
forme une idée du mécanisme pour tenter d'expliquer le mouvement des aiguilles.
Cette image, ou
modélisation, constitue une théorie scientifique.
Le but d'un scientifique est de former un grand
nombre de théories, pour obtenir un grand nombre de connaissances et d'orienter vers une certaine
vérité.
Prise au sens général, la théorie est une condition nécessaire pour l'obtention de la vérité.
Voici sa finalité.
La vérité absolue estr le but de tout homme et il ne peut tenter de l'atteindre sans
avoir recours à la théorie.
Par exemple, même dans le domaine littéraire, un écrivain propose tout
d'abordun modèle qui représenterait l'idéal de tous les auteurs de ce mouvement.
En utilisant cette
théorie, chacun tente de produire quelquechose qui s'apparente à une certaine “vérité littéraire”.
Leur but est de l'atteindre en utilisant la théorie propre au mouvement littéraire en question.
L'utilisation de la théorie est don finalisée par la recherche de la vérité.
Enfin, la vérité est nécessaire dans un intérête, un sens particulier.
Tout d'abord, chez les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le renouvellement des théories scientifiques doit-il faire douter de la science?
- N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'état civil [...] que [...] de rédiger des théories... Honoré de Balzac.
- Israël Palestine Spé HGGSP/ T / Thème 2- Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution / Fiche memo de balisage indispensable
- Faire face au réchauffement climatique, acteurs et enjeux (document de la COP 26)
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard