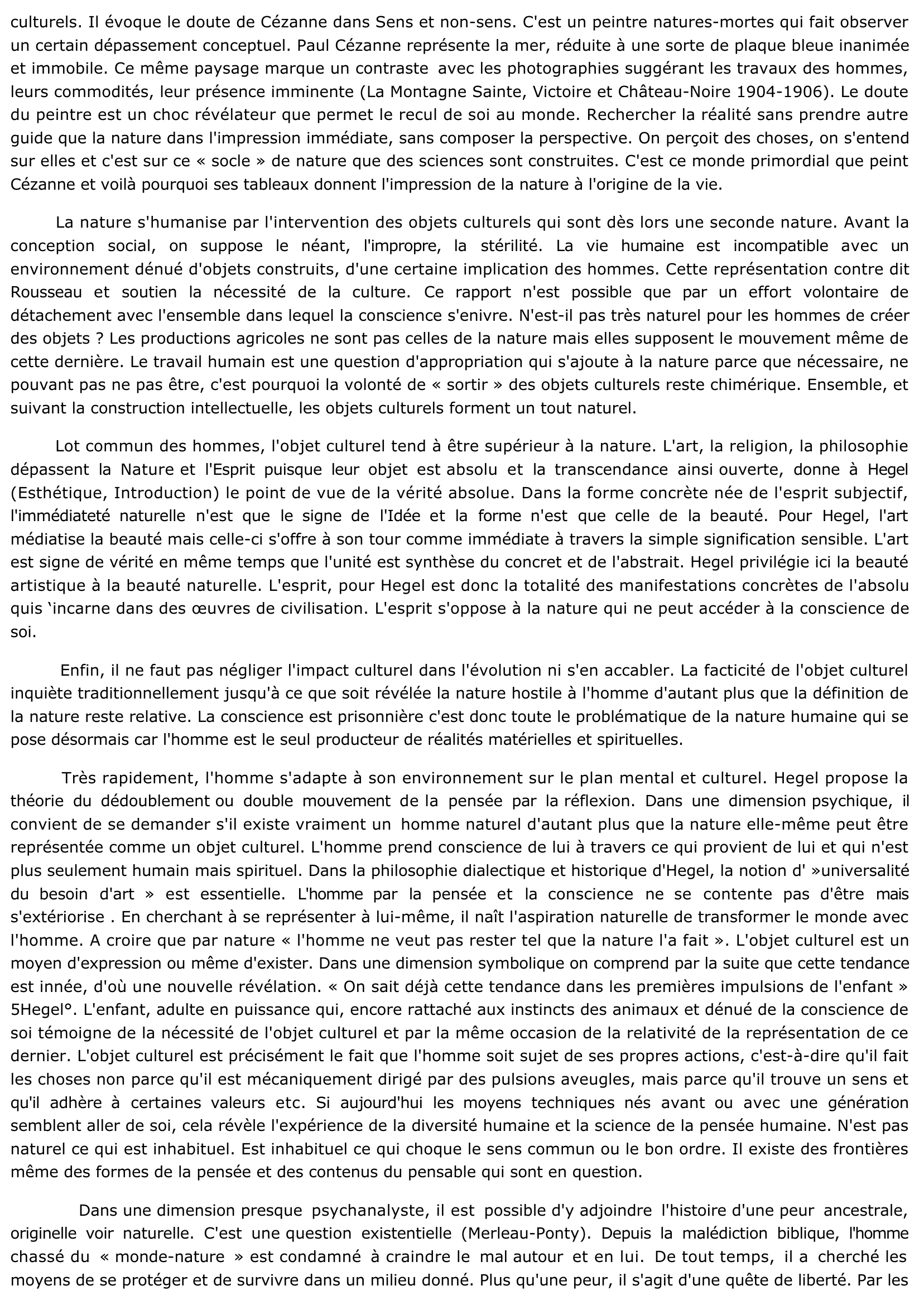Qu'est-ce qu'un objet culturel ?
Publié le 14/12/2009

Extrait du document
Ainsi le mal apparaît dans l’histoire avec l’abolition de la nature. L’objet culturel est condamné. Lorsque Rousseau répond à la question suivante ; « qu’elle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle «. Il n’est pas vraiment nostalgique des sociétés primitives sans institutions où la liberté existe encore. Il évoque surtout une rupture. La société déprave et l’homme en devient misérable. Le malheur s’en suit avec l’apparition des usines qui conduisent à la division du travail et surtout à la propriété privée. La société est instable. La perfectibilité ne signifie pas la perfection en ce sens mais l’aptitude au changement au mieux comme au pire ; la démocratie mais aussi le totalitarisme. Le naturel, par extension constitue le label de qualité, passé du fait à la valeur. Le naturel est bon. La culture nous rappelle la menace d’une nature perdue.
«
culturels.
Il évoque le doute de Cézanne dans Sens et non-sens.
C'est un peintre natures-mortes qui fait observerun certain dépassement conceptuel.
Paul Cézanne représente la mer, réduite à une sorte de plaque bleue inaniméeet immobile.
Ce même paysage marque un contraste avec les photographies suggérant les travaux des hommes,leurs commodités, leur présence imminente (La Montagne Sainte, Victoire et Château-Noire 1904-1906).
Le doutedu peintre est un choc révélateur que permet le recul de soi au monde.
Rechercher la réalité sans prendre autreguide que la nature dans l'impression immédiate, sans composer la perspective.
On perçoit des choses, on s'entendsur elles et c'est sur ce « socle » de nature que des sciences sont construites.
C'est ce monde primordial que peintCézanne et voilà pourquoi ses tableaux donnent l'impression de la nature à l'origine de la vie.
La nature s'humanise par l'intervention des objets culturels qui sont dès lors une seconde nature.
Avant laconception social, on suppose le néant, l'impropre, la stérilité.
La vie humaine est incompatible avec unenvironnement dénué d'objets construits, d'une certaine implication des hommes.
Cette représentation contre ditRousseau et soutien la nécessité de la culture.
Ce rapport n'est possible que par un effort volontaire dedétachement avec l'ensemble dans lequel la conscience s'enivre.
N'est-il pas très naturel pour les hommes de créerdes objets ? Les productions agricoles ne sont pas celles de la nature mais elles supposent le mouvement même decette dernière.
Le travail humain est une question d'appropriation qui s'ajoute à la nature parce que nécessaire, nepouvant pas ne pas être, c'est pourquoi la volonté de « sortir » des objets culturels reste chimérique.
Ensemble, etsuivant la construction intellectuelle, les objets culturels forment un tout naturel.
Lot commun des hommes, l'objet culturel tend à être supérieur à la nature.
L'art, la religion, la philosophiedépassent la Nature et l'Esprit puisque leur objet est absolu et la transcendance ainsi ouverte, donne à Hegel(Esthétique, Introduction) le point de vue de la vérité absolue.
Dans la forme concrète née de l'esprit subjectif,l'immédiateté naturelle n'est que le signe de l'Idée et la forme n'est que celle de la beauté.
Pour Hegel, l'artmédiatise la beauté mais celle-ci s'offre à son tour comme immédiate à travers la simple signification sensible.
L'artest signe de vérité en même temps que l'unité est synthèse du concret et de l'abstrait.
Hegel privilégie ici la beautéartistique à la beauté naturelle.
L'esprit, pour Hegel est donc la totalité des manifestations concrètes de l'absoluquis ‘incarne dans des œuvres de civilisation.
L'esprit s'oppose à la nature qui ne peut accéder à la conscience desoi.
Enfin, il ne faut pas négliger l'impact culturel dans l'évolution ni s'en accabler.
La facticité de l'objet culturelinquiète traditionnellement jusqu'à ce que soit révélée la nature hostile à l'homme d'autant plus que la définition dela nature reste relative.
La conscience est prisonnière c'est donc toute le problématique de la nature humaine qui sepose désormais car l'homme est le seul producteur de réalités matérielles et spirituelles.
Très rapidement, l'homme s'adapte à son environnement sur le plan mental et culturel.
Hegel propose lathéorie du dédoublement ou double mouvement de la pensée par la réflexion.
Dans une dimension psychique, ilconvient de se demander s'il existe vraiment un homme naturel d'autant plus que la nature elle-même peut êtrereprésentée comme un objet culturel.
L'homme prend conscience de lui à travers ce qui provient de lui et qui n'estplus seulement humain mais spirituel.
Dans la philosophie dialectique et historique d'Hegel, la notion d' »universalitédu besoin d'art » est essentielle.
L'homme par la pensée et la conscience ne se contente pas d'être maiss'extériorise .
En cherchant à se représenter à lui-même, il naît l'aspiration naturelle de transformer le monde avecl'homme.
A croire que par nature « l'homme ne veut pas rester tel que la nature l'a fait ».
L'objet culturel est unmoyen d'expression ou même d'exister.
Dans une dimension symbolique on comprend par la suite que cette tendanceest innée, d'où une nouvelle révélation.
« On sait déjà cette tendance dans les premières impulsions de l'enfant »5Hegel°.
L'enfant, adulte en puissance qui, encore rattaché aux instincts des animaux et dénué de la conscience desoi témoigne de la nécessité de l'objet culturel et par la même occasion de la relativité de la représentation de cedernier.
L'objet culturel est précisément le fait que l'homme soit sujet de ses propres actions, c'est-à-dire qu'il faitles choses non parce qu'il est mécaniquement dirigé par des pulsions aveugles, mais parce qu'il trouve un sens etqu'il adhère à certaines valeurs etc.
Si aujourd'hui les moyens techniques nés avant ou avec une générationsemblent aller de soi, cela révèle l'expérience de la diversité humaine et la science de la pensée humaine.
N'est pasnaturel ce qui est inhabituel.
Est inhabituel ce qui choque le sens commun ou le bon ordre.
Il existe des frontièresmême des formes de la pensée et des contenus du pensable qui sont en question.
Dans une dimension presque psychanalyste, il est possible d'y adjoindre l'histoire d'une peur ancestrale,originelle voir naturelle.
C'est une question existentielle (Merleau-Ponty).
Depuis la malédiction biblique, l'hommechassé du « monde-nature » est condamné à craindre le mal autour et en lui.
De tout temps, il a cherché lesmoyens de se protéger et de survivre dans un milieu donné.
Plus qu'une peur, il s'agit d'une quête de liberté.
Par les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Il y a un objet culturel qui va jouer un rôle essentiel dans la perception d'autrui : c'est le langage.
- Peut-on dire que la casserole est un objet culturel ?
- Objet d’étude : un mouvement littéraire et culturel - Siècle des lumières
- Il y a … un objet culturel qui va jouer un rôle essentiel dans la perception d'autrui: c'est le langage. Dans l'expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun… Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p.407. Commentez cette citation.
- De manière traditionnelle le droit constitutionnel a pour objet l’Etat et la Constitution. Pourquoi ?