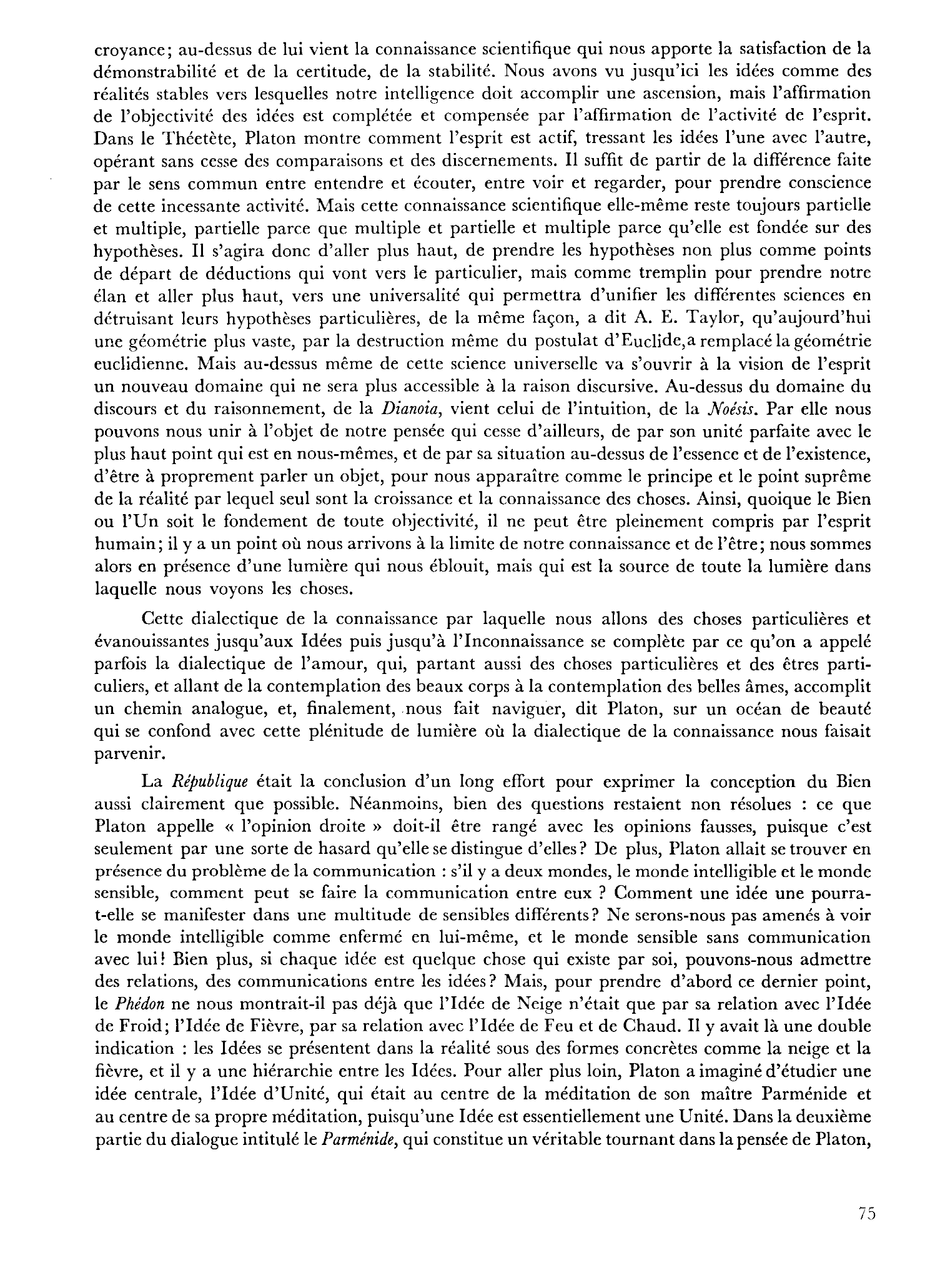Qui était PLATON ?
Publié le 08/06/2009

Extrait du document
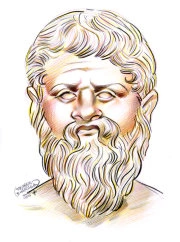
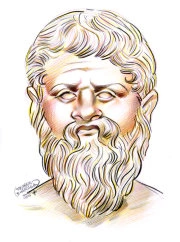
«
r
1
croyance; au-dessus de lui vient la connaissance scientifique qui nous apporte la satisfaction de la
démonstrabilité
et de la certitude, de la stabilité.
Nous avons vu jusqu'ici les idées comme des
réalités stables vers lesquelles
notre intelligence doit accomplir une ascension, mais l'affirmation
de l'objectivité des idées est complétée et compensée par l'affirmation de l'activité de l'esprit.
Dans le Théetète, Platon montre comment l'esprit est actif, tressant les idées l'une avec l'autre,
opérant sans cesse des comparaisons et des discernements.
Il suffit de partir de la différence faite
par le sens commun entre entendre et écouter, entre voir et regarder, pour prendre conscience
de cette incessante activité.
Mais cette connaissance scientifique elle-même reste toujours partielle
et multiple, partielle parce que multiple et partielle et multiple parce qu'elle est fondée sur des
hypothèses.
Il s'agira donc d'aller plus haut, de prendre les hypothèses non plus comme points
de départ de déductions qui vont vers le particulier, mais comme tremplin pour prendre notre
élan et aller plus haut, vers une universalité qui permettra d'unifier les différentes sciences en
détruisant leurs hypothèses particulières, de la même façon, a dit A.
E.
Taylor, qu'aujourd'hui
une géométrie plus vaste, par la destruction même du postulat d'Euclide,a remplacé la géométrie
euclidienne.
Mais au-dessus même de cette science universelle va s'ouvrir à la vision de l'esprit
un nouveau domaine qui ne sera plus accessible à la raison discursive.
Au-dessus du domaine du
discours et du raisonnement, de la Dianoia, vient celui de l'intuition, de la Noésis.
Par elle nous
pouvons nous
unir à l'objet de notre pensée qui cesse d'ailleurs, de par son unité parfaite avec le
plus
haut point qui est en nous-mêmes, et de par sa situation au-dessus de l'essence et de l'existence,
d'être à proprement parler un objet, pour nous apparaître comme le principe et le point suprême
de la réalité par lequel seul sont la croissance et la connaissance des choses.
Ainsi, quoique le Bien
ou l'Un soit le fondement de toute ohjectivité, il ne peut être pleinement compris par l'esprit
humain; il y a un point où nous arrivons à la limite de notre connaissance et de l'être; nous sommes
alors en présence
d'une lumière qui nous éblouit, mais qui est la source de toute la lumière dans
laquelle nous voyons les choses.
Cette dialectique de la connaissance par laquelle nous allons des choses particulières et
évanouissantes jusqu'aux Idées puis jusqu'à l'Inconnaissance se complète par ce qu'on a appelé
parfois la dialectique de l'amour, qui, partant aussi des choses particulières et des êtres parti
culiers, et allant de la contemplation des beaux corps à la contemplation des belles âmes, accomplit
un chemin analogue, et, finalement, nous fait naviguer, dit Platon, sur un océan de beauté
qui se confond avec cette plénitude de lumière où la dialectique de la connaissance nous faisait
parvenir.
La République était la conclusion d'un long effort pour exprimer la conception du Bien
aussi
clairement que possible.
Néanmoins, bien des questions restaient non résolues : ce que
Platon appelle « l'opinion droite >> doit-il être rangé avec les opinions fausses, puisque c'est
seulement
par une sorte de hasard qu'elle se distingue d'elles? De plus, Platon allait se trouver en
présence du problème de la communication : s'il y a deux mondes, le monde intelligible et le monde
sensible, comment peut se faire la communication entre eux ? Comment une idée une pourra
t-elle se manifester dans une multitude de sensibles différents? Ne serons-nous pas amenés à voir
le
monde intelligible comme enfermé en lui-même, et le monde sensible sans communication
avec lui! Bien plus, si chaque idée est quelque chose qui existe par soi, pouvons-nous admettre
des relations, des communications entre les idées? Mais, pour prendre d'abord ce dernier point,
le
Phédon ne nous montrait-il pas déjà que l'Idée de Neige n'était que par sa relation avec l'Idée
de Froid; l'Idée de Fièvre, par sa relation avec l'Idée de Feu et de Chaud.
Il y avait là une double
indication : les Idées se présentent dans la réalité sous des formes concrètes comme la neige et la
fièvre, et il y a une hiérarchie entre les Idées.
Pour aller plus loin, Platon a imaginé d'étudier une
idée centrale, l'Idée d'Unité, qui était au centre de la méditation de son maître Parménide et
au centre de sa propre méditation, puisqu'une Idée est essentiellement une Unité.
Dans la deuxième
partie du dialogue intitulé le Parménide, qui constitue un véritable tournant dans la pensée de Platon,
75.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L’oeil est le miroir de l’âme » PLATON
- « Le corps est le tombeau de l’âme » PLATON Cratyle
- Présocratiques à Platon
- Analyse Gorgias Platon (481 b et 486 d): la rhétorique
- Platon et les philosophes-rois