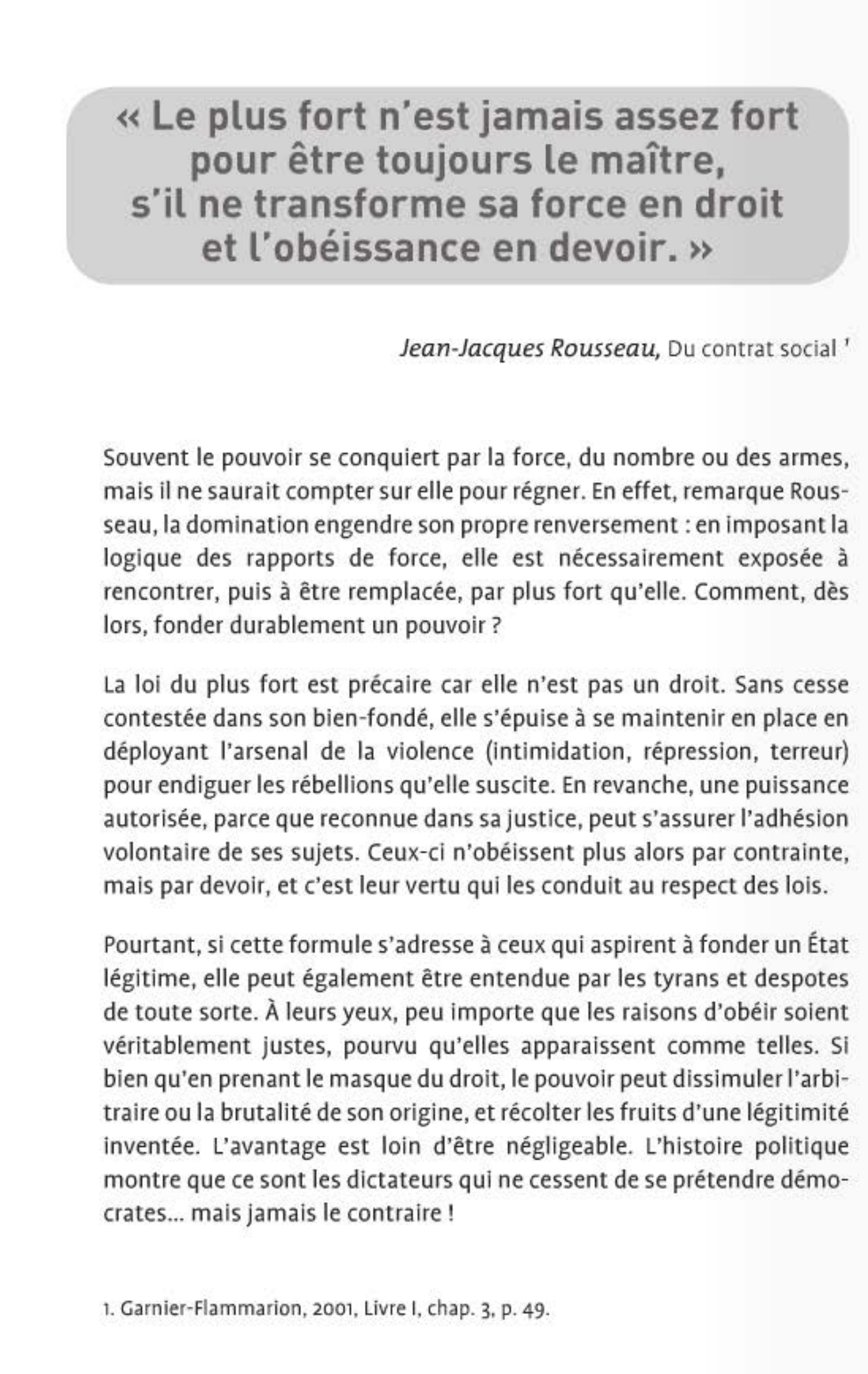Rousseau: La force ne fait pas le droit
Publié le 04/01/2004

Extrait du document

La force ne peut fonder le droit Le contrat social est une réflexion sur les fondements du droit : d'où vient l'autorité d'une règle de droit ? La force ne peut fonder le droit. D'abord parce que, par nature instable, elle ne peut fixer que des relations précaires entre les hommes. Mais surtout, force et droit renvoient à des réalités hétérogènes. Si le droit a besoin de la force pour se maintenir (dans son application), il ne peut y avoir recours pour se fonder (dans son principe). Cette hétérogénéité renvoie en dernier ressort à la disjonction soutenue par Rousseau entre le droit et le fait. Le droit exige une obéissance volontaire et non contrainte : la force me fait toujours plier, jamais consentir. En critiquant le droit du plus fort (1, 3), Rousseau récuse d'un même coup le droit d'esclavage et le droit de conquête. Au-delà, il cherche à renverser le vieux principe hérité de l'Ecclésiaste selon lequel on doit obéissance aux puissances établies.

«
a.
x
Cl>
a.
0
"' 0
..c.
a.
"' c
0
-
"' -
150
« Le plus fort n'est jamais assez fort
pour
être toujours le maître,
s'il ne transforme
sa force en droit
et l'obéissance en
devoir.»
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat soc ial '
Souvent
le pouvoir se conquiert par la force, du nombre ou des armes,
ma is il ne saura it com pter sur elle pour régner.
En effet, remarque Rous
seau, la domination engendre son propre renversement: en Imposant la
l ogique
des rapports de force, ell e est nécessairement exposée à
ren cont rer, puis à êt r e remplacée, par p lus fo rt qu'ell e.
Comment, d ès
lors, fo nde r du rableme nt un pouvoir?
La loi du p lu s fort est précaire car elle n'est pas un droit .
Sans cesse
contestée dans son b ie n-fondé, elle s'épu ise à se ma intenir en p l ace en
déployan t l'arsenal de la violen ce (int imi dat ion, répress ion, terreur)
pour endiguer
les rébellions qu'elle suscite.
En revan che, une puissance
autor i
sée , parce que reconnue dans sa just ice, peut s'assurer l'adhés ion
volontaire
de ses su j ets.
Ceux - cl n'obéissent plus alors par contrainte,
mals par devoir, et c'est leur vertu qui les conduit au respect des lois.
Pourtant, si cette formule s'adresse à ce u x qui asp irent à fonder un État
lég it ime , elle peut également être entendue par les tyrans et despotes
de toute sorte.
À leurs yeux, peu Importe que les raisons d'obéir soient
véritablement j ustes, pourvu qu'elles appa raiss ent comme telles.
Si
bie n qu 'en prenant le masque du droit , le po uvo ir p e ut d issimuler l'arb i
t raire ou la brutalité de son or ig ine, et récolter les fr uits d'une légit i mité
inventée .
L'avantage est lo in d'être négligeable.
L'histo i re pol iti que
montre que ce sont les dictateurs qui ne cessent de se prétendre démo
crates ...
mais jamais le contraire!
1.
Garnie r-F l amma rion, 200 1 , Liv re 1, chap.
3 .
p.
49..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DU CONTRAT SOCIAL ou Principes du droit politique. Traité de Jean-Jacques Rousseau (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE (Du) Jean-Jacques Rousseau. Traité
- CONTRAT SOCIAL (DU), ou Principes du droit politique, 1762. Jean-Jacques Rousseau (exposé de l’oeuvre)
- Le droit et la justice: Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social
- Rousseau: la liberté ; le droit.