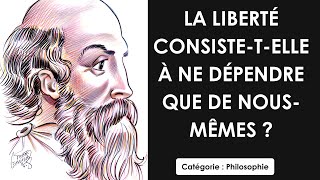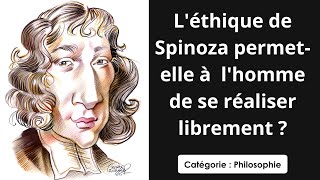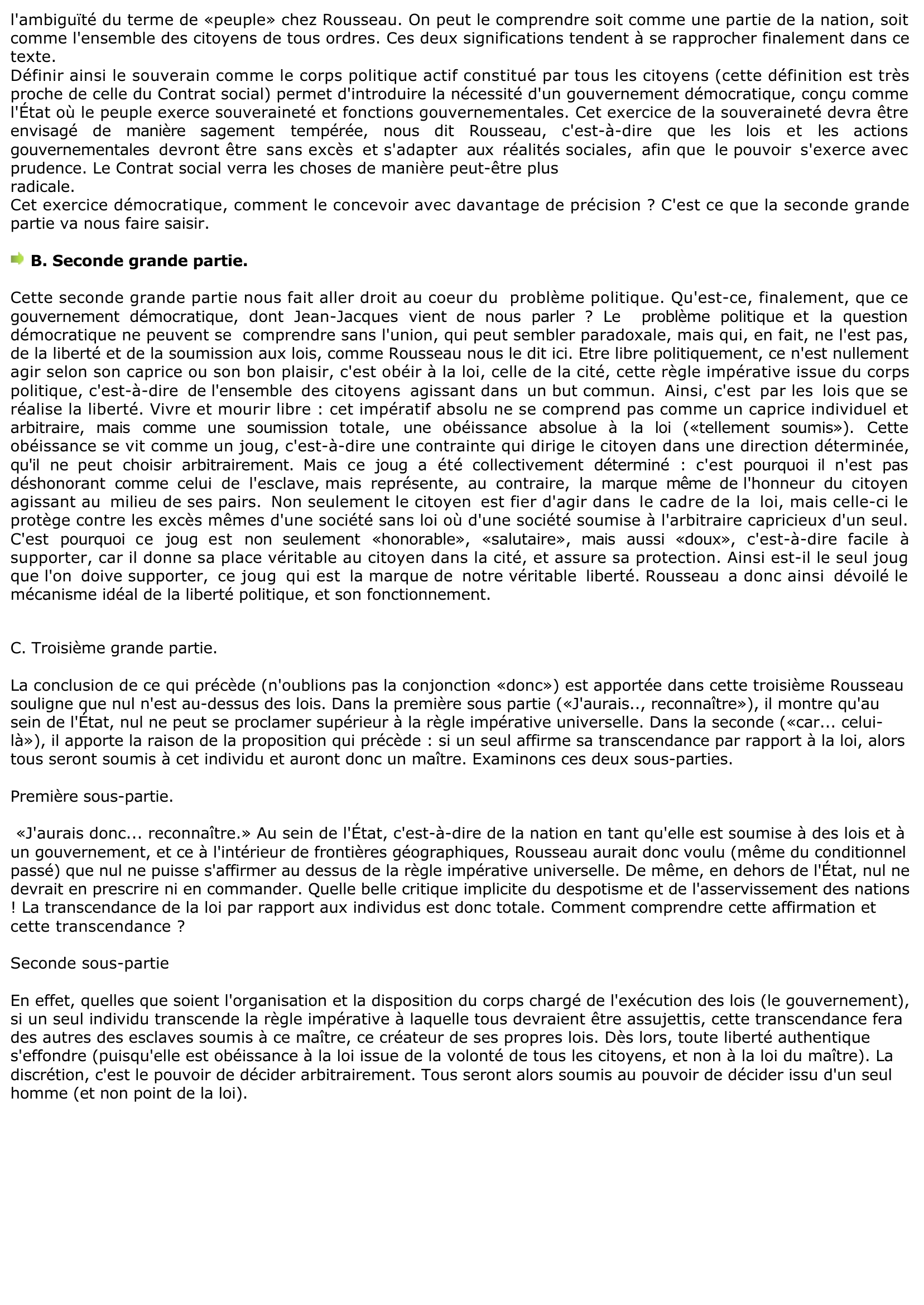ROUSSEAU: Souverain et la loi
Publié le 27/04/2005
Extrait du document

L'idée générale L'idée générale de ce texte est la suivante : la liberté, soumission aux lois, ne peut exister que si le souverain, créateur des lois, se confond complètement avec l'ensemble de la nation. Le problème Le problème posé par ce texte est celui de la nature et des conditions de la liberté. Rousseau y apporte une réponse nouvelle, bien que formulée classiquement (plus classiquement qu'elle ne le sera dans le Contrat social).

«
l'ambiguïté du terme de «peuple» chez Rousseau.
On peut le comprendre soit comme une partie de la nation, soitcomme l'ensemble des citoyens de tous ordres.
Ces deux significations tendent à se rapprocher finalement dans cetexte.Définir ainsi le souverain comme le corps politique actif constitué par tous les citoyens (cette définition est trèsproche de celle du Contrat social) permet d'introduire la nécessité d'un gouvernement démocratique, conçu commel'État où le peuple exerce souveraineté et fonctions gouvernementales.
Cet exercice de la souveraineté devra êtreenvisagé de manière sagement tempérée, nous dit Rousseau, c'est-à-dire que les lois et les actionsgouvernementales devront être sans excès et s'adapter aux réalités sociales, afin que le pouvoir s'exerce avecprudence.
Le Contrat social verra les choses de manière peut-être plusradicale.Cet exercice démocratique, comment le concevoir avec davantage de précision ? C'est ce que la seconde grandepartie va nous faire saisir.
B.
Seconde grande partie.
Cette seconde grande partie nous fait aller droit au coeur du problème politique.
Qu'est-ce, finalement, que cegouvernement démocratique, dont Jean-Jacques vient de nous parler ? Le problème politique et la questiondémocratique ne peuvent se comprendre sans l'union, qui peut sembler paradoxale, mais qui, en fait, ne l'est pas,de la liberté et de la soumission aux lois, comme Rousseau nous le dit ici.
Etre libre politiquement, ce n'est nullementagir selon son caprice ou son bon plaisir, c'est obéir à la loi, celle de la cité, cette règle impérative issue du corpspolitique, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens agissant dans un but commun.
Ainsi, c'est par les lois que seréalise la liberté.
Vivre et mourir libre : cet impératif absolu ne se comprend pas comme un caprice individuel etarbitraire, mais comme une soumission totale, une obéissance absolue à la loi («tellement soumis»).
Cetteobéissance se vit comme un joug, c'est-à-dire une contrainte qui dirige le citoyen dans une direction déterminée,qu'il ne peut choisir arbitrairement.
Mais ce joug a été collectivement déterminé : c'est pourquoi il n'est pasdéshonorant comme celui de l'esclave, mais représente, au contraire, la marque même de l'honneur du citoyenagissant au milieu de ses pairs.
Non seulement le citoyen est fier d'agir dans le cadre de la loi, mais celle-ci leprotège contre les excès mêmes d'une société sans loi où d'une société soumise à l'arbitraire capricieux d'un seul.C'est pourquoi ce joug est non seulement «honorable», «salutaire», mais aussi «doux», c'est-à-dire facile àsupporter, car il donne sa place véritable au citoyen dans la cité, et assure sa protection.
Ainsi est-il le seul jougque l'on doive supporter, ce joug qui est la marque de notre véritable liberté.
Rousseau a donc ainsi dévoilé lemécanisme idéal de la liberté politique, et son fonctionnement.
C.
Troisième grande partie.
La conclusion de ce qui précède (n'oublions pas la conjonction «donc») est apportée dans cette troisième Rousseausouligne que nul n'est au-dessus des lois.
Dans la première sous partie («J'aurais.., reconnaître»), il montre qu'ausein de l'État, nul ne peut se proclamer supérieur à la règle impérative universelle.
Dans la seconde («car...
celui-là»), il apporte la raison de la proposition qui précède : si un seul affirme sa transcendance par rapport à la loi, alorstous seront soumis à cet individu et auront donc un maître.
Examinons ces deux sous-parties.
Première sous-partie.
«J'aurais donc...
reconnaître.» Au sein de l'État, c'est-à-dire de la nation en tant qu'elle est soumise à des lois et àun gouvernement, et ce à l'intérieur de frontières géographiques, Rousseau aurait donc voulu (même du conditionnelpassé) que nul ne puisse s'affirmer au dessus de la règle impérative universelle.
De même, en dehors de l'État, nul nedevrait en prescrire ni en commander.
Quelle belle critique implicite du despotisme et de l'asservissement des nations! La transcendance de la loi par rapport aux individus est donc totale.
Comment comprendre cette affirmation etcette transcendance ?
Seconde sous-partie
En effet, quelles que soient l'organisation et la disposition du corps chargé de l'exécution des lois (le gouvernement),si un seul individu transcende la règle impérative à laquelle tous devraient être assujettis, cette transcendance ferades autres des esclaves soumis à ce maître, ce créateur de ses propres lois.
Dès lors, toute liberté authentiques'effondre (puisqu'elle est obéissance à la loi issue de la volonté de tous les citoyens, et non à la loi du maître).
Ladiscrétion, c'est le pouvoir de décider arbitrairement.
Tous seront alors soumis au pouvoir de décider issu d'un seulhomme (et non point de la loi)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rousseau (1712 - 1778) : Du contrat social (1762) Plan I - Présentation II - Le Souverain III - La souveraineté et la volonté générale IV - La loi V - Le gouvernement VI - La religion civile - Conclusion (analyse et résumé)
- « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » Rousseau
- La loi comme émanation de la volonté générale : Rousseau
- Selon Rousseau, la religion est une religion civile instituée par le souverain dans le cadre de l'Etat républicain. Est-ce vrai ?
- Rousseau écrit: l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Cette liberté vous paraît-elle être la condition de la moralité ?