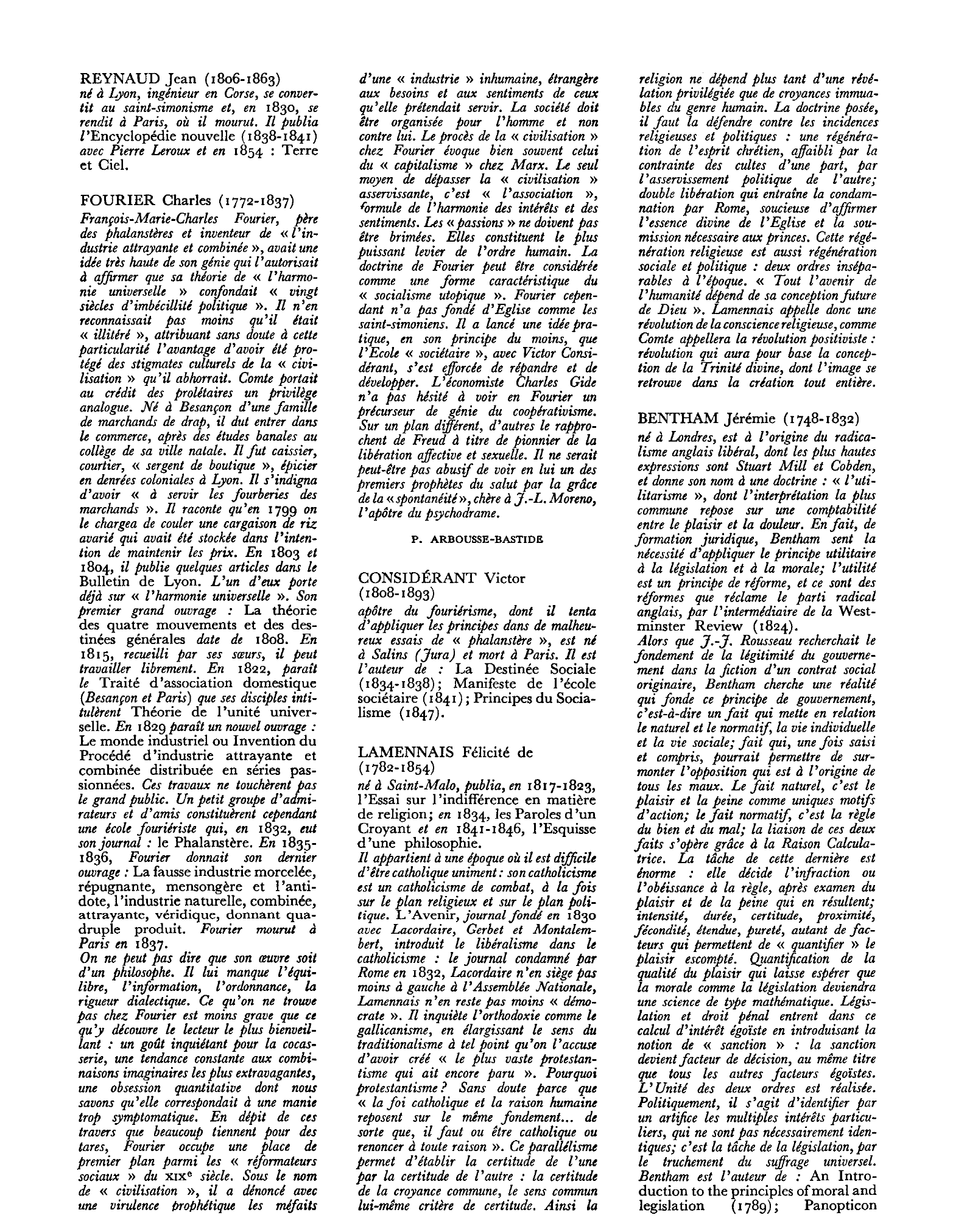substituer l'évidence de l'autorité à l'autorité de l'évidence ».
Publié le 21/10/2012

Extrait du document
«
REYNAUD Jean (18o6-I863) né à Lyon, ingénieur en Corse, se conver tit au saint-simonisme et, en I 830, se rendit à Paris, où il mourut.
Il publia l'Encyclopédie nouvelle ( I 838- I 84 I) avec Pierre Leroux et en 1854 : Terre et Ciel.
FOURIER Charles (1772-1837)
François-Marie-Charles Fourier, père des phalanstères et inventeur de « l'in dustrie attrayante et combinée », avait une idée très haute de son génie qui l'autorisait
à affirmer que sa théorie de « l' harmo nie universelle » confondait « vingt siècles d'imbécillité politique ».
Il n 'en reconnaissait pas moins qu'il était « illitéré », attribuant sans doute à cette particularité l'avantage d'avoir été pro tégé des stigmates culturels de la « civi
lisation » qu'il abhorrait.
Comte portait au crédit des prolétaires un privilège analogue.
Né à Besançon d'une famille de marchands de drap, il dut entrer dans le commerce, après des études banales au collège de sa ville natale.
Il fut caissier, courtier, « sergent de boutique », épicier en denrées coloniales à Lyon.
Il s'indigna
d'avoir « à servir les fourberies des marchands ».
Il raconte qu'en I 799 on le chargea de couler une cargaison de riz avarié qui avait été stockée dans l'inten tion de maintenir les prix.
En I 803 et I 804, il publie quelques articles dans le Bulletin de Lyon.
L'un d'eux porte déjà sur « l'harmonie universelle ».
Son premier grand ouvrage : La théorie
des quatre mouvements et des des
tinées générales date de 18o8.
En I 8 I 5, recueilli par ses sœurs, il peut travailler librement.
En I 822, paraît le Traité d'association domestique (Besançon et Paris) que ses disciples inti tulèrent Théorie de 1 'unité univer
selle.
En 1829 paraît un nouvel ouvrage: Le monde industriel ou Invention du Procédé d'industrie attrayante et combinée distribuée en séries pas
sionnées.
Ces travaux ne touchèrent pas le grand public.
Un petit groupe d'admi rateurs et d'amis constituèrent cependant une école fouriériste qui, en I 832, eut sonjournal : le Phalanstère.
En I835-
1836, Fourier donnait son dernier ouvrage : La fausse industrie morcelée, répugnante, mensongère et 1 'anti dote, 1 'industrie naturelle, combinée, attrayante, véridique, donnant qua druple produit.
Fourier mourut à
Paris en 1837· On ne peut pas dire que son œuvre soit
d'un philosophe.
Il lui manque l'équi libre, l'iriformation, l'ordonnance, la rigueur dialectique.
Ce qu'on ne trouve pas chez Fourier est moins grave que ce qu y découvre le lecteur le plus bienveil lant : un goût inquiétant pour la cocas serie, une tendance constante aux combi naisons imaginaires les plus extravagantes, une obsession quantitative dont nous savons qu'elle correspondait à une manie trop symptomatique.
En dépit de ces travers que beaucoup tiennent pour des tares, Fourier occupe une place de premier plan parmi les « réformateurs sociaux » du XIX 0 siècle.
Sous le nom de « civilisation », il a dénoncé avec une virulence Prophétique les méfaits d'une
« industrie » inhumaine, étrangère aux besoins et aux sentiments de ceux qu'elle prétendait servir.
La société doit ltre organisée pour l'homme et non contre lui.
Le procès de la « civilisation » chez Fourier évoque bien souvent celui du « capitalisme » chez Marx.
Le seul moyen de dépasser la « civilisation » asservissante, c'est « l 'association », ~"ormule de l'harmonie des intérlts et des sentiments.
Les « passions » ne doivent pas ltre brimées.
Elles constituent le plus
puissant levier de l'ordre humain.
La doctrine de Fourier peut ltre considérée comme une forme caractéristique du « socialisme utopique ».
Fourier cepen dant n'a pas fondé d'Eglise comme les saint-simoniens.
Il a lancé une idée pra tique, en son principe du moins, que l'Ecole « sociétaire », avec Victor Consi dérant, s'est efforcée de répandre et de développer.
L'économiste Charles Gide n'a pas hésité à voir en Fourier un précurseur de génie du coopérativisme.
Sur un plan différent, d'autres le rappro chent de Freud à titre de pionnier de la libération affective et sexuelle.
Il ne serait peut-ltre pas abusif de voir en lui un des premiers prophètes du salut par la grâce de la «spontanéité», chère à J.-L.
Moreno, l'apôtre du psychodrame.
P.
ARBOUSSE-BASTIDE
CONSIDÉRANT Victor ( 1 8o8- 1 893)
apôtre du fouriérisme, dont il tenta d'appliquer les principes dans de malheu reux essais de « phalanstère », est né à Salins (Jura) et mort à Paris.
Il est l'auteur de : La Destinée Sociale
(1834-1838); Manifeste de l'école sociétaire ( 1841); Principes du Socia
lisme (1847).
LAMENNAIS Félicité de (1782-1854)
né à Saint-Malo, publia, en 1817-1823, 1 'Essai sur l'indifférence en matière de religion; en I 834, les Paroles d'un Croyant et en 1841-1846, 1 'Esquisse d'une philosophie.
Il appartient à une époque où il est difficile
d'être catholique uniment: son catholicisme est un catholicisme de combat, à la fois sur le plan religieux et sur le plan poli
tique.
L'Avenir, journal fondé en 1830 avec Lacordaire, Gerbet et Montalem bert, introduit le libéralisme dans le catholicisme : le journal condamné par Rome en 1832, Lacordaire n'en siège pas moins à gauche à l'Assemblée Nationale,
Lamennais n'en reste pas moins « démo crate ».
Il inquiète l'orthodoxie comme le gallicanisme, en élargissant le sens du traditionalisme à tel point qu'on l'accuse d'avoir créé « le plus vaste protestan
tisme qui ait encore paru ».
Pourquoi protestantisme? Sans doute parce que « la foi catholique et la raison humaine reposent sur le même fondement...
de sorte que, il faut ou être catholique ou renoncer à toute raison ».
Ce parallélisme permet d'établir la certitude de l'une
par la certitude de l'autre : la certitude de la croyance commune, le sens commun lui-même critère de certitude.
Ainsi la
religion ne dépend plus tant d'une révé lation privilégiée que de croyances immua bles du genre humain.
La doctrine posée, il faut la défendre contre les incidences religieuses et politiques : une régénéra tion de l'esprit chrétien, affaibli par la contrainte des cultes d'une part, par
l'asservissement politique de l'autre; double libération qui entraine la condam nation par Rome, soucieuse d'affirmer l'essence divine de l'Eglise et la sou mission nécessaire aux princes.
Cette régé nération religieuse est aussi régénération sociale et politique : deux ordres insépa rables à l'époque.
« Tout l'avenir de l'humanité dépend de sa conception future de Dieu ».
Lamennais appelle donc une rivolution de la conscience religieuse, comme Comte appellera la révolution positiviste : révolution qui aura pour base la concep tion de la Trinité divine, dont l'image se retrouve dans la création tout entière.
BENTHAM Jérémie (1748-1832)
né à Londres, est à l'origine du radica lisme anglais libéral, dont les plus hautes expressions sont Stuart Mill et Cobden, et donne son nom à une doctrine : « l' uti
litarisme », dont l'interprétation la plus commune repose sur une comptabilité entre le plaisir et la douleur.
En fait, de formation juridique, Bentham sent la nécessité d'appliquer le principe utilitaire à la législation et à la morale; l'utilité est un principe de réforme, et ce sont des réformes que réclame le parti radical anglais, par l'intermédiaire de la West
minster Review (1824).
Alors que ].-].
Rousseau recherchait le fondement de la légitimité du gouverne ment dans la fiction d'un contrat social originaire, Bentham cherche une réalité qui fonde ce principe de gouvernement, c'est-à-dire un fait qui mette en relation le naturel et le normatif, la vie individuelle et la vie sociale; fait qui, une fois saisi et compris, pourrait permettre de sur monter l'opposition qui est à l'origine de tous les maux.
Le fait naturel, c'est le plaisir et la peine comme uniques motifs
d'action; le fait normatif, c'est la règle du bien et du mal; la liaison de ces deux faits s'opère grâce à la Raison Calcula trice.
La tâche de cette dernière est énorme : elle décide l' irifraction ou l'obéissance à la règle, après examen du plaisir et de la peine qui en résultent; intensité, durée, certitude, proximité,
fécondité, étendue, pureté, autant de fac teurs qui permettent de « quantifier » le plaisir escompté.
Quantification de la qualité du plaisir qui laisse espérer que la morale comme la législation deviendra une science de type mathématique.
Légis
lation et droit pénal entrent dans ce calcul d'intérêt égoïste en introduisant la notion de « sanction » : la sanction devient facteur de décision, au même titre que tous les autres facteurs égoïstes.
L'Unité des deux ordres est réalisée.
Politiquement, il s'agit d'identifier par un artifice les multiples intérêts particu
liers, qui ne sont pas nécessairement iden tiques; c'est la tâche de la législation, par le truchement du suffrage universel.
Bentham est l'auteur de : An Intro duction to the principles of moral and legislation ( 1 789); Panopticon.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La technique peut-elle se substituer à l’humain ?
- td droit civil séance 8 l'exercice de l'autorité parentale et ses limites
- HUIT QUESTIONS A PROPOS DE L’AUTORITÉ PONTIFICALE (résumé et analyse)
- Lire un récit policier (4) : étudier la progression du récit 2 Découvrir L'évolution des personnages Mettre en évidence qu'entre le début et la fin du roman, beaucoup de choses ont changé : les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes, les rôles se sont parfois inversés.
- Si pour Descartes aucune preuve n'est nécessaire, si l'expérience suffit c'est parce que l'évidence du libre-arbitre est liée à notre conscience. Être conscient c'est en effet se savoir être, se savoir exister, et donc être face à la réalité qui nous entoure : j'ai le choix de faire ou non des études, j'ai le choix de pratiquer ou non un sport etc. On voit ainsi qu'être un être conscient c'est se sentir libre. La conscience nous donne l'intuition de notre existence, de notre présence a