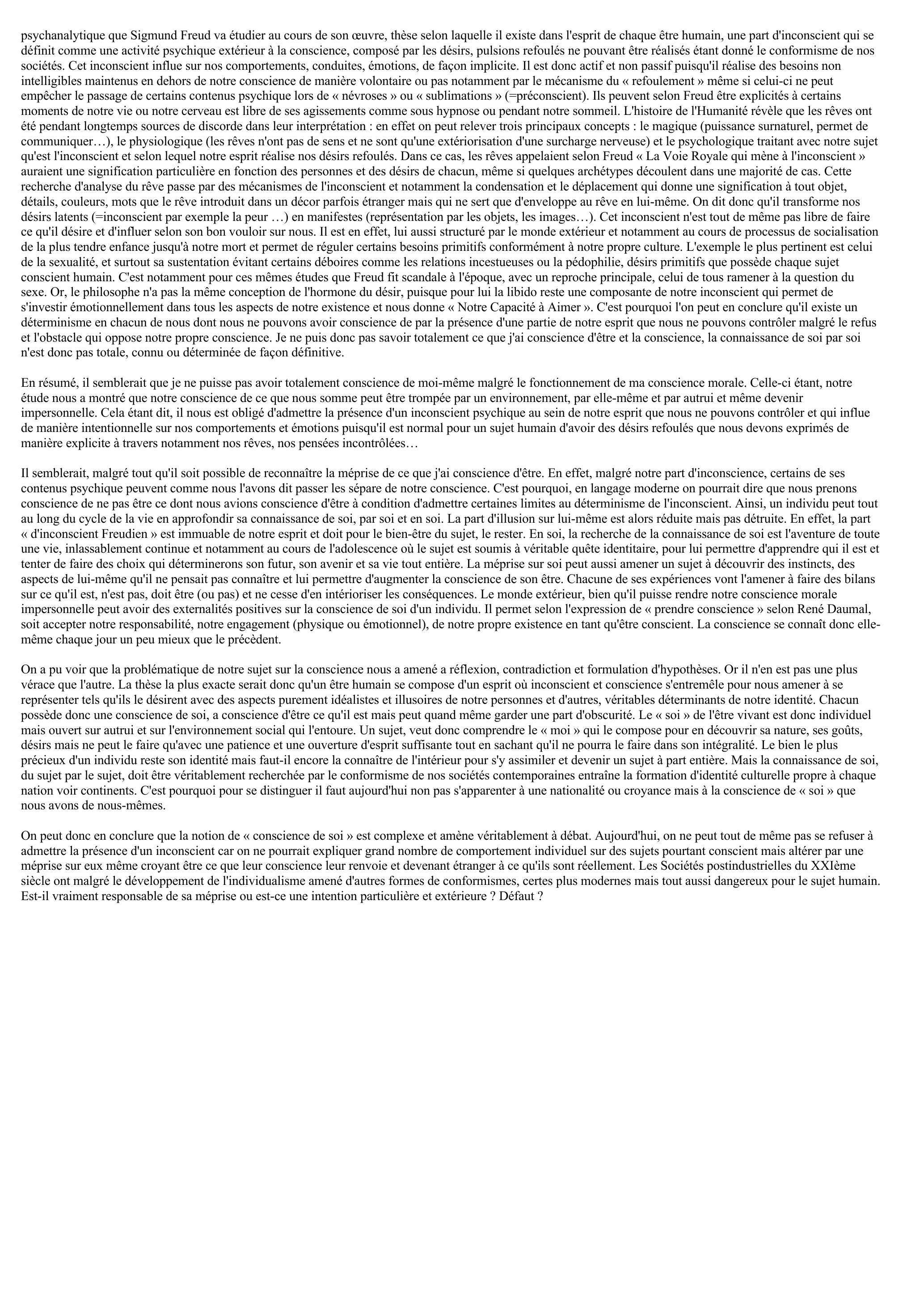Suis-je conscient de moi-même ?
Publié le 24/07/2012

Extrait du document
En résumé, il semblerait que je ne puisse pas avoir totalement conscience de moi-même malgré le fonctionnement de ma conscience morale. Celle-ci étant, notre étude nous a montré que notre conscience de ce que nous somme peut être trompée par un environnement, par elle-même et par autrui et même devenir impersonnelle. Cela étant dit, il nous est obligé d’admettre la présence d’un inconscient psychique au sein de notre esprit que nous ne pouvons contrôler et qui influe de manière intentionnelle sur nos comportements et émotions puisqu’il est normal pour un sujet humain d’avoir des désirs refoulés que nous devons exprimés de manière explicite à travers notamment nos rêves, nos pensées incontrôlées…
«
psychanalytique que Sigmund Freud va étudier au cours de son œuvre, thèse selon laquelle il existe dans l'esprit de chaque être humain, une part d'inconscient qui sedéfinit comme une activité psychique extérieur à la conscience, composé par les désirs, pulsions refoulés ne pouvant être réalisés étant donné le conformisme de nossociétés.
Cet inconscient influe sur nos comportements, conduites, émotions, de façon implicite.
Il est donc actif et non passif puisqu'il réalise des besoins nonintelligibles maintenus en dehors de notre conscience de manière volontaire ou pas notamment par le mécanisme du « refoulement » même si celui-ci ne peutempêcher le passage de certains contenus psychique lors de « névroses » ou « sublimations » (=préconscient).
Ils peuvent selon Freud être explicités à certainsmoments de notre vie ou notre cerveau est libre de ses agissements comme sous hypnose ou pendant notre sommeil.
L'histoire de l'Humanité révèle que les rêves ontété pendant longtemps sources de discorde dans leur interprétation : en effet on peut relever trois principaux concepts : le magique (puissance surnaturel, permet decommuniquer…), le physiologique (les rêves n'ont pas de sens et ne sont qu'une extériorisation d'une surcharge nerveuse) et le psychologique traitant avec notre sujetqu'est l'inconscient et selon lequel notre esprit réalise nos désirs refoulés.
Dans ce cas, les rêves appelaient selon Freud « La Voie Royale qui mène à l'inconscient »auraient une signification particulière en fonction des personnes et des désirs de chacun, même si quelques archétypes découlent dans une majorité de cas.
Cetterecherche d'analyse du rêve passe par des mécanismes de l'inconscient et notamment la condensation et le déplacement qui donne une signification à tout objet,détails, couleurs, mots que le rêve introduit dans un décor parfois étranger mais qui ne sert que d'enveloppe au rêve en lui-même.
On dit donc qu'il transforme nosdésirs latents (=inconscient par exemple la peur …) en manifestes (représentation par les objets, les images…).
Cet inconscient n'est tout de même pas libre de fairece qu'il désire et d'influer selon son bon vouloir sur nous.
Il est en effet, lui aussi structuré par le monde extérieur et notamment au cours de processus de socialisationde la plus tendre enfance jusqu'à notre mort et permet de réguler certains besoins primitifs conformément à notre propre culture.
L'exemple le plus pertinent est celuide la sexualité, et surtout sa sustentation évitant certains déboires comme les relations incestueuses ou la pédophilie, désirs primitifs que possède chaque sujetconscient humain.
C'est notamment pour ces mêmes études que Freud fit scandale à l'époque, avec un reproche principale, celui de tous ramener à la question dusexe.
Or, le philosophe n'a pas la même conception de l'hormone du désir, puisque pour lui la libido reste une composante de notre inconscient qui permet des'investir émotionnellement dans tous les aspects de notre existence et nous donne « Notre Capacité à Aimer ».
C'est pourquoi l'on peut en conclure qu'il existe undéterminisme en chacun de nous dont nous ne pouvons avoir conscience de par la présence d'une partie de notre esprit que nous ne pouvons contrôler malgré le refuset l'obstacle qui oppose notre propre conscience.
Je ne puis donc pas savoir totalement ce que j'ai conscience d'être et la conscience, la connaissance de soi par soin'est donc pas totale, connu ou déterminée de façon définitive.
En résumé, il semblerait que je ne puisse pas avoir totalement conscience de moi-même malgré le fonctionnement de ma conscience morale.
Celle-ci étant, notreétude nous a montré que notre conscience de ce que nous somme peut être trompée par un environnement, par elle-même et par autrui et même devenirimpersonnelle.
Cela étant dit, il nous est obligé d'admettre la présence d'un inconscient psychique au sein de notre esprit que nous ne pouvons contrôler et qui influede manière intentionnelle sur nos comportements et émotions puisqu'il est normal pour un sujet humain d'avoir des désirs refoulés que nous devons exprimés demanière explicite à travers notamment nos rêves, nos pensées incontrôlées…
Il semblerait, malgré tout qu'il soit possible de reconnaître la méprise de ce que j'ai conscience d'être.
En effet, malgré notre part d'inconscience, certains de sescontenus psychique peuvent comme nous l'avons dit passer les sépare de notre conscience.
C'est pourquoi, en langage moderne on pourrait dire que nous prenonsconscience de ne pas être ce dont nous avions conscience d'être à condition d'admettre certaines limites au déterminisme de l'inconscient.
Ainsi, un individu peut toutau long du cycle de la vie en approfondir sa connaissance de soi, par soi et en soi.
La part d'illusion sur lui-même est alors réduite mais pas détruite.
En effet, la part« d'inconscient Freudien » est immuable de notre esprit et doit pour le bien-être du sujet, le rester.
En soi, la recherche de la connaissance de soi est l'aventure de touteune vie, inlassablement continue et notamment au cours de l'adolescence où le sujet est soumis à véritable quête identitaire, pour lui permettre d'apprendre qui il est ettenter de faire des choix qui déterminerons son futur, son avenir et sa vie tout entière.
La méprise sur soi peut aussi amener un sujet à découvrir des instincts, desaspects de lui-même qu'il ne pensait pas connaître et lui permettre d'augmenter la conscience de son être.
Chacune de ses expériences vont l'amener à faire des bilanssur ce qu'il est, n'est pas, doit être (ou pas) et ne cesse d'en intérioriser les conséquences.
Le monde extérieur, bien qu'il puisse rendre notre conscience moraleimpersonnelle peut avoir des externalités positives sur la conscience de soi d'un individu.
Il permet selon l'expression de « prendre conscience » selon René Daumal,soit accepter notre responsabilité, notre engagement (physique ou émotionnel), de notre propre existence en tant qu'être conscient.
La conscience se connaît donc elle-même chaque jour un peu mieux que le précèdent.
On a pu voir que la problématique de notre sujet sur la conscience nous a amené a réflexion, contradiction et formulation d'hypothèses.
Or il n'en est pas une plusvérace que l'autre.
La thèse la plus exacte serait donc qu'un être humain se compose d'un esprit où inconscient et conscience s'entremêle pour nous amener à sereprésenter tels qu'ils le désirent avec des aspects purement idéalistes et illusoires de notre personnes et d'autres, véritables déterminants de notre identité.
Chacunpossède donc une conscience de soi, a conscience d'être ce qu'il est mais peut quand même garder une part d'obscurité.
Le « soi » de l'être vivant est donc individuelmais ouvert sur autrui et sur l'environnement social qui l'entoure.
Un sujet, veut donc comprendre le « moi » qui le compose pour en découvrir sa nature, ses goûts,désirs mais ne peut le faire qu'avec une patience et une ouverture d'esprit suffisante tout en sachant qu'il ne pourra le faire dans son intégralité.
Le bien le plusprécieux d'un individu reste son identité mais faut-il encore la connaître de l'intérieur pour s'y assimiler et devenir un sujet à part entière.
Mais la connaissance de soi,du sujet par le sujet, doit être véritablement recherchée par le conformisme de nos sociétés contemporaines entraîne la formation d'identité culturelle propre à chaquenation voir continents.
C'est pourquoi pour se distinguer il faut aujourd'hui non pas s'apparenter à une nationalité ou croyance mais à la conscience de « soi » quenous avons de nous-mêmes.
On peut donc en conclure que la notion de « conscience de soi » est complexe et amène véritablement à débat.
Aujourd'hui, on ne peut tout de même pas se refuser àadmettre la présence d'un inconscient car on ne pourrait expliquer grand nombre de comportement individuel sur des sujets pourtant conscient mais altérer par uneméprise sur eux même croyant être ce que leur conscience leur renvoie et devenant étranger à ce qu'ils sont réellement.
Les Sociétés postindustrielles du XXIèmesiècle ont malgré le développement de l'individualisme amené d'autres formes de conformismes, certes plus modernes mais tout aussi dangereux pour le sujet humain.Est-il vraiment responsable de sa méprise ou est-ce une intention particulière et extérieure ? Défaut ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- suffit il d'etre conscient de soi pour se connaitre soi meme
- Philosophie : Le sujet est-il conscient de lui-même ?
- Conscient-Inconscient Peut-on ne pas savoir ce que l'on fait
- Qu’est que la Conscience et le Conscient ?
- Si pour Descartes aucune preuve n'est nécessaire, si l'expérience suffit c'est parce que l'évidence du libre-arbitre est liée à notre conscience. Être conscient c'est en effet se savoir être, se savoir exister, et donc être face à la réalité qui nous entoure : j'ai le choix de faire ou non des études, j'ai le choix de pratiquer ou non un sport etc. On voit ainsi qu'être un être conscient c'est se sentir libre. La conscience nous donne l'intuition de notre existence, de notre présence a