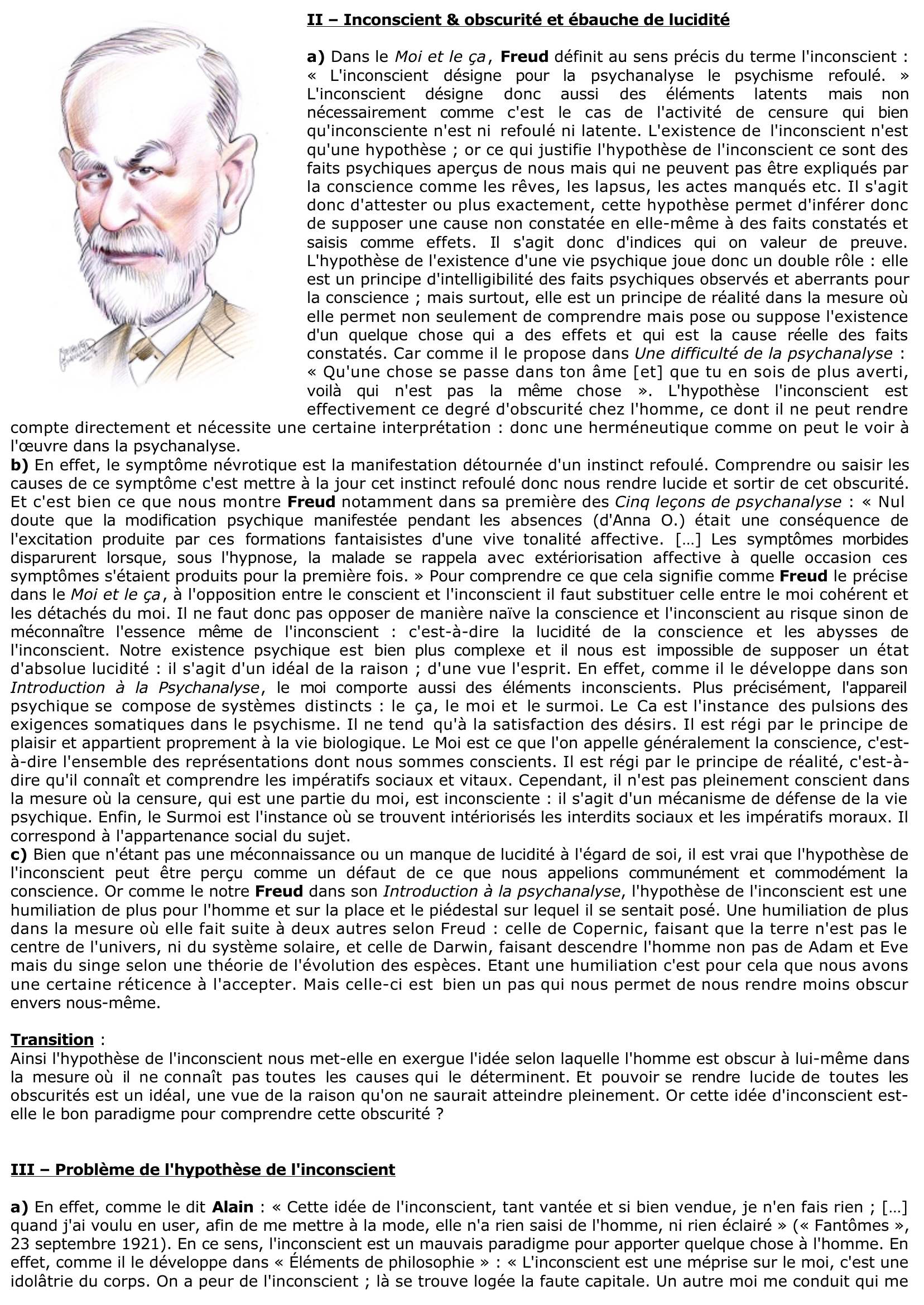Suis-je obscur à moi-même ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
II – Inconscient & obscurité et ébauche de lucidité a) Dans le Moi et le ça , Freud définit au sens précis du terme l'inconscient : « L'inconscient désigne pour la psychanalyse le psychisme refoulé.
»L'inconscient désigne donc aussi des éléments latents mais nonnécessairement comme c'est le cas de l'activité de censure qui bienqu'inconsciente n'est ni refoulé ni latente.
L'existence de l'inconscient n'estqu'une hypothèse ; or ce qui justifie l'hypothèse de l'inconscient ce sont desfaits psychiques aperçus de nous mais qui ne peuvent pas être expliqués parla conscience comme les rêves, les lapsus, les actes manqués etc.
Il s'agitdonc d'attester ou plus exactement, cette hypothèse permet d'inférer doncde supposer une cause non constatée en elle-même à des faits constatés etsaisis comme effets.
Il s'agit donc d'indices qui on valeur de preuve.L'hypothèse de l'existence d'une vie psychique joue donc un double rôle : elleest un principe d'intelligibilité des faits psychiques observés et aberrants pourla conscience ; mais surtout, elle est un principe de réalité dans la mesure oùelle permet non seulement de comprendre mais pose ou suppose l'existenced'un quelque chose qui a des effets et qui est la cause réelle des faitsconstatés.
Car comme il le propose dans Une difficulté de la psychanalyse : « Qu'une chose se passe dans ton âme [et] que tu en sois de plus averti,voilà qui n'est pas la même chose ».
L'hypothèse l'inconscient esteffectivement ce degré d'obscurité chez l'homme, ce dont il ne peut rendre compte directement et nécessite une certaine interprétation : donc une herméneutique comme on peut le voir àl'œuvre dans la psychanalyse.b) En effet, le symptôme névrotique est la manifestation détournée d'un instinct refoulé.
Comprendre ou saisir lescauses de ce symptôme c'est mettre à la jour cet instinct refoulé donc nous rendre lucide et sortir de cet obscurité.Et c'est bien ce que nous montre Freud notamment dans sa première des Cinq leçons de psychanalyse : « Nul doute que la modification psychique manifestée pendant les absences (d'Anna O.) était une conséquence del'excitation produite par ces formations fantaisistes d'une vive tonalité affective.
[…] Les symptômes morbidesdisparurent lorsque, sous l'hypnose, la malade se rappela avec extériorisation affective à quelle occasion cessymptômes s'étaient produits pour la première fois.
» Pour comprendre ce que cela signifie comme Freud le précise dans le Moi et le ça , à l'opposition entre le conscient et l'inconscient il faut substituer celle entre le moi cohérent et les détachés du moi.
Il ne faut donc pas opposer de manière naïve la conscience et l'inconscient au risque sinon deméconnaître l'essence même de l'inconscient : c'est-à-dire la lucidité de la conscience et les abysses del'inconscient.
Notre existence psychique est bien plus complexe et il nous est impossible de supposer un étatd'absolue lucidité : il s'agit d'un idéal de la raison ; d'une vue l'esprit.
En effet, comme il le développe dans sonIntroduction à la Psychanalyse , le moi comporte aussi des éléments inconscients.
Plus précisément, l'appareil psychique se compose de systèmes distincts : le ça, le moi et le surmoi.
Le Ca est l'instance des pulsions desexigences somatiques dans le psychisme.
Il ne tend qu'à la satisfaction des désirs.
Il est régi par le principe deplaisir et appartient proprement à la vie biologique.
Le Moi est ce que l'on appelle généralement la conscience, c'est-à-dire l'ensemble des représentations dont nous sommes conscients.
Il est régi par le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il connaît et comprendre les impératifs sociaux et vitaux.
Cependant, il n'est pas pleinement conscient dansla mesure où la censure, qui est une partie du moi, est inconsciente : il s'agit d'un mécanisme de défense de la viepsychique.
Enfin, le Surmoi est l'instance où se trouvent intériorisés les interdits sociaux et les impératifs moraux.
Ilcorrespond à l'appartenance social du sujet.c) Bien que n'étant pas une méconnaissance ou un manque de lucidité à l'égard de soi, il est vrai que l'hypothèse del'inconscient peut être perçu comme un défaut de ce que nous appelions communément et commodément laconscience.
Or comme le notre Freud dans son Introduction à la psychanalyse , l'hypothèse de l'inconscient est une humiliation de plus pour l'homme et sur la place et le piédestal sur lequel il se sentait posé.
Une humiliation de plusdans la mesure où elle fait suite à deux autres selon Freud : celle de Copernic, faisant que la terre n'est pas lecentre de l'univers, ni du système solaire, et celle de Darwin, faisant descendre l'homme non pas de Adam et Evemais du singe selon une théorie de l'évolution des espèces.
Etant une humiliation c'est pour cela que nous avonsune certaine réticence à l'accepter.
Mais celle-ci est bien un pas qui nous permet de nous rendre moins obscurenvers nous-même.
Transition : Ainsi l'hypothèse de l'inconscient nous met-elle en exergue l'idée selon laquelle l'homme est obscur à lui-même dansla mesure où il ne connaît pas toutes les causes qui le déterminent.
Et pouvoir se rendre lucide de toutes lesobscurités est un idéal, une vue de la raison qu'on ne saurait atteindre pleinement.
Or cette idée d'inconscient est-elle le bon paradigme pour comprendre cette obscurité ? III – Problème de l'hypothèse de l'inconscient a) En effet, comme le dit Alain : « Cette idée de l'inconscient, tant vantée et si bien vendue, je n'en fais rien ; […] quand j'ai voulu en user, afin de me mettre à la mode, elle n'a rien saisi de l'homme, ni rien éclairé » (« Fantômes »,23 septembre 1921).
En ce sens, l'inconscient est un mauvais paradigme pour apporter quelque chose à l'homme.
Eneffet, comme il le développe dans « Éléments de philosophie » : « L'inconscient est une méprise sur le moi, c'est uneidolâtrie du corps.
On a peur de l'inconscient ; là se trouve logée la faute capitale.
Un autre moi me conduit qui me.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MALLARMÉ L’OBSCUR. Charles Mauron (résumé)
- SATAN L’OBSCUR de Jean De Boschère : Fiche de lecture
- CLAIR-OBSCUR (résumé & analyse)
- Fiche de lecture : Thomas l'obscur
- THOMAS L’OBSCUR. (résumé & analyse) Maurice Blanchot