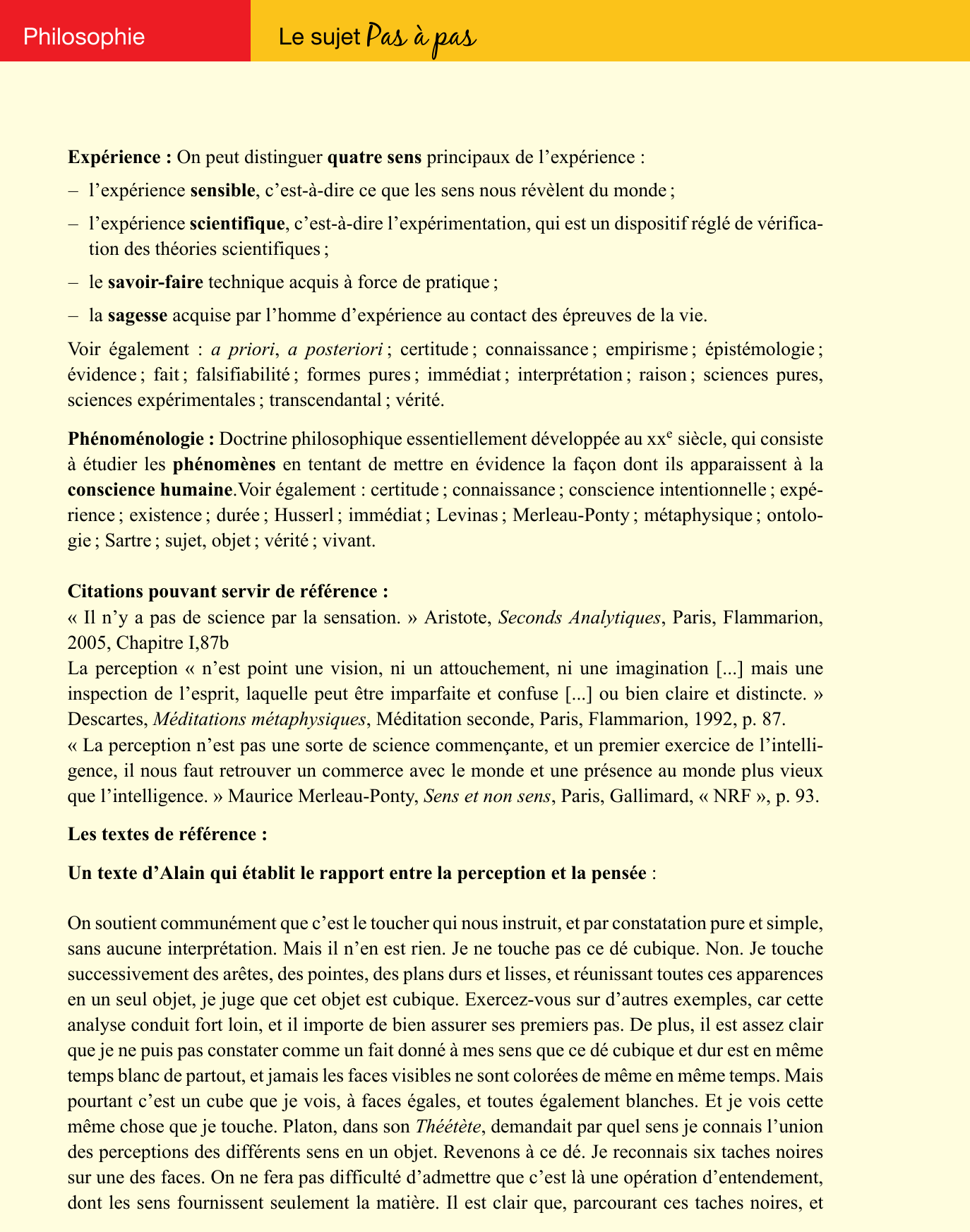Sujet 1, Amérique du Nord, mai 2013, série L Le sujet › Dissertation : Percevoir est-ce savoir ? Le sujet Pas à pas ® Comprendre le sujet Le sens du sujet : Dans ce sujet, il s'agit de se demander si on peut poser une équivalence entre l'acte de percevoir et celui de savoir, deux actes propres à l'homme. L'acte de percevoir désigne la saisie intuitive d'une réalité par la conscience. On le distinguera du simple fait de sentir, plus immédiat. L'acte de savoir désigne la possession d'une connaissance de ou sur quelque chose, qui ne prend pas nécessairement la forme d'une perception. D'où la question posée. L'opinion commune et sa remise en question : La réponse évidente à ce sujet est affirmative, dans la mesure où la perception nous délivre bien un certain savoir quand elle se produit. Pour savoir que ma main comporte cinq doigts, il suffit de la percevoir. Cependant, on peut objecter à cela que bien souvent mes perceptions sont trompeuses, et ne peuvent alors être identifiées à des savoirs. ® Mobiliser ses connaissances Aperception : Mot inventé par Leibniz et repris ensuite par Kant dans la Critique de la raison pure (aperception transcendantale), pour désigner l'acte par lequel un sujet opère un retour réflexif sur ses perceptions et en prend conscience. Leibniz oppose ainsi l'aperception aux « petites perceptions » qui sont des perceptions inconscientes.Voir également : analyse, synthèse ; sens ; sensible, intelligible. Connaissance : o Du latin cognitio, « action d'apprendre ». Activité de l'esprit par laquelle l'homme cherche à expliquer et à comprendre des données sensibles. o Le problème de l'origine et du fondement de la connaissance, ainsi que celui de ses limites, oppose en particulier Kant et les empiristes. Voir également : expérience ; sensible, intelligible ; sujet, objet ; théorie ; vérité. Conscience : Au sens général, la conscience est le savoir intérieur immédiat que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. La conscience exprime ainsi notre capacité de réflexion et le pouvoir que nous avons de viser autre chose que nous-mêmes. Son essence est selon Husserl l'« intentionnalité» .Voir également : conscience morale ; certitude ; cogito ; Descartes ; être pour soi, être en soi ; évidence ; intuition ; ipséité ; morale ; représentation ; Sartre. 7 Philosophie Le sujet Pas à pas Expérience : On peut distinguer quatre sens principaux de l'expérience : - l'expérience sensible, c'est-à-dire ce que les sens nous révèlent du monde ; - l'expérience scientifique, c'est-à-dire l'expérimentation, qui est un dispositif réglé de vérification des théories scientifiques ; - le savoir-faire technique acquis à force de pratique ; - la sagesse acquise par l'homme d'expérience au contact des épreuves de la vie. Voir également : a priori, a posteriori ; certitude ; connaissance ; empirisme ; épistémologie ; évidence ; fait ; falsifiabilité ; formes pures ; immédiat ; interprétation ; raison ; sciences pures, sciences expérimentales ; transcendantal ; vérité. Phénoménologie : Doctrine philosophique essentiellement développée au xxe siècle, qui consiste à étudier les phénomènes en tentant de mettre en évidence la façon dont ils apparaissent à la conscience humaine.Voir également : certitude ; connaissance ; conscience intentionnelle ; expérience ; existence ; durée ; Husserl ; immédiat ; Levinas ; Merleau-Ponty ; métaphysique ; ontologie ; Sartre ; sujet, objet ; vérité ; vivant. Citations pouvant servir de référence : « Il n'y a pas de science par la sensation. » Aristote, Seconds Analytiques, Paris, Flammarion, 2005, Chapitre I,87b La perception « n'est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination [...] mais une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse [...] ou bien claire et distincte. » Descartes, Méditations métaphysiques, Méditation seconde, Paris, Flammarion, 1992, p. 87. « La perception n'est pas une sorte de science commençante, et un premier exercice de l'intelligence, il nous faut retrouver un commerce avec le monde et une présence au monde plus vieux que l'intelligence. » Maurice Merleau-Ponty, Sens et non sens, Paris, Gallimard, « NRF », p. 93. Les textes de référence : Un texte d'Alain qui établit le rapport entre la perception et la pensée : On soutient communément que c'est le toucher qui nous instruit, et par constatation pure et simple, sans aucune interprétation. Mais il n'en est rien. Je ne touche pas ce dé cubique. Non. Je touche successivement des arêtes, des pointes, des plans durs et lisses, et réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge que cet objet est cubique. Exercez-vous sur d'autres exemples, car cette analyse conduit fort loin, et il importe de bien assurer ses premiers pas. De plus, il est assez clair que je ne puis pas constater comme un fait donné à mes sens que ce dé cubique et dur est en même temps blanc de partout, et jamais les faces visibles ne sont colorées de même en même temps. Mais pourtant c'est un cube que je vois, à faces égales, et toutes également blanches. Et je vois cette même chose que je touche. Platon, dans son Théétète, demandait par quel sens je connais l'union des perceptions des différents sens en un objet. Revenons à ce dé. Je reconnais six taches noires sur une des faces. On ne fera pas difficulté d'admettre que c'est là une opération d'entendement, dont les sens fournissent seulement la matière. Il est clair que, parcourant ces taches noires, et 8 Sujet 1 - Le sujet Pas à pas retenant l'ordre et la place de chacune, je forme enfin, et non sans peine au commencement, l'idée qu'elles sont six, c'est-à-dire deux fois trois, qui font cinq et un. Apercevez-vous la ressemblance entre cette action de compter et cette autre opération par laquelle je reconnais que des apparences successives, pour la main et pour l'oeil, me font connaître un cube ? Par où il apparaîtrait que la perception est déjà une fonction d'entendement. Alain, Les passions et la sagesse, Paris, Gallimard, « La Pléiade », p. 1060. Un texte de Leibniz qui montre que toutes nos perceptions ne sont pas conscientes : « D'ailleurs il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que ces impressions sont ou trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. [...] Et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est au rivage. Pour entendre ce bruit comme l'on fait, il faut bien qu'on entende les parties qui composent ce tout, c'est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensemble, et qu'ils ne se remarqueraient pas si cette vague qui le fait était seule. » Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, Paris, Flammarion, 1990, Préface, pp. 41-42. ® Procéder par étapes Identifier les difficultés particulières de ce sujet : La difficulté de ce sujet vient de sa formulation concise et de la difficulté de la notion de perception. En effet, la perception est une notion difficile à définir, et qu'il faut à la fois distinguer de la sensation, mais également de la pensée, bien que les deux y prennent part. En outre, il faut faire attention à ne pas identifier « savoir » à « vérité », un savoir pouvant parfois être faux. Problématiser le sujet : Le problème qui se pose est donc celui de comprendre pourquoi un acte intuitif peut être réduit à un certain savoir, bien que le savoir ne puisse être réduit à l'acte de percevoir. Trouver le plan : Nous verrons d'abord que la perception est une forme de savoir qui nous élève au-delà de la sensation, puis nous verrons que la perception ne peut cependant pas être identifiée au savoir discursif propre à l'entendement. 9 Philosophie Le corrigé Introduction La perception est un phénomène singulier : elle n'est ni la sensation, ni la pensée, ni le sentiment. Qu'est-elle donc ? On pourrait commencer par définir l'acte de percevoir comme la saisie intuitive par la conscience d'une réalité. Il s'agit donc d'un acte subjectif qui n'est pas seulement corporel comme la sensation, ni seulement intellectuel comme la compréhension. Cependant, cet acte qu'est la perception nous donne bien souvent accès à un savoir. Ainsi, par exemple, il suffit que je perçoive un arbre pour savoir qu'un arbre se trouve face à moi, comme il suffit que je perçoive de la fumée pour savoir qu'un feu doit être allumé quelque part. Mais la perception est aussi souvent trompeuse : il arrive que de loin, je prenne un chat pour un chien, ou quelqu'un pour un autre. Dès lors, la question se pose de savoir si on peut identifier l'acte de percevoir à l'acte de savoir, qui est un acte lui aussi spécifiquement humain qui consiste à posséder une connaissance de ou sur quelque chose et qui ne prend pas nécessairement la forme d'une perception. Ainsi, je sais que 2 et 2 font 4, alors que je n'ai pas de perception de cette vérité mais seulement un savoir théorique. Le problème qui se pose est donc celui de comprendre pourquoi un acte intuitif peut être réduit à un certain savoir, bien que le savoir ne puisse être réduit à l'acte de percevoir. Nous verrons d'abord que la perception est une forme de savoir qui nous élève au-delà de la sensation, puis nous verrons que la perception ne peut cependant pas être identifiée au savoir discursif propre à l'entendement. I. La perception est une forme de savoir qui nous élève au-delà de la sensation 1 Percevoir n'est pas sentir mais comprendre La perception est un acte qui ne doit pas être confondu avec la sensation : si on peut considérer que la sensation possède un caractère passif, du fait qu'elle résulte de l'affectation d'un ou de plusieurs de nos cinq sens par un objet extérieur (je sens qu'un aliment est chaud quand il entre en contact avec ma langue par exemple), la perception, au contraire, est active. « Percevoir », du latin percipere, c'est littéralement, « prendre ensemble », « recueillir », « rassembler ». C'est ce que fait remarquer Alain dans Les Passions de la sagesse : saisissant un dé entre mes doigts, je peux en sentir successivement les arêtes et les faces, mais je ne le perçois que lorsque je parviens à réunir mentalement tous ces caractères, réalisant alors qu'il s'agit bien d'un dé. Percevoir une chose, c'est donc « prendre » une chose, ce qui signifie métaphoriquement que la perception nous fait aller vers la chose et nous en donne ainsi une connaissance. Ce que nous comprenons avec Alain, c'est que sentir n'est pas encore percevoir. Il faut un acte supplémentaire, d'ordre mental, intellectuel qui unisse les diverses sensations en un même objet. 2 La perception comme acte « intellectif » Dès lors, la perception semble bien nous fournir un certain savoir sur l'objet perçu : mais de quelle nature est ce savoir ? Comme nous l'avons remarqué, il ne suffit pas que mes yeux fixent une chose pour que je la perçoive et identifie de quoi il s'agit. Il faut encore que mon entendement intervienne pour unir les 10 Sujet 1 - Le corrigé diverses sensations et les rapportent à un même objet. Ce qu'avec Kant nous appelons ici « entendement » n'est donc rien d'autre que la faculté de notre esprit qui ramène à l'unité les mille sensations que nous délivre notre sensibilité. Ce qui demeurait encore confus dans la simple sensation devient, grâce à l'entendement, clairement identifiable dans une perception. La perception n'est possible que parce que l'entendement stabilise et met en forme la matière sensible. Si c'est notre corps (nos cinq sens) qui reçoit les sensations, c'est en revanche notre esprit qui perçoit. La perception est un acte de l'intellect qui délivre un véritable savoir. Néanmoins, ce savoir que procure la perception ne doit pas être confondu avec une véritable connaissance intellectuelle de nature discursive. Elle demeure une connaissance intuitive qui peut d'ailleurs être sujette à l'erreur. II . La perception est un savoir intuitif, non discursif 1 La perception trompeuse Tout d'abord, nos perceptions ne sont pas toutes synonymes de connaissances dans la mesure où nombre d'entre elles nous échappent. C'est ce qu'a bien mis en évidence Leibniz dans ses Nouveaux Essais sur l'entendement humain dans lesquels il a montré qu'existaient en nous une infinité de petites perceptions qui ne sont pas fixées par notre conscience et qui ne peuvent être identifiées en tant que telles à des savoirs. Ainsi, par exemple, je peux très bien percevoir inconsciemment le chant des oiseaux dans mon jardin sans être capable de savoir quel est leur nombre. D'autre part, il faut aussi noter que nos perceptions sont souvent trompeuses et qu'elles manquent de clarté : je peux par exemple de loin trouver qu'une maison est petite et, me rapprochant, constater qu'elle est immense. Le savoir que m'avait livré ma première perception, à distance, se révèle faux. De la même manière, si je ne me fie qu'à ma perception, j'en reste au niveau de la simple expérience, sans pouvoir m'élever au savoir théorique : ce n'est pas parce que je perçois aujourd'hui que le soleil se couche comme il s'est couché tous les jours précédents que je comprends pourquoi il en est ainsi et que j'accède au savoir astronomique. Comme l'écrit Leibniz, en nous fiant le plus clair du temps à nos seules perceptions, nous n'accédons qu'à « une simple pratique sans théorie », c'est-à-dire à une connaissance sans doute utile à la vie, mais qui ne nous donne pas accès aux véritables causes et raisons des choses. « Les hommes agissent comme les bêtes, en tant que les consécutions de leurs perceptions ne se font que par le principe de la mémoire ressemblant aux médecins empiriques, qui ont une simple pratique sans théorie ; et nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. » 2 La perception comme rapport originaire au monde qui est un savoir vécu mais non théorique C'est la phénoménologie qui a bien mis en évidence le fait que la perception constitue un savoir tout à fait spécifique qui est un savoir « pré-discursif », c'est-à-dire qui se constitue avant la sphère de la formulation théorique propre à la connaissance intellectuelle. Le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty a bien montré en quoi la perception constituait un rapport originaire au monde, qui n'en est pas une connaissance objective mais seulement vécue : « Quand je perçois, je ne pense pas 11 Philosophie Le corrigé le monde, il s'organise devant moi. Quand je perçois un cube, ce n'est pas que ma raison redresse les apparences perspectives et pense à propos d'elles la définition géométrique du cube. » (Sens et non-sens). Autrement dit, la perception est un acte qui nous met dans un rapport premier au monde, et ce rapport n'est pas théorique. Est-ce un savoir ? Merleau-Ponty explique que « La perception n'est pas une sorte de science commençante, et un premier exercice de l'intelligence, il nous faut retrouver un commerce avec le monde et une présence au monde plus vieux que l'intelligence. » La perception est donc une sorte de savoir vécu, mais que l'on ne peut pas identifier à un savoir produit par l'intelligence seule. La perception, sans être un savoir théorique, n'est donc pas pour autant un savoir inférieur. Mieux : dans la mesure où elle nous permet de retrouver les choses telles qu'elles apparaissent elles-mêmes, avant toute compréhension théorique, la perception recèle un savoir précieux qu'elle est seule à pouvoir délivrer. Conclusion Le problème qui se posait était celui de comprendre pourquoi un acte intuitif peut être réduit à un certain savoir, bien que le savoir ne puisse être réduit à l'acte de percevoir. Cela s'explique du fait que l'acte de percevoir est un acte qui mobilise à la fois notre sensibilité (nos organes des cinq sens), mais aussi notre entendement. En ce sens, elle constitue bien une forme de savoir, dans la mesure où l'intellectuel y joue un rôle, mais ce savoir est d'abord et surtout un savoir de type intuitif, immédiat, vécu, qui ne peut pas être réduit au savoir objectif et théorique propre à la connaissance scientifique par exemple. Percevoir, n'est donc pas savoir théoriquement, mais expérimenter une forme de savoir vécu auquel nous gagnerons beaucoup à être de nouveau attentif. 12 Sujet 2, Sujet national, septembre 2011, série S Le sujet › Dissertation : Peut-on être en conflit avec soi-même ? Le sujet Pas à pas ® Comprendre le sujet Le sens du sujet : L'analyse des termes de la question posée devra faire ressortir le thème de la conscience de soi. L'homme est doué d'une conscience réflexive qui lui offre la possibilité d'avoir conscience de lui-même. Dans quelle mesure cette réflexivité, qui semble pouvoir éclairer chacun sur lui-même, peut-elle pourtant être à l'origine d'un conflit avec soi-même ? L'opinion commune et sa remise en question : Nous faisons bien souvent l'expérience d'un conflit avec nous-mêmes. Il arrive par exemple que nous ne soyons pas contents de nous-mêmes, que nous éprouvions des remords, que nous hésitions à agir... Mais s'il est clair que nous pouvons donc être déchirés entre plusieurs passions, ne peut-on pas voir la raison comme ce qui permet à l'homme de s'élever au-dessus de ces conflits ? ® Mobiliser ses connaissances Repères et notions à connaître et à utiliser dans le traitement de ce sujet : Conscience : Au sens général, la conscience est le savoir intérieur immédiat que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. La conscience exprime ainsi notre capacité de réflexion et le pouvoir que nous avons de viser autre chose que nous-mêmes. Son essence est selon Husserl l'« intentionnalité» .Voir également : conscience morale ; certitude ; cogito ; Descartes ; être pour soi, être en soi ; évidence ; intuition ; ipséité ; morale ; représentation ; Sartre. Certitude : Attitude d'ordre intellectuel mais aussi moral qui consiste à être assuré de la vérité d'une chose, même si cette vérité n'est pas démontrée. Une certitude peut ainsi se révéler être vraie ou fausse : je peux par exemple être certain d'avoir éteint la lampe et ne pas l'avoir fait en réalité, comme je peux être certain d'avoir réussi un examen, et l'avoir en vérité réellement réussi.Voir également : cogito ; connaissance ; conscience ; Descartes ; évidence ; immédiat. Cogito : Mot latin signifiant « je pense ». L' intuition « cogito ergo sum », « je pense donc je suis », constitue pour Descartes la certitude première résistant au doute méthodique et, comme telle, le modèle de toute vérité.Voir également : connaissance ; conscience ; conscience intentionnelle ; évidence ; Husserl ; solipsisme ; substance. Identité : Du latin idem, « même ». L'identité d'une chose, c'est ce qui fait qu'elle demeure la même à travers le temps malgré les changements.Voir également : principe de non-contradiction ; substance ; tautologie. 13 Philosophie Le sujet Pas à pas Névrose : Du grec neuron, « nerf ». Affection nerveuse et mentale sans cause organique reconnue, qui n'altère pas profondément la personnalité, à la différence de la psychose. Angoisses, obsessions, phobies, sont des manifestations névrotiques.Voir également : désir ; Freud ; inconscient ; libido ; passion ; pathogène ; plaisir ; pulsion. Passion : o Du latin patior, « souffrir ». Il y a passion quand un désir, parvenu à dominer et orienter tous les autres, aveugle l'homme au point qu'il en devient dépendant. La sagesse serait dans l'absence, ou du moins la domination des passions. o Hegel et le romantisme réhabiliteront les passions en en faisant le principe moteur des grandes actions. Voir également : épicurisme ; Freud ; inconscient ; instinct ; libido ; plaisir ; stoïcisme. Pulsions : Du latin pulsio, action de pousser. Chez Freud, poussée, force à la limite du somatique et du psychique, faisant tendre l'organisme vers un but et exigeant satisfaction. Freud pose l'existence de pulsions de vie (pulsions sexuelles et pulsions d'autoconservation) et de pulsions de mort.Voir également : désir ; inconscient ; instinct ; libido ; pathogène ; plaisir. Volonté : Un acte est volontaire quand il trouve son principe dans une libre décision du sujet. À la différence du désir, qui est une inclination ou un penchant subi, la volonté est un principe actif par lequel l'homme affirme sa capacité à se détacher de ses désirs et pose ainsi sa liberté.Voir également : conscience morale ; destin ; déterminisme ; instinct ; libre arbitre ; morale ; raison ; volonté générale. Citations pouvant servir de référence : « Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point. » Blaise Pascal, Pensées, 277, classement Brunschvicg. « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. » Sigmund Freud, L'Inquiétante Étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1985, p. 186. « Tu dois devenir qui tu es. » Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, Livre III, § 270, Paris, « 10/18 », 1973, p. 262. Les textes de référence : Un texte de Platon qui montre comment l'individu peut entrer en conflit avec lui-même lorsque ses désirs prennent le pas sur sa raison : Il m'est arrivé, repris-je, d'entendre une histoire à laquelle j'ajoute foi : Léontios, fils d'Aglaïon, revenant un jour du Pirée, longeait la partie extérieure du mur septentrional lorsqu'il aperçut des cadavres étendus près du bourreau ; en même temps qu'un vif désir de les voir, il éprouva de la répugnance et se détourna ; pendant quelques instants il lutta contre lui-même et se couvrit le visage ; mais à la fin, maîtrisé par le désir, il ouvrit de grands yeux, et courant vers les cadavres : « Voilà pour vous, mauvais génies, dit-il, emplissez-vous de ce beau spectacle ! » Platon, La République, Livre IV, 440a-b, traduction Bacou, Paris, Flammarion, 2002, pp. 192-193. 14 Sujet 2 - Le sujet Pas à pas Un texte de Freud qui montre le conflit existant entre les différentes instances psychiques : Un proverbe met en garde de servir deux maîtres à la fois. Le pauvre moi est dans une situation encore pire, il sert trois maîtres sévères, il s'efforce de concilier leurs revendications et leurs exigences. Ces revendications divergent toujours, paraissent souvent incompatibles, il n'est pas étonnant que le moi échoue si souvent dans sa tâche. Les trois despotes sont le monde extérieur, le surmoi et le ça. Quand on suit les efforts du moi pour les satisfaire tous en même temps, plus exactement pour leur obéir en même temps, on ne peut regretter d'avoir personnifié ce moi, de l'avoir présenté comme un être particulier. Il se sent entravé de trois côtés, menacé par trois sortes de dangers auxquels il réagit, en cas de détresse, par un développement d'angoisse. [...] Poussé par le ça, entravé par le surmoi, rejeté par la réalité, le moi lutte pour venir à bout de sa tâche économique, qui consiste à établir l'harmonie parmi les forces et les influences qui agissent en lui et sur lui, et nous comprenons pourquoi nous ne pouvons très souvent réprimer l'exclamation : « La vie n'est pas facile ! » Lorsque le moi est contraint de reconnaître sa faiblesse, il éclate en angoisse, une angoisse réelle devant le monde extérieur, une angoisse de conscience devant le surmoi, une angoisse névrotique devant la force des passions logées dans le ça. Sigmund Freud, Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1984, p. 107. Un texte de Kant qui révèle la fécondité du conflit de l'individu avec lui-même : L'homme a un penchant à s'associer, car dans un tel état, il se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher (s'isoler), car il trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens ; et, de ce fait, il s'attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu'il se sait par lui-même enclin à résister aux autres. C'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme, le porte à surmonter son inclination à la paresse, et, sous l'impulsion de l'ambition, de l'instinct de domination ou de cupidité, à se frayer une place parmi ses compagnons qu'il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer. L'homme a alors parcouru les premiers pas, qui de la grossièreté le mènent à la culture dont le fondement véritable est la valeur sociale de l'homme. Emmanuel Kant, Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, 4e proposition, Paris, Flammarion, 1993, pp. 74-75. ® Procéder par étapes Identifier les difficultés particulières de ce sujet : La difficulté de ce sujet tient au fait qu'il faut se concentrer sur la question posée et résister à l'envie d'évoquer immédiatement les thèses de Freud. Le traitement du problème gagnera en profondeur s'il prend appui sur une véritable analyse des termes. 15 Philosophie Le sujet Pas à pas Problématiser le sujet : Dans quelle mesure la conscience réflexive, qui ouvre à l'homme la possibilité d'un retour sur soi et d'une connaissance de soi est-elle dans le même temps à l'origine d'un conflit avec soi-même ? Il faudra distinguer entre différents niveaux de conflits. Le conflit entre les différentes pulsions instinctives est une chose, celui entre la raison et les passions en est une autre. Trouver le plan : On pourra montrer dans une première partie que la contradiction de nos désirs provoque en nous un conflit profond et inconscient. Dans une seconde partie, nous montrerons qu'il existe aussi un autre type de conflit qui, entre nos désirs et notre raison, nous déchire nous-mêmes. 16 Sujet 2 - Le corrigé Introduction Comme l'affirmait Hegel dans l'Esthétique, les animaux vivent en paix « avec les choses qui les entourent » : ils n'éprouvent pas leur monde comme étant incomplet ou décevant, ils ne s'irritent pas des limites que la nature leur a imposées, ils n'éprouvent pas l'altérité du monde comme une adversité dont il faut triompher. Rien ne leur paraît impossible, parce que rien au fond ne leur est possible : une vache ne regrette pas de ne pas pouvoir voler, parce qu'elle se contente d'être ce qu'elle est, de prélever dans l'altérité de quoi assurer sa subsistance, et de l'anéantir par la digestion. « Ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie/ Ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux », ainsi que l'écrivait Richepin dans son poème Oiseaux de passage, et il faut y voir négativement une description de l'homme : l'homme est cet être qui ne se contente jamais de son propre être, qui n'est jamais satisfait de son propre monde bref, cet être de désir qui exige toujours plus et autre chose que ce qu'il a. L'homme, en d'autres termes, se heurte en permanence à l'altérité sous la double figure de l'adversaire et de l'obstacle : les choses m'apparaissent d'emblée comme ce qui résiste à ma volonté, et qu'il faut transformer ou dépasser ; autrui est toujours susceptible de se dresser entre l'objet de mon désir et moi-même, soit parce qu'il ne veut pas ce que je veux, soit au contraire parce qu'il convoite exactement la même chose. Être un homme, par conséquent, c'est voir son existence fondamentalement inquiétée par l'altérité, c'est entrer en conflit avec cette dernière. Qu'on soit par définition en conflit avec ce qui n'est pas soi et pas de l'ordre du soi (avec le « non-moi », comme le nommait Fichte), cela alors n'est guère douteux ; mais pour autant, peut-on être en conflit avec soi-même ? À première vue, cela semble impossible, si tant est qu'il ne saurait y avoir de conflit qu'entre deux termes qui s'opposent et se heurtent : quel sens y aurait-il à dire qu'en moi quelque chose s'oppose à moi ? Et pourtant, à en croire Hegel, les animaux ne vivent pas qu'en paix « avec les choses qui les entourent », mais surtout « avec eux-mêmes ». L'animal en effet ne connaît ni la morsure du remords, ni la crainte de l'avenir ; il n'est pas exposé à l'angoissante possibilité de choisir, et donc de se tromper ; étant d'emblée tout ce qu'il est, il ne risque pas de passer à côté de lui-même, de devenir ce qu'il ne voulait surtout pas être ou de manquer sa vie - toutes possibilités constitutives au contraire de l'existence humaine à tel point que chacun redoute toujours qu'elles ne se réalisent, ou pire, qu'elles ne se soient déjà et silencieusement réalisées. Ces expériences que tous nous avons faites, faisons ou ferons supposent donc qu'il y a en moimême une part d'altérité, que je ne suis pas une pure « mêmeté » identique à moi, sans contradiction ni relief ; et effectivement, il est clair que nos désirs sont eux-mêmes contradictoires, que nous pouvons en même temps vouloir tout et son contraire, que deux alternatives peuvent se présenter à nous comme également désirables, lors même qu'elles sont exclusives l'une de l'autre ; clair également que nous vivons quotidiennement le conflit déchirant (voire désespérant) qui oppose ce que nos désirs ordonnent et ce que le devoir moral commande. Mais si l'homme est ainsi en quelque sorte la contradiction faite homme, la question se retourne : pouvons-nous seulement résorber la tension, et cesser ainsi d'être en conflit avec nous-mêmes ? De la contradiction des appétits au conflit de nos facultés, de la solution posée par l'exigence éthique à la persistance du scandale, tel sera alors le chemin problématique que nous nous proposons d'emprunter. 17 Philosophie I. Le corrigé De la contradiction des désirs en nous au conflit avec soi-même Lorsque, dans le Gorgias, Calliclès reproche à Socrate de « toujours dire la même chose », celui-ci renchérit : il ne dit pas simplement la même chose, il dit toujours « le même du même » ; c'est Calliclès au contraire qui « ne dit jamais la même chose », c'est-à-dire qui ne cesse de se contredire. Ce sont en effet les « meilleurs », répète inlassablement ce dernier, qui méritent le pouvoir ; mais lorsqu'il s'agit de définir qui sont ces meilleurs, il proclame tantôt que ce sont les plus forts, tantôt les plus habiles, tantôt les plus courageux - trois déterminations qui à l'évidence ne se recoupent pas, puisqu'on peut avoir la force sans l'intelligence ni le courage (telle la brute qui frappe celui qui est moins fort que lui pour le seul plaisir de le frapper), le courage sans l'intelligence (c'est-à-dire la témérité qui ne pèse pas les risques), l'intelligence sans la force, etc. Calliclès se contredit : il ne peut donc qu'avoir tort, puisque deux propositions contradictoires ne sauraient être vraies ensemble, quel que soit par ailleurs leur contenu. Et plus Socrate le lui fait remarquer, plus il s'empêtre et s'emporte : celui qui se contredit supporte rarement qu'on le contredise, c'est-à-dire qu'on lui apporte l'épreuve de la contradiction en l'amenant à comprendre que ce qu'il soutient n'est pas soutenable. Or, le mobile du conflit séparant Calliclès et Socrate n'est pas innocent : il s'agit pour Socrate d'affirmer que les meilleurs des hommes, ce sont ceux qui, avant de chercher à commander aux autres, savent se commander, c'est-à-dire « être raisonnable, se dominer, commander aux plaisirs et passions qui résident en soi-même », ceux qui sont, en somme, tout ce que Calliclès refuse d'être. En d'autres termes, les contradictions dans lesquelles Calliclès s'enferre ne sont que le signe d'un conflit plus grave, qui n'est pas simplement d'ordre théorique, mais bien pratique : le problème, ce n'est pas tant sa relation au discours vrai que son rapport à l'action bonne. Si le discours de Calliclès sombre ainsi dans la contradiction, c'est parce que Calliclès, loin de se dominer lui-même, est sans cesse la proie de désirs eux-mêmes contradictoires : la contradiction théorique est le signe d'un conflit pratique qui déchire un homme incapable de mettre la bride à ses appétits, et par conséquent toujours écartelé entre des inclinations opposées. Et en effet, celui qui ne sait pas se commander lui-même devient la proie d'appétits tyranniques qui le tirent à hue et à dia : comme le remarquait Descartes, le propre du désir, c'est de nous présenter comme également désirables des satisfactions qui pourtant s'excluent mutuellement (jouir des bénéfices de la gloire tout en profitant de la tranquillité de l'anonymat, exercer le pouvoir sans avoir à en supporter les responsabilités, etc.) ; le propre d'un désir, en d'autres termes, c'est à chaque fois de présenter sa satisfaction comme la plus indispensable à notre bonheur, quitte à entrer en conflit avec une inclination autre, qui pourtant se pose elle-même comme pareillement indispensable. Aussi, celui qui n'écoute que ses désirs entre-t-il en permanence en conflit avec lui-même : loin d'être semblable à l'aboulique qui ne sait pas ce qu'il veut, l'intempérant ne veut pas ce qu'il veut et veut ce qu'il ne veut pas, parce qu'il veut tout et son contraire. Or, si nos désirs peuvent à ce point se contredire entre eux, c'est parce qu'ils sont en eux-mêmes contradictoires : dans le Gorgias, Socrate compare les appétits à un tonneau percé, qui se vide à mesure qu'on le remplit ; et en effet, sitôt qu'un désir a été satisfait, il se porte sur un autre objet, et répute décevant celui qu'il avait un instant plus tôt tant cherché à posséder. Le désir se renouvelle sans fin ni trêve, il élève aux cieux ce qu'il n'a pas pour le faire déchoir plus bas que terre sitôt obtenu : tout se passe comme si le désir ne pouvait déchirer notre volonté que parce qu'il est déjà en conflit avec 18 Sujet 2 - Le corrigé lui-même - il veut être satisfait, mais est insatisfait de l'être, puisque toute satisfaction obtenue est incapable de le satisfaire (par le simple fait d'obtenir ce que je voulais, je me mets à vouloir autre chose). Davantage même : plus je cède à mes désirs, plus j'affaiblis ma volonté, et moins je suis capable de leur résister : chacun traîne derrière soi le poids de ses mauvaises habitudes passées, qui finissent par le rendre incapable d'un choix libre et délibéré. Aussi ce conflit qui oppose en moi des désirs contraires se double ou se redouble d'un conflit entre ce que mes désirs commandent, et ce qu'à présent je veux. Telle est la figure de l'incontinent chez Aristote (Éthique à Nicomaque, VII), l'irrésolu qui ne parvient pas à faire ce qu'il veut pourtant faire, parce que ses habitudes passées ont sur lui beaucoup trop d'empire : je sais que manger des aliments gras et sucrés est mauvais pour la santé, je veux suivre un régime plus sain ; mais j'ai pris l'habitude de céder au désir de consommer une telle nourriture, au point de finir par être incapable de m'en priver trop, ou trop longtemps. Nous pouvons alors identifier ce qui, en nous, entre en conflit avec nous-mêmes : comme nous y invite saint Augustin, il ne s'agit pas tant d'opposer une volonté mauvaise et une volonté bonne, qu'une volonté présente et des habitudes passées. Ce qui s'oppose dans ce conflit, c'est donc celui qu'à présent je suis, et le retentissement présent de celui que j'étais : sans même m'en rendre compte, j'ai par le passé contracté de mauvaises habitudes contre lesquelles je dois maintenant lutter ; j'ai pris pour un bien ce qui n'en était pas un, je le sais aujourd'hui, mais le savoir ne suffit pas à ne le plus désirer - savoir que fumer est mauvais pour la santé peut me pousser à cesser mon tabagisme mais ne rend pas la privation plus facile pour autant. Pour que le conflit soit résorbé, il faudrait donc que je sois capable de vouloir ce que je sais devoir vouloir ; il faudrait en d'autres termes que je sois capable de vouloir véritablement ce que ma raison ordonne - mais précisément : n'est-ce pas là simplement déplacer l'opposition, qui deviendrait alors celle de la raison d'un côté, et des appétits de l'autre ? II. Du conflit des désirs et de la raison au scandale de la déchirure Sans doute faut-il en revenir à ce que Socrate affirme dans le Gorgias : si tout désir en contredit d'autres et se contredit lui-même, alors nos appétits nous mènent inévitablement au conflit avec nous-mêmes, et d'abord parce qu'ils amènent notre propre volonté à se contredire. Mais comment redonner à cette dernière son unité perdue ? Alors que le velléitaire voudrait vouloir, mais ne parvient pas à véritablement vouloir ce qu'il veut (ainsi, celui qui veut sincèrement travailler davantage, mais diffère à chaque fois le moment de s'y mettre), l'homme sage et juste quant à lui saura « se commander lui-même ». Car enfin, non seulement mes désirs sont illimités et contradictoires, non seulement ils affaiblissent ma volonté au point de la rendre incapable de vouloir ce qu'elle veut pourtant, mais en plus et surtout ils s'imposent à moi sans que j'y puisse, mais ce n'est pas moi qui choisis de raffoler des petits pois et de détester les épinards - comme l'affirmait déjà Rousseau dans le Contrat social (I, 8), « L'impulsion du seul appétit est esclavage ». Afin que ma volonté soit tout à la fois forte et une, il faut donc qu'elle se libère de la tyrannie de désirs qui l'écartèlent pour se mettre sous le commandement de la raison. Telle est au fond la leçon de Socrate : celui qui cède aux plaisirs ne le fait que par ignorance du vrai bien ; et celui 19 Philosophie Le corrigé qui soumet ses désirs à sa raison fait cesser le conflit qui l'oppose ainsi à lui-même. Tout l'objet de la République de Platon, c'est justement de savoir comment développer une bonne éducation, capable de nous prémunir des mauvaises habitudes dont nous sommes si longs par la suite à nous défaire : il faut, le plus tôt possible, nous accoutumer à placer la part désirante sous la dépendance de la part raisonnable. C'est lorsque la volonté se met aux ordres des désirs et du corps qu'elle se déchire : sa place naturelle, celle qui donne à notre vie sagesse et unité, c'est de se mettre sous l'autorité de la raison. On peut alors à bon droit parler d'un optimisme platonicien : dans Phèdre, les deux chevaux qui composent l'attelage que nous sommes, et qui représentent les désirs contraires qui nous traversent (le cheval blanc symbolise la part de l'âme qui est attirée par l'intelligible et les idées, le cheval noir, celle qui est attirée par la terre et le sensible) peuvent aller d'un même pas et dans une même direction, pour peu que le cocher (la raison) tienne ferme les rênes. Mais c'est précisément ce point qui est délicat : peut-être Platon résorbe-t-il le conflit à trop bon compte, peut-être la tension qui oppose nos désirs entre eux n'est-elle dépassée qu'au prix de la position d'une nouvelle opposition, celle de ce que nos appétits commandent et de ce que notre raison ordonne - et on aura reconnu ici la thèse kantienne selon laquelle le devoir moral, issu de la seule raison, nous ordonne à chaque fois d'« humilier » (telle est l'expression de Kant) en nous la sensibilité. Selon Kant en effet, notre volonté n'est libre qu'à la condition de s'être libérée de ce qu'il nomme les « inclinations pathologiques », c'est-à-dire les inclinations sensibles ou désirs : je ne décide pas de mes désirs, et quiconque se soucie de les satisfaire révèle par là même l'étendue de son esclavage. L'homme est libre quand il fait ce que sa raison ordonne, c'est-à-dire quand il agit en parfaite conformité avec le devoir moral : mon action sera bonne, et je serai libre, si sa maxime (l'intention que j'ai eue en agissant) peut être universalisée sans contradiction aucune. Si tout être raisonnable peut vouloir ce que je veux, alors mon action est morale et ma volonté libre ; mais alors l'action morale est par essence déplaisante, parce qu'elle ne peut se réaliser qu'en foulant aux pieds tout ce que mes désirs me présentent comme désirable. Car enfin, si j'agis par intérêt ou dans l'espoir d'une satisfaction sensible, alors mon acte sera au mieux extérieurement conforme au devoir, mais non pas moral (celui qui ne vole pas par peur de se faire attraper, et non parce que voler est un mal, n'agit pas moralement). Il y a certes, à en croire la Critique de la raison pratique, un « contentement » moral, qu'éprouve celui qui s'est montré digne de la liberté même ; mais ce contentement se paie du prix élevé d'une déchirure entre soi et soi, entre ce que les désirs réclament et ce que la raison commande - déchirure sans cesse renouvelée, conflit à jamais entretenu, qui rend l'acte moral aussi difficile au dernier qu'au premier jour : comme le disait déjà saint Augustin, si l'homme bon peut faire en sorte de ne jamais céder à la tentation, le meilleur des hommes ne peut pas faire que la tentation ne soit plus tentante - même les saints ont envie de se damner. Voilà du moins ce qu'affirmait Kierkegaard au début du Traité du désespoir, lorsqu'il posait que l'homme n'était pas simplement un rapport de corps et d'esprit, de désirs et de raison, mais également le rapport d'un tel rapport ou « rapport se rapportant à lui-même », rapport fondamentalement instable, toujours déséquilibré, incapable de trouver l'immobilité et le repos. Quelle que soit la façon dont nous nous saisissons de nous-mêmes, quelle que soit la façon dont nous rapportons entre 20 Sujet 2 - Le corrigé eux le corps et l'esprit, les désirs et la raison, nous n'obtiendrons jamais qu'une instabilité désespérante, nous ne connaîtrons jamais que le désespoir d'être trop ou pas assez nous-mêmes. Il faut prendre au sérieux alors le terme même d'existence, qui est pour Kierkegaard ce qui demeure hors de toute catégorie : exister c'est mot à mot être toujours hors de soi, être jeté hors de toute identité de soi à soi ; exister, c'est ne pas se reconnaître dans ce que l'on est, ne pas se reconnaître dans l'image de soi que nous renvoie autrui, c'est-à-dire ne pas vouloir être celui qu'on est pourtant ; c'est surtout vouloir être soi-même et désespérer d'y parvenir un jour. Celui qui vit dans l'instant et n'écoute que ses désirs (l'homme du stade esthétique, figuré par Don Juan) s'empêtre dans la contradiction au moment où il croit s'en défaire : il espère se débarrasser du conflit en réputant par avance équivalentes toutes les alternatives (marie-toi, et tu seras malheureux ; ne te marie pas, et tu seras malheureux), mais en vient alors à désespérer de lui-même, en croyant désespérer du monde - Don Juan désespère, parce qu'il croit qu'aucune femme n'est assez belle pour qu'il puisse l'aimer toujours, au moment même où, les aimant toutes à la fois, il se montre incapable d'en aimer véritablement une seule. L'homme du stade éthique quant à lui croit dépasser la contradiction en posant qu'il faut subordonner nos désirs à la loi ; il donne alors à son existence le sérieux et la continuité qui lui faisaient défaut - mais ses certitudes sont fragiles, car rien jamais n'indique assez que la loi à laquelle je me soumets est la bonne, que je suis bien en train d'accomplir ce qu'il me faudrait faire. Conclusion Agamemnon personnalise pour Kierkegaard le stade éthique : il sacrifie sans remords sa fille aux lois de la cité, et s'en trouve content. Quand Abraham à son tour, et pour les mêmes raisons, s'apprête à égorger son fils, le Seigneur retient son bras, nous dit la Bible : le stade religieux succède au stade éthique, quand l'angoisse fait place au contentement - j'ai fait mon devoir, je me suis plié au commandement de ma cité ou à celui de ma raison, mais était-ce pourtant bien ce qu'il me fallait faire ? Le stade religieux, ultime stade de l'existence pour Kierkegaard, est celui de l'angoisse et du scandale, le scandale d'une existence qui n'est jamais assurée d'elle-même - Heidegger s'en souviendra lorsqu'il fera du « souci » la dimension même de l'exister. Exister, c'est être en conflit avec soi-même, c'est courir le risque de se perdre en chemin, c'est aller au-devant de possibilités entre lesquelles il faut bien choisir, sans qu'on puisse savoir avant de s'être décidé laquelle était la bonne - et de ce point de vue, ceux qui croient n'avoir plus rien à redouter sont nul doute ceux qui se sont déjà perdus. 21 Sujet 3, Sujet national, septembre 2009, série L Le sujet › Commentaire de texte : Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience Expliquer le texte suivant : 5 10 15 20 Telle saveur, tel parfum m'ont plu quand j'étais enfant, et me répugnent aujourd'hui. Pourtant je donne encore le même nom à la sensation éprouvée, et je parle comme si, le parfum et la saveur étant demeurés identiques, mes goûts seuls avaient changé. Je solidifie donc encore cette sensation ; et lorsque sa mobilité acquiert une telle évidence qu'il me devient impossible de la méconnaître, j'extrais cette mobilité pour lui donner un nom à part et la solidifier à son tour sous forme de goût. Mais en réalité il n'y a ni sensations identiques, ni goûts multiples ; car sensations et goûts m'apparaissent comme des choses dès que je les isole et que je les nomme, et il n'y a guère dans l'âme humaine que des progrès. Ce qu'il faut dire, c'est que toute sensation se modifie en se répétant, et que si elle ne me paraît pas changer du jour au lendemain, c'est parce que je l'aperçois maintenant à travers l'objet qui en est cause, à travers le mot qui la traduit. Cette influence du langage sur la sensation est plus profonde qu'on ne le pense généralement. Non seulement le langage nous fait croire à l'invariabilité de nos sensations, mais il nous trompera parfois sur le caractère de la sensation éprouvée. Ainsi, quand je mange d'un mets réputé exquis, le nom qu'il porte, gros de l'approbation qu'on lui donne, s'interpose entre ma sensation et ma conscience ; je pourrai croire que la saveur me plaît, alors qu'un léger effort d'attention me prouverait le contraire. Bref, le mot aux contours bien arrêtés, le mot brutal, qui emmagasine ce qu'il y a de stable, de commun et par conséquent d'impersonnel dans les impressions de l'humanité, écrase ou tout au moins recouvre les impressions délicates et fugitives de notre conscience individuelle. Pour lutter à armes égales, celles-ci devraient s'exprimer par des mots précis ; mais ces mots, à peine formés, se retourneraient contre la sensation qui leur donna naissance, et inventés pour témoigner que la sensation est instable, ils lui imposeraient leur propre stabilité. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Le sujet Pas à pas ® Comprendre le sujet Le thème du texte : Ce texte traite du rapport de la sensation au langage. Bergson aborde ici la question du rapport de la conscience et du réel. Il analyse plus précisément le lien entre ce que nous éprouvons, la manière dont nous le vivons et la façon dont nous l'exprimons. 22 Sujet 3 - Le sujet Pas à pas Le texte en bref : Bergson présente ici la thèse selon laquelle les mots sont toujours trop généraux pour exprimer la singularité de nos sensations et nous font nous méprendre sur la nature de celles-ci. ® Mobiliser ses connaissances Repères et notions à connaître et à utiliser dans le traitement de ce sujet : Bergson : o Philosophe français (1859-1941). Le point de départ de sa réflexion est la découverte de la durée, comme temps vécu, par opposition au temps abstrait de l'action et des sciences, qui n'est que du temps spatialisé. Si la durée caractérise la vie de l'esprit, conscience signifie alors mémoire, et l'intuition en est le mode d'approche spécifique. Bergson l'oppose à l'intelligence, outil d'action sur la matière. o Peu à peu, il réconcilie cependant matière et esprit, en montrant qu'il y a une durée de l'univers matériel. Voir également : intuition ; mécanisme. Immédiat : o Au sens strict, immédiat signifie « sans médiation, sans intermédiaire », et s'oppose à médiat. o Au sens cartésien, par exemple, l'intuition est un mode de connaissance immédiat, alors que la démonstration est un mode de connaissance médiat. Voir également : certitude ; évidence ; opinion. Sens : Au nombre de cinq (toucher, goût, odorat, ouïe et vue), les sens sont ce par quoi le sujet peut être mis en rapport avec le réel sensible situé hors de lui.Voir également : empirisme ; expérience ; finitude ; humanité, animalité ; sensualisme. Signe : Élément fondamental du langage, composé d'un signifiant, suite de sons ou de gestes, et d'un signifié ou concept, qui lui donne sens (distinction saussurienne).Voir également : Frege ; langue ; naturalisme, conventionnalisme ; parole ; Wittgenstein. Conscience : Au sens général, la conscience est le savoir intérieur immédiat que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. La conscience exprime ainsi notre capacité de réflexion et le pouvoir que nous avons de viser autre chose que nous-mêmes. Son essence est selon Husserl l'« intentionnalité» .Voir également : conscience morale ; certitude ; cogito ; Descartes ; être pour soi, être en soi ; évidence ; intuition ; ipséité ; morale ; représentation ; Sartre. Langage : On peut le définir comme un système de signes ordonnés suivant des règles. Il est une spécificité humaine dans la mesure où il comporte des caractéristiques propres absentes de la communication animale, en particulier sa plasticité et son caractère articulé, rendant possible une infinité de combinaisons à partir d'un nombre réduit d'éléments.Voir également : Aristote ; Benveniste ; Frege ; ineffable ; interprétation ; jugement prédicatif ; langue ; naturalisme, conventionnalisme ; principe de non-contradiction ; Saussure ; tautologie ; Wittgenstein. Langue : Une langue est un ensemble institué et stable de signes et de règles grammaticales que partage une communauté humaine donnée.Voir également : Aristote ; Benveniste ; Frege ; inef23 Philosophie Le sujet Pas à pas fable ; interprétation ; jugement prédicatif ; langage ; naturalisme, conventionnalisme ; principe de non-contradiction ; Saussure ; tautologie ; Wittgenstein. Intuition : o Du latin intuitus, « regard ». Chez Descartes, acte de saisie immédiate de la vérité, comme ce qui s'impose à l'esprit avec clarté et distinction. L'intuition s'oppose à la déduction, qui parvient à la vérité par la médiation de la démonstration. o Chez Kant, l'intuition désigne la façon dont un objet nous est donné ; tout objet donné étant nécessairement sensible, il ne pourra y avoir pour l'homme que des intuitions sensibles, et jamais, comme Descartes le soutenait, des intuitions intellectuelles. Kant appelle intuitions pures, ou formes a priori de la sensibilité, l'espace et le temps. o Chez Bergson, l'intuition est le seul mode de connaissance susceptible d'atteindre la durée ou l'esprit, par opposition à l'intelligence, qui a pour vocation de penser la matière. Voir également : certitude ; évidence ; expérience. Citations pouvant servir à la compréhension du texte et à son explication : « Vouloir penser sans les mots apparaît comme une déraison. » Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 462, addition, Paris, Vrin, 1988, p. 560. « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. » Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5-6, Paris, Gallimard, « NRF », 1993, p. 93. « Toute pensée vient des paroles et y retourne. » Merleau-Ponty, Signes, Préface, Paris, Gallimard, « Folio Essai », 1960, p. 32. Textes de référence à mettre en perspective avec le texte : Un texte de Nietzsche qui développe la thèse selon laquelle la généralité du langage nous éloigne de la singularité du réel : Repensons particulièrement au problème de la formation des concepts. Chaque mot devient immédiatement un concept par le fait qu'il ne doit pas justement servir comme souvenir pour l'expérience originelle, unique et complètement singulière à laquelle il doit sa naissance, mais qu'il doit s'adapter également à d'innombrables cas plus ou moins semblables, autrement dit, en toute rigueur, jamais identiques, donc à une multitude de cas différents. Tout concept naît de l'identification du non-identique. Aussi sûr que jamais une feuille n'est entièrement identique à une autre feuille, aussi sûrement le concept de feuille est-il formé par abandon délibéré de ces différences individuelles, par oubli du distinctif, et il éveille alors la représentation, comme s'il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque chose comme « la feuille », une sorte de forme originelle sur le modèle de quoi toutes les feuilles seraient tissées, dessinées, mesurées, colorées, frisées, peintes, mais par des mains inexpertes au point qu'aucun exemplaire correct et fiable n'en serait tombé comme la transposition fidèle de la forme originelle. [...] L'omission de l'élément individuel et réel nous fournit le concept, comme elle nous donne aussi la forme, tandis que la nature au contraire ne connaît ni formes ni concepts, et donc pas non plus de genres, mais seulement un X qui reste pour nous inaccessible et indéfinissable. Car notre opposition entre individu et genre 24 Sujet 3 - Le sujet Pas à pas est elle aussi anthropomorphique et ne provient pas de l'essence des choses, même si nous ne nous risquons pas non plus à dire qu'elle ne lui correspond pas : ce serait en effet une affirmation dogmatique et, comme telle, tout aussi indémontrable que son contraire. Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral, Arles, Actes Sud, 2012, p. 14-15.. Un texte de Rousseau qui examine le rôle du langage dans l'accès aux idées générales : Chaque objet reçu, d'abord un nom particulier, sans égard aux genres, et aux espèces, que ces premiers instituteurs n'étaient pas en état de distinguer ; et tous les individus se présentèrent isolés à leur esprit, comme ils le sont dans le tableau de la nature. Si un chêne s'appelait A, un autre chêne s'appelait B : de sorte que plus les connaissances étaient bornées, et plus le dictionnaire devint étendu. L'embarras de toute cette nomenclature ne put être levé facilement : car pour ranger les êtres sous des dénominations communes, et génériques, il ne fallait connaître les propriétés et les différences ; il fallait des observations, et des définitions, c'est-à-dire, de l'histoire naturelle et de la métaphysique, beaucoup plus que les hommes de ce temps-là n'en pouvaient avoir. D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aire des mots, et l'entendement ne les saisit que par des propositions. [...] Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général, jamais vous n'en viendrez à bout, malgré vous il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous de n'y voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. [...] Il faut donc énoncer des propositions, il faut donc parler pour avoir des idées générales ; car sitôt que l'imagination s'arrête, l'esprit ne marche plus qu'à l'aide du discours. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Paris, Flammarion, 1971, pp. 191-192. ® Procéder par étapes Identifier les difficultés particulières de ce texte : La difficulté propre à ce texte tient au fait que la thèse présentée va à l'encontre de l'opinion commune sur le lien entre conscience et langage. Il faudra interroger la façon dont nous nous rapportons d'ordinaire à nous-mêmes et de nous décrire. Problématiser le texte : Dans quelle mesure le langage, qui nous permet d'exprimer et donc d'extérioriser notre vécu, le déforme-t-il nécessairement ? Identifier ce qu'on vit avec ce qu'on dit, n'est-ce pas alors réduire une expérience singulière à une formule générale ? On distinguera deux moments dans ce texte. Dans un premier temps, Bergson montre en quoi les mots figent les sensations et tendent à en faire des choses. Dans un second temps, nous verrons que réduire le vécu à ce qu'on peut en dire ; c'est manquer la singularité et l'irréductibilité de toute expérience vécue. 25 Philosophie Le corrigé Introduction Dans ce texte, Bergson entend montrer que les mots tout à la fois figent nos sensations et les transforment, que le langage « s'interpose entre ma sensation et ma conscience ». Pour ce faire, il part d'une expérience simple et même banale : je peux d'aventure goûter à quelque chose dont je n'avais pas mangé depuis mon enfance, par exemple une madeleine trempée dans une tasse de thé. Je suis incapable à présent de me souvenir précisément de cette saveur, mais je sais clairement que je l'appréciais jadis. Quelle n'est pas alors ma déception quand je ne retrouve pas mon émotion d'antan : je ne peux que constater que, décidément, les goûts changent avec l'âge. Pourtant, cette conclusion ne va pas de soi : je présuppose que, comme elle est sensation du même objet, la sensation est identique et que, par conséquent, ce sont mes goûts qui se sont modifiés. Mais « en réalité, il n'y a ni sensations identiques, ni goûts multiples » : chaque perception est singulière et à nulle autre pareille. Si je peux extraire de sensations en soi différentes une forme abstraite (la saveur de la madeleine en général), c'est parce que je les rapporte à un même objet désigné par un nom commun (la madeleine). Le simple fait de nommer me fait oublier la singularité des choses. Il me fait oublier également la singularité de chaque sensation de ces choses elles-mêmes singulières pour en faire quelque chose d'invariable. Cette « influence du langage sur la sensation », du reste, s'atteste également dans une autre expérience quotidienne : « quand je mange d'un mets réputé exquis », cette réputation s'interpose entre ma sensation et moi-même et m'incite à la trouver plus plaisante qu'en réalité je ne la trouve. Bref, le mot appauvrit le monde à mesure qu'il le nomme : il ne retient à chaque fois de chaque chose que les traits les plus saillants, de chaque sensation que les caractères les plus stables et les plus communs. Il perd la singularité des choses et dilue dans la généralité les fugaces impressions des consciences individuelles. Le problème ne vient pas de ce que les termes que nous employons sont trop imprécis : disposerait-on d'un mot pour chaque sensation, si fugace et si passagère soit-elle, que cela n'accroîtrait en rien notre richesse. Car le mot neuf inventé pour la sensation unique la figerait sous une dénomination stable et perdrait ce qu'il faut bien nommer sa « processualité », c'est-à-dire la façon dont d'instant en instant elle se transforme. I. Analyse détaillée du texte 1 Les mots figent les sensations et en font des choses a) Exposé de notre thèse naturelle Nous ne nous contentons pas de percevoir au présent : nous gardons mémoire des perceptions présentes et nous nous souvenons des perceptions passées. Nous avons alors tous fait l'expérience d'une saveur, d'un parfum qui nous ravissaient enfants et qui suscitent, maintenant que nous sommes adultes, de l'indifférence au mieux ou de la répugnance au pire. Le chocolat chaud qui me plaisait enfant m'écoeure aujourd'hui : j'en conclus, tout naturellement, que mes goûts ont changé. Ce que je présuppose cependant, c'est bien la chose suivante : puisque le chocolat chaud a la même saveur maintenant et hier, c'est donc que je ne me rapporte plus à cette sensation de la 26 Sujet 3 - Le corrigé même façon, que mon palais n'apprécie plus ce qui auparavant lui plaisait. Bref, ce serait l'appréciation subjective de la sensation qui change et s'altère, et non la sensation elle-même : la saveur du chocolat est identique à celle qu'il avait quand j'étais enfant, ce sont donc mes goûts qui ont changé. Mais qu'est-ce qui me prouve que cette sensation est identique dans le temps ? Et pourquoi suis-je tout naturellement persuadé que ce sont mes goûts qui changent, et non la sensation elle-même ? La réponse est simple : je « solidifie » mes sensations, je leur donne d'emblée une identité et une consistance, je les réifie, c'est-à-dire que j'en fais quelque chose de stable et de perdurant. Du coup, quand la sensation d'un objet (la saveur de la madeleine ou du chocolat) est trop différente de celle conservée dans mon souvenir, au lieu d'en conclure que toute sensation est singulière, j'en déduis que ce sont mes goûts et dégoûts qui se modifient, que ce qui me plaisait ne me plaît plus. b) Réfutation de cette thèse : il n'y a dans l'âme que des progrès En réalité, pourtant, « il n'y a ni sensations identiques, ni goûts multiples » : toute sensation se vit à l'instant présent et est aussi unique que cet instant même. Jamais le chocolat n'a exactement deux fois la même saveur : la sensation se colore à chaque fois de nuances fugitives, de touches complexes (dues par exemple à ce que j'ai mangé d'autre auparavant) qui en font toujours quelque chose de parfaitement singulier. Pourquoi alors les sensations qui accompagnent la perception d'un objet me semblent-elle à peu près identiques ? Tout simplement parce que je les nomme : dès que je parle de la saveur du chocolat, je donne à cette sensation une identité qui se répète d'une fois sur l'autre, je gomme sans même m'en apercevoir les menues différences qui font toute la richesse de la perception, je ne retiens de cette saveur que les traits les plus communs et les plus généraux, ceux-là précisément qui se répètent d'une fois sur l'autre. Nommer, c'est donc tout à la fois isoler une sensation du flux continuel de percepts et la réifier en lui donnant une identité dans le temps, qu'à l'évidence pourtant elle n'a pas : comme l'affirme Bergson, « il n'y a guère dans l'âme humaine que des progrès », entendons par là des processus où tout change et se transforme de façon continue, par petites transitions insensibles (pour parler comme Leibniz), chaque sensation présente étant modifiée par la précédente et modifiant elle-même la suivante. c) Les sensations se modifient de façon continue Ainsi, une sensation ne se répète jamais exactement à l'identique, précisément parce qu'elle « se modifie en se répétant » : ce chocolat n'a pas la saveur de celui de mon enfance, parce qu'en fait les deux sensations sont distinctes. Le plus souvent, comme ces transformations sont continues et minimes, nous n'en avons pas conscience. Dans quelques cas cependant, quand je goûte à nouveau à un mets que je n'avais pas eu l'occasion de manger depuis longtemps, cette processualité constante des sensations m'apparaît. Mais comme je désigne ces sensations par le même mot, je me figure qu'elles doivent être identiques. J'en conclus alors soit que mes inclinations ont changé, soit que c'est l'aliment lui-même qui n'est pas le même : les madeleines ne sont plus ce qu'elles étaient, ils ont dû changer la recette de ce chocolat... C'est exact, mais plus que je ne le pense : à bien y réfléchir, il n'y a pas plus de madeleine en général qu'il n'y a de saveur de madeleine en général. Toute chose est singulière, toute sensation aussi. Mais comme je désigne un ensemble 27 Philosophie Le corrigé d'objets par un nom commun (le chocolat), je me figure qu'il s'agit toujours peu ou prou de la même chose. Je réfère alors ma sensation à l'objet comme à un pôle d'identité et j'en conclus qu'à objet identique, sensation identique : puisque c'est le même chocolat, de la même marque, alors sa saveur doit être la même, et en ce cas ce sont mes goûts qui ont changé ; et si elle ne l'est pas, c'est que c'est la composition du chocolat a été modifiée. Dans tous les cas, je réfère toujours ma perception à un objet lui-même réduit à ce que son nom me permet d'en retenir. 2 Les mots perdent la singularité des sensations a) Les mots transforment les sensations Alors, « cette influence du langage sur la sensation est plus profonde qu'on ne le pense généralement », et c'est peu de le dire. D'une part, c'est à cause du langage que je perds la singularité des choses. D'autre part, c'est à cause de lui que je perds également la singularité des sensations. Il faut même aller plus loin et affirmer qu'en plus de nous faire « croire à l'invariabilité de nos sensations », le langage nous « trompera parfois sur le caractère de la sensation éprouvée ». Cette expérience, tout aussi quotidienne que la première, c'est celle que nous faisons quand nous goûtons à un plat tout auréolé de prestige : « le nom qu'il porte » et les valeurs dont ce nom est porteur s'interposent entre ce que je sens effectivement et ce qui, de la sensation, parvient à ma conscience. Il ne s'agit pas de dire que je peux me retrouver à manger un plat qu'au fond je n'apprécie guère, mais que je me force par peur de la sanction sociale : il s'agit bien plutôt d'un mets que je crois trouver bon, que je mange sans me faire violence, à cause de la puissance que son nom a sur mon esprit. Je sais que les truffes sont un champignon prisé et cher ; le nom lui-même est riche de toutes ces connotations. Il se peut alors que je croie authentiquement en apprécier la saveur, lors même qu'elle me déplaît. b) Les mots ne retiennent que ce qu'il y a d'impersonnel dans les sensations Les mots simplifient donc le réel, et c'est là même l'essentiel de leur fonction : ils permettent de classer les choses, de les ramener à des catégories communes où je peux en un instant me retrouver. Il appartient au nom d'avoir des « contours bien arrêtés », c'est-à-dire de rassembler un certain nombre d'objets ou de sensations pour les ramener au même, par exclusion de tout le reste. Le langage impose donc sa grille sur le réel, avec une brutalité d'autant plus marquée qu'elle n'est pas remarquée. Car enfin, le langage nous sert tout à la fois à classer le monde et à communiquer avec autrui. Il ne peut alors retenir de nos impressions fugaces, de nos perceptions fugitives, de nos sensations à chaque fois singulières que ce qui peut être partagé par tous les autres. Ainsi, de par leur constitution même, les mots ne retiennent des choses et des perceptions que ce qu'il y a en elles « de stable, de commun », c'est-à-dire d'identique à plusieurs cas et « d'impersonnel » : cette saveur que je nomme avec d'autres « chocolatée », c'est précisément ce qui, d'une fois sur l'autre, se répète quand je mange du chocolat (en oubliant toutes ces nuances perceptives qui d'une fois sur l'autre ne se répètent pas), et ce qui peut être ressenti par moi autant que par n'importe qui d'autre. Parce que nous sommes des êtres doués de parole, nous oublions tout ce qui est « individuel » dans nos consciences, tout ce qui fait que cette sensation n'est pas exactement la même que la sensation de l'instant précédent, et pas la même que celle ressentie par un autre que moi. 28 Sujet 3 - Le corrigé c) Le problème n'est pas celui de la pauvreté du langage Les noms, communs par définition, seront toujours trop génériques pour des sensations singulières. Faudrait-il alors que chaque sensation soit désignée par un nom qui lui serait propre, c'est-à-dire qu'il y ait autant de noms qu'il y a de sensations, et pour chacune de leurs nuances ? En admettant qu'une telle solution soit possible, cela ne changerait rien au problème : le nom, même propre, même aussi singulier que la sensation qu'il serait censé désigner, la figerait toujours dans une identité stable, car il est incapable de rendre ce progrès par lequel toute sensation se transforme de façon continue. Certes, « il n'y a dans l'âme humaine » que des processus, or le nom, en plus de nommer toujours un concept et non une singularité, est fixiste et réifiant : il fige dans une identité stable ce qu'il désigne, il n'enregistre que le résultat, et non le progrès. II. Intérêt philosophique 1 Les noms collent des étiquettes sur les choses Nous retrouvons dans ce texte une thèse chère à Bergson selon laquelle les noms collent des étiquettes sur les sensations et sur les choses, que nous nous bornons ensuite à lire : le langage permet de trier le réel, de le simplifier, de le faire rentrer dans de vastes catégories. Cet arbre-ci n'est pas celui-là, mais en les désignant par un nom commun j'oublie tout ce qui fait leur singularité insubstituable. De même, ma joie d'aujourd'hui n'est pas exactement celle d'hier, ni même celle de la seconde passée : dans l'âme humaine, il n'y a que des transformations continuelles et continues, les sentiments et les sensations se modifient en permanence et d'un instant à l'autre. En nommant, le langage perd la singularité du réel et il le fige : le nom chosifie (ou réifie) ce qu'il désigne parce qu'il est attentif au résultat et aveugle nécessairement au processus. 2 La simplification du monde est au service de l'action Notre rapport aux choses comme à nous-mêmes est à ce point transformé par le langage que, lorsque nous faisons l'expérience de cette modification perpétuelle des sensations, qui ne sont jamais identiques à ce qu'elles étaient, nous affirmons tout naturellement que ce sont nos goûts qui ont changé. Il y a là sans doute l'indice d'une nécessité qu'il faut dégager : le langage simplifie certes le réel et le réifie, mais cette transformation nous est indispensable. Nous sommes en effet toujours placés dans l'urgence d'agir et d'oeuvrer. Or, dans un monde où tout m'apparaîtrait comme singulier et sans comparaison possible, c'est l'action même qui serait empêchée par l'infinie diversité des choses. Le langage, tout comme l'intelligence dont il procède, est au service de l'action : c'est elle qui exige que l'on fige le réel, qu'on oublie les singularités, qu'on classe les choses, les sentiments et les sensations dans des catégories linguistiques fixes et fixées d'avance. 3 Mais un autre usage du langage demeure possible Il n'y a donc pas lieu de déplorer la transformation que le langage fait subir à notre rapport au réel, aux choses, à autrui, à nous-mêmes enfin : simplifier, classer, ordonner, telles sont précisément 29 Philosophie Le corrigé ses fonctions premières. Mais il n'est pas dit que cet usage commun du langage en épuise toutes les possibilités : le poète, le romancier, ceux qui font oeuvre des mots au lieu de seulement s'en servir comme moyens pour la communication ordinaire, ceux-là parviennent justement à nous redonner un peu de cette singularité perdue. Là est tout le génie de l'artiste : comme le disait déjà Mallarmé, les mots qu'il utilise sont ceux de tous les jours, et pourtant ce ne sont plus les mêmes, précisément parce qu'ils nous rendent la richesse du monde, autant que les profondeurs de l'âme humaine. Ainsi que Proust l'affirmait, lire un roman, ce n'est pas simplement lire une histoire, c'est voir le monde comme quelqu'un d'autre le voit, et par là contempler des paysages qui, sans cela, « nous seraient aussi inconnus que ceux de la lune ». Conclusion Jorge Luis Borges imaginait dans une de ses nouvelles un homme qui, dans sa folie, voulait dresser une carte au un unième, c'est-à-dire une carte à l'échelle du monde, pour qu'elle en soit enfin l'exact reflet. Telle entreprise était vouée à l'échec, parce qu'elle est absurde : le rôle d'une carte, c'est précisément de simplifier le monde qui nous entoure afin que nous puissions nous y retrouver. Il en va de même pour le langage : il perd la singularité des choses, mais cette perte est nécessaire. Il est alors d'autant plus remarquable que certains puissent s'approprier cette langue commune et impersonnelle par la médiation d'un style : le style en littérature, c'est précisément la façon qu'a un auteur de parler la langue que tous parlent, mais d'une manière qui n'appartient qu'à lui, nous redonnant alors la singularité des sentiments, des sensations, des émotions que perd le langage dans son usage ordinaire. 30 Sujet 4, Sujet national, septembre 2010, série ES Le sujet › Commentaire de texte : Comte, Cours de philosophie positive Expliquer le texte suivant : 5 10 Il est sensible, en effet, que, par une nécessité invincible, l'esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres. Car, par qui serait faite l'observation ? On conçoit, relativement aux phénomènes moraux, que l'homme puisse s'observer lui-même sous le rapport des passions qui l'animent, par cette raison, anatomique, que les organes qui en sont le siège sont distincts de ceux destinés aux fonctions observatrices. Encore même que chacun ait eu occasion de faire sur lui de telles remarques, elles ne sauraient évidemment avoir jamais une grande importance scientifique, et le meilleur moyen de connaître les passions sera-t-il toujours de les observer en dehors ; car tout état de passion très prononcé, c'est-à-dire précisément celui qu'il serait le plus essentiel d'examiner, est nécessairement incompatible avec l'état d'observation. Mais, quant à observer de la même manière les phénomènes intellectuels pendant qu'ils s'exécutent, il y a impossibilité manifeste. L'individu pensant ne saurait se partager en deux dont l'un raisonnerait, tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant, dans ce cas, identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu ? Comte, Cours de philosophie positive. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Le sujet Pas à pas ® Comprendre le sujet Le thème du texte : Dans ce texte, Auguste Comte entend montrer que, bien que l'homme soit conscient de lui-même, il ne peut prendre pour objet cette conscience même. Il s'agit donc d'interroger le rapport de la conscience à elle-même, d'introduire l'idée qu'elle ne peut pas se rapporter à elle-même de la même façon qu'elle se rapporte à des objets. Le texte en bref : Ce texte expose une thèse très claire : si l'esprit humain est capable de prendre pour objet de réflexion tous les phénomènes qui lui apparaissent, y compris ses propres passions, il est cependant incapable de se prendre lui-même pour objet. Le problème soulevé ici est donc celui de la connaissance de soi. 31 Philosophie Le sujet Pas à pas ® Mobiliser ses connaissances Repères et notions à connaître et à utiliser dans le traitement de ce sujet : Conscience : Au sens général, la conscience est le savoir intérieur immédiat que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. La conscience exprime ainsi notre capacité de réflexion et le pouvoir que nous avons de viser autre chose que nous-mêmes. Son essence est selon Husserl l'« intentionnalité» .Voir également : conscience morale ; certitude ; cogito ; Descartes ; être pour soi, être en soi ; évidence ; intuition ; ipséité ; morale ; représentation ; Sartre. Certitude : Attitude d'ordre intellectuel mais aussi moral qui consiste à être assuré de la vérité d'une chose, même si cette vérité n'est pas démontrée. Une certitude peut ainsi se révéler être vraie ou fausse : je peux par exemple être certain d'avoir éteint la lampe et ne pas l'avoir fait en réalité, comme je peux être certain d'avoir réussi un examen, et l'avoir en vérité réellement réussi.Voir également : cogito ; connaissance ; conscience ; Descartes ; évidence ; immédiat. Cogito : Mot latin signifiant « je pense ». L' intuition « cogito ergo sum », « je pense donc je suis », constitue pour Descartes la certitude première résistant au doute méthodique et, comme telle, le modèle de toute vérité.Voir également : connaissance ; conscience ; conscience intentionnelle ; évidence ; Husserl ; solipsisme ; substance. Aperception : Mot inventé par Leibniz et repris ensuite par Kant dans la Critique de la raison pure (aperception transcendantale), pour désigner l'acte par lequel un sujet opère un retour réflexif sur ses perceptions et en prend conscience. Leibniz oppose ainsi l'aperception aux « petites perceptions » qui sont des perceptions inconscientes.Voir également : analyse, synthèse ; sens ; sensible, intelligible. Conscience intentionnelle : L'intentionnalité, du latin intentio, est un terme utilisé en phénoménologie par Husserl pour désigner l'acte par lequel la conscience se rapporte à l'objet qu'elle vise. En affirmant que « la conscience est toujours conscience de quelque chose », Husserl, contre Descartes, montre que loin d'être une « substance pensante » autarcique, la conscience est toujours visée intentionnelle d'un objet, tension vers ce qu'elle n'est pas, et que c'est là son essence. Ainsi, par exemple, si je suis conscient d'un arbre situé en face de moi, ma pensée est tournée en direction de cet arbre qui me fait face : j'accomplis un acte conscient intentionnel. La conscience implique donc une forme de dualité entre un sujet et un objet, mais aussi une forme d'unité, de liaison : c'est l'intentionnalité.Voir également : cogito ; Husserl. Esprit : o Du latin spiritus, « souffle ». Désigne, au sens large, par opposition au corps matériel, le principe immatériel de la pensée. Chez Pascal, l'esprit, qui permet la connaissance rationnelle, s'oppose au coeur, par lequel l'homme s'ouvre à la charité et à la foi. o Chez Hegel, l'esprit est le mouvement de se reprendre soi-même dans l'altérité. Il désigne ainsi le mouvement même de la conscience. Voir également : absolu, relatif ; âme ; idéalisme. 32 Sujet 4 - Le sujet Pas à pas Immédiat : o Au sens strict, immédiat signifie « sans médiation, sans intermédiaire », et s'oppose à médiat. o Au sens cartésien, par exemple, l'intuition est un mode de connaissance immédiat, alors que la démonstration est un mode de connaissance médiat. Voir également : certitude ; évidence ; opinion. Intuition : o Du latin intuitus, « regard ». Chez Descartes, acte de saisie immédiate de la vérité, comme ce qui s'impose à l'esprit avec clarté et distinction. L'intuition s'oppose à la déduction, qui parvient à la vérité par la médiation de la démonstration. o Chez Kant, l'intuition désigne la façon dont un objet nous est donné ; tout objet donné étant nécessairement sensible, il ne pourra y avoir pour l'homme que des intuitions sensibles, et jamais, comme Descartes le soutenait, des intuitions intellectuelles. Kant appelle intuitions pures, ou formes a priori de la sensibilité, l'espace et le temps. o Chez Bergson, l'intuition est le seul mode de connaissance susceptible d'atteindre la durée ou l'esprit, par opposition à l'intelligence, qui a pour vocation de penser la matière. Voir également : certitude ; évidence ; expérience. Vérité : o La vérité concerne l'ordre du discours, et il faut en cela la distinguer de la réalité. Elle se définit traditionnellement comme l'adéquation entre le réel et le discours. o La philosophie, parce qu'elle la recherche, pose le problème de ses conditions d'accès et des critères du jugement vrai. Voir également : connaissance ; croyance ; Dieu ; épistémologie ; esprit ; métaphysique ; nécessaire ; ontologie ; opinion ; représentation ; théologie ; transcendance ; véracité. Citations pouvant servir à la compréhension du texte et à son explication : « Je pense, donc je suis [...] Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser. » Descartes, Discours de la méthode, 4e partie, Paris, Flammarion, 1992, p. 54. « C'est par la médiation du travail que la conscience vient à soi-même. » Hegel, La Phénoménologie de l'esprit, Tome I, Paris, Aubier, 1991, p. 165. « Accepte donc sur ce point de te laisser instruire ! Le psychique en toi ne coïncide pas avec ce dont tu es conscient. » Freud, « Une difficulté de la psychanalyse » in, L'Inquiétante Étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1985, p. 186. Un texte de Hume qui montre que le dédoublement de la conscience conduit au constat que la connaissance de soi est une impossibilité : Il y a certains philosophes qui imaginent que nous avons à tout moment la conscience intime de ce que nous appelons notre moi ; que nous sentons son existence et sa continuité d'existence ; et que nous sommes certains, plus que par l'évidence d'une démonstration, de son identité et de sa simplicité parfaites. Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière 33 Philosophie Le sujet Pas à pas ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment sans une perception et je ne peux rien observer que la perception. Quand mes perceptions sont écartées pour un temps, comme par un sommeil tranquille, aussi longtemps, je n'ai plus conscience de moi et on peut dire vraiment que je n'existe pas. Si toutes mes perceptions étaient supprimées par la mort et que je ne puisse ni penser ni sentir, ni voir, ni aimer, ni haïr après la dissolution de mon corps, je serais entièrement annihilé et je ne conçois pas ce qu'il faudrait de plus pour faire de moi un parfait néant. Si quelqu'un pense, après une réflexion sérieuse et impartiale, qu'il a, de lui-même, une connaissance différente, il me faut l'avouer, je ne peux raisonner plus longtemps avec lui. David Hume, Traité de la nature humaine, Paris, Aubier, 1946, p. 342. Un texte de Kant qui distingue la conscience de soi et la connaissance de soi : J'ai conscience de moi-même [...] non pas tel que je m'apparais, ni tel que je suis en moi-même, mais j'ai seulement conscience que je suis. Cette représentation est une pensée, non une intuition. La conscience de soi-même n'est donc pas encore, loin s'en faut, une connaissance de soi-même. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, Livre I, chapitre II, 2e section, § 25, Paris, PUF, « Quadrige », pp. 135-136. Un texte de Sartre qui indique que la conscience s'échappe toujours à elle-même : L'être de la conscience ne coïncide pas avec lui-même dans une adéquation plénière. Cette adéquation, qui est celle de l'en-soi, s'exprime par une simple formule : l'être est ce qu'il est. Il n'est pas dans l'en-soi, une parcelle d'être qui ne soit à elle-même sans distance. Il n'y a pas dans l'être ainsi conçu la plus petite ébauche de dualité. [...] La caractéristique de la conscience, au contraire, c'est qu'elle est une décompression d'être. Il est impossible en effet de la définir comme coïncidence avec soi. De cette table, je puis dire qu'elle est purement et simplement cette table. Mais de ma croyance je ne puis me borner à dire qu'elle est croyance : ma conscience est conscience (de) croyance. On a souvent dit que le regard réflexif altère le fait de conscience sur lequel il se dirige. [...] Ainsi, du seul fait que ma croyance est saisie comme croyance, elle n'est plus que croyance, c'est-à-dire qu'elle n'est déjà plus croyance, elle est croyance troublée. Ainsi, le jugement ontologique « la croyance est conscience (de) croyance » ne saurait en aucun cas être pris pour un jugement d'identité : le sujet et l'attribut sont radicalement différents et ceci, pourtant, dans l'unité indissoluble d'un même être. Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1943, pp. 112-113. 34 Sujet 4 - Le sujet Pas à pas ® Procéder par étapes Identifier les difficultés particulières de ce texte : La difficulté majeure de ce texte tient au fait qu'il s'agit de distinguer entre différents types de phénomènes conscients. Au coeur de la conscience, on doit faire la différence entre ce qui est relatif à l'expérience sensible du sujet et à son expérience morale. Problématiser le texte : Si une partie de sa propre expérience lui échappe, dans quelle mesure peut-on dire que le sujet se connaît lui-même ? Il faudra distinguer entre différents degrés de la conscience de soi et interroger les notions d'objectivité et de subjectivité. Trouver le plan : Dans une première partie, Comte propose la thèse selon laquelle l'esprit humain ne peut s'étudier lui-même. Dans une deuxième partie, il reconnaît néanmoins qu'une partie de l'expérience consciente peut tout à fait être analysée par le sujet lui-même. Chacun peut, par exemple, examiner ses propres passions. Dans une troisième partie, il précise alors sa thèse initiale et montre que si la conscience ne peut pas se prendre elle-même pour objet, cela ne signifie pas pour autant que certaines formes d'expériences ne puissent être comprises, cela enjoint plutôt à distinguer entre la conscience et les expériences qu'elle rend possible. 35 Philosophie Le corrigé Introduction Dans ce texte, Comte entend démontrer que « l'esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres » ; en d'autres termes que la conscience ne saurait être immédiatement à elle-même son propre objet. C'est en effet dans mon « esprit » que tout ce qui peut bien exister se manifeste : tout phénomène n'est phénomène que pour une conscience, tout ce qui apparaît apparaît à un sujet. La conscience ou esprit est donc ce qui m'ouvre à la totalité des phénomènes, elle est en quelque sorte la scène sur laquelle le monde lui-même m'apparaît (quand je perds conscience, plus rien n'existe pour moi). Mais, précisément parce qu'il est le lieu où tout se manifeste, l'esprit ne saurait lui-même se manifester à lui-même, sans quoi on sombrerait dans une régression à l'infini. On peut cependant élever une objection bien évidente, celle précisément que Comte envisage immédiatement : je puis bien me connaître moi-même, m'observer moi-même, quand cette observation porte sur des « phénomènes moraux », c'est-à-dire des passions. Quand je suis triste, je sais que je suis triste. Je puis même, si le coeur m'en dit, me pencher au-dedans de moi et étudier cette tristesse, me demander d'où elle vient, par quels comportements en moi elle se caractérise, ce qu'il faudrait faire pour la voir cesser. Je puis donc connaître, dans une certaine mesure du moins, mes états émotifs et les observer « objectivement », c'est-à-dire les contempler comme s'il s'agissait d'autant d'objets distincts de moi-même. Comment alors cela est-il possible ? La raison en est simple : ce qui est observé, ce sont des humeurs, des passions, des dispositions ou tonalités émotives ; ce qui observe, c'est la partie intellective de l'esprit. Je puis bien connaître mon état affectif alors, parce que la partie de l'esprit qui observe n'est pas celle qui est observée. Cette connaissance de soi par soi a toutefois elle-même ses limites : une observation rigoureuse réclame le calme et le silence des passions ; en sorte qu'au moment même où l'émotion s'empare de moi, je ne suis pas dans une disposition d'esprit adéquate pour bien l'étudier. Celui qui veut savoir ce qu'est la colère fera mieux alors d'en observer les effets chez autrui plutôt que sur lui-même ; car enfin être en colère, c'est ne pas être en de bonnes dispositions pour connaître quoi que ce soit. Ainsi donc, l'objection nous permet de comprendre le cas plus général de la connaissance de l'esprit par lui-même : si nous pouvons (du moins dans certaines limites) observer nos dispositions émotives, c'est précisément parce que l'esprit peut alors se dédoubler entre partie observée et partie observante. Or un tel dédoublement est impossible quand il s'agit d'étudier la partie intellective de l'esprit elle-même : je puis connaître tous les phénomènes qui se manifestent à mon esprit, hormis l'esprit lui-même, car alors ce qui doit être observé et ce qui observe sont confondus, ce qui rend toute observation impossible. De là s'ensuit que « l'individu pensant » ne pourra jamais immédiatement connaître ce qu'il fait exactement quand il pense : il n'y a pas de pensée de la pensée, on ne peut se regarder raisonner soi-même. La thèse de Comte, sous son apparente simplicité, est pourtant d'une radicalité remarquable : elle consiste à dire, finalement, que la pensée ne saurait être à elle-même son propre objet. Je ne peux pas penser ma pensée, je ne peux pas connaître ce que fait mon esprit quand il connaît, en sorte que toute connaissance porte nécessairement d'abord sur autre chose que moi-même. On mesure alors tout l'écart qui sépare cette affirmation de la doctrine cartésienne, selon laquelle, dans le cogito, la pensée se saisit d'elle-même dans un acte intuitif et parfaitement certain. Mais s'il nous fallait 36 Sujet 4 - Le corrigé donner raison à Comte, encore faudrait-il expliquer comment l'esprit peut effectivement parvenir à se connaître, s'il ne peut se connaître directement ; et c'est tout l'enjeu de la doctrine hégélienne, selon laquelle la conscience de soi est toujours et nécessairement médiate. I. Analyse détaillée du texte 1 Position de la thèse : l'esprit humain ne peut s'étudier lui-même a) L'esprit ne peut jamais se connaître directement Comte commence d'emblée par affirmer sa thèse, selon laquelle « l'esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres ». Cette thèse est « sensible », elle tombe sous le sens, elle a pour elle la certitude immédiate d'un fait que tous et chacun peuvent expérimenter en eux-mêmes : l'esprit humain peut se porter sur tout et penser à tout, il peut observer tous les phénomènes qui lui apparaîtront jamais, et tâcher de les connaître, par exemple en les ramenant à des lois. La seule chose dont la conscience ne puisse avoir une conscience immédiate, c'est elle-même : ses « propres » phénomènes, elle ne pourra jamais les observer « directement ». Il en va de même, analogiquement, avec mon propre regard : condition de possibilité de toute vision, il ne saurait jamais apparaître lui-même dans le champ visuel qu'il ouvre, sans quoi mon regard se verrait voyant, il s'inclurait lui-même dans une mise en abyme allant à l'infini. Je ne puis jamais regarder directement ou immédiatement mon propre regard : pour le voir, il faudra procéder de façon indirecte ou médiate, par exemple en contemplant l'image de mon visage dans un miroir ou dans l'eau. b) La raison de cette impossibilité Le problème est au fond le même : la condition de possibilité de l'apparition d'un phénomène ne saurait apparaître parmi ce qu'elle conditionne. De même que la vue suppose un partage entre ce qui voit et ce qui est vu (ce qui exclut donc que mon regard se voie lui-même dans son propre champ visuel), de même l'esprit ne saurait avoir conscience de ce qu'il fait quand il connaît et qu'il observe : c'est toujours « je connais quelque chose », « j'observe un phénomène », bref, toute connaissance suppose le partage entre un sujet connaissant et un objet connu. De là il ressort que je ne puis me connaître moi-même, puisqu'en ce cas sujet et objet se confondent, en sorte qu'on peut demander, comme le fait Comte, « par qui serait faite l'observation » ? 2 Réfutation d'une objection : la connaissance des émotions qui nous affectent a) Nous pouvons connaître nos états affectifs La thèse, qui nous est présentée comme une évidence indubitable, semble pourtant venir contredire les phénomènes eux-mêmes. En effet, s'il ne saurait être question de dire que je puis à tout instant lire en moi comme dans un livre ouvert, on ne saurait affirmer non plus que je suis à moi-même un parfait étranger, que mon propre esprit m'est un mystère scellé de sept sceaux : j'ai bien une compréhension immédiate et directe de mes états émotifs ; entendons par là non seulement que je 37 Philosophie Le corrigé sais que je suis en colère lorsque je suis en colère, mais aussi et surtout que je sais (même d'une manière vague et imparfaitement déterminée) ce qu'est ma colère, ce qui se passe en moi lorsqu'elle me prend. Ainsi donc, pour les « phénomènes moraux », c'est-à-dire ceux qui intéressent la partie morale de la philosophie, entendons par là les humeurs, le caractère, les intentions, etc., il est indubitable que l'homme peut « s'observer lui-même » directement, sans avoir à faire un détour par l'altérité : je puis toujours, dans une certaine mesure, observer mes propres dispositions émotives, les contempler pour ainsi dire dans la distance, les objectiver comme si ce n'étaient pas les miennes, les étudier et pour tout dire les connaître. Alors, comment cela est-il possible, et ce point constitue-t-il véritablement une objection à l'affirmation selon laquelle l'esprit ne saurait s'observer lui-même ? b) Les raisons de cette possibilité La réponse à cette dernière question est clairement négative : si je puis connaître mes dispositions affectives, c'est parce que la partie de mon esprit qui ressent les émotions n'est pas celle qui connaît. Si donc je peux connaître mes émotions, les étudier et tâcher de les comprendre à même mes propres vécus, la raison en est tout simplement « anatomique » : il n'y a là aucun mystère inexplicable, aucun miracle incompréhensible, mais une simple répartition des tâches entre les organes. Les organes de l'émotion ne sont pas ceux de l'observation théorique froide et dépassionnée. Preuve en est, précisément, que la connaissance pour être objective doit se faire sans passion ; et comment cela serait-il possible si les organes de l'observation étaient aussi ceux des tonalités affectives ? On le sait depuis Aristote : un spectacle qui suscite l'horreur ou le dégoût (les viscères d'un animal par exemple) peut éveiller en nous de l'intérêt au lieu d'une répulsion, sitôt que cette vue est mise au service de la connaissance ; ce qui signifie bien que connaître n'est pas ressentir autre chose, mais autre chose que ressentir. c) Insuffisance de la connaissance directe de nos propres émotions Il faut noter toutefois que la connaissance de mes propres tonalités émotives ou dispositions affectives ne saurait être que partielle pour la raison même qui la rend possible : si je puis connaître mes propres émotions, c'est parce que ce qui en moi connaît n'est pas ce qui ressent. Mais c'est toujours le même moi qui connaît et qui ressent ; or certaines dispositions affectives sont tellement puissantes qu'elles empêchent la sérénité nécessaire à la connaissance. Lorsque je suis en colère, je peux fort bien me pencher sur cette colère et tâcher de la comprendre, parce que la part de mon esprit qui connaît n'est pas le siège des émotions. Mais quand je suis en colère précisément, cette partie de mon esprit qui observe et connaît ne bénéficie pas du silence des passions dans lequel elle peut véritablement se mettre à l'oeuvre. De là il ressort que si je puis dans certaines limites connaître ma propre colère, je l'observerai toujours mieux de l'extérieur, chez un autre, parce qu'alors la froide connaissance ne sera pas troublée par la vivacité de mes affects. 3 Justification finale de la thèse Nous en revenons alors au même problème : si une connaissance de nos états émotifs est possible (du moins dans certaines limites), c'est précisément parce que celui qui ressent n'est pas exactement celui qui comprend. C'est donc fondamentalement pour la même raison que la connaissance 38 Sujet 4 - Le corrigé des « phénomènes intellectuels » ne pourra jamais être accomplie directement : au moment même où j'ai conscience de quelque chose, au moment même où je connais un objet distinct de moi, je ne saurais porter mon attention sur ce que fait au juste ma conscience quand elle prend conscience, sur ce que fait mon esprit quand il connaît. « Je me connais » : en toute rigueur, cette phrase ne signifie rien, parce qu'elle fait signe vers une impossibilité, celle de se couper soi-même en deux, entre sujet connaissant et objet connu. Je ne puis me « regarder raisonner » lorsque je raisonne, toute connaissance est toujours connaissance d'autre chose que de soi-même, comme la vue s'excepte toujours de ce qu'elle voit. II. Intérêt philosophique 1 Position du problème : l'esprit peut-il se connaître médiatement ? L'analogie que nous avons menée entre l'oeil et l'esprit soulève cependant une difficulté : si la vue ne saurait se voir directement elle-même, elle peut toujours cependant se contempler elle-même en faisant un détour par l'altérité, c'est-à-dire dans une image qui n'est pas moi et que j'identifie pourtant comme étant moi-même. Existe-t-il quelque chose d'analogue pour l'esprit, ou nous faudra-t-il renoncer définitivement à savoir ce que nous faisons au juste lorsque nous connaissons ? 2 La pensée ne peut se penser elle-même Une chose est certaine en tous les cas : l'autoconscience de soi (pour parler comme Hegel) ne saurait être directe ou immédiate. La conscience ne peut pas prendre conscience d'elle-même, par cela même qu'elle est ce par quoi tout peut venir à la conscience (comme la vue est ce par quoi tout peut être vu) : elle ne saurait s'inclure dans les phénomènes qu'elle rend présents, sous peine de tomber dans une régression à l'infini. Il faut donc reconnaître que la certitude première du cogito cartésien est tout sauf certaine : toute conscience est conscience d'autre chose qu'elle-même, je ne me connais pas connaissant, en sorte que si l'on retirait à la conscience toute altérité (et c'est bien ce que fait Descartes lors du doute hyperbolique, où ma créance même en l'existence du monde est suspendue), elle ne deviendrait pas pour autant conscience d'elle-même, bien au contraire. Ainsi, lorsque je m'évanouis, je perds la conscience du monde, et du même coup la conscience de ma propre existence. Je ne peux penser et prendre conscience que je pense qu'en pensant à autre chose qu'à moi-même et qu'à ma propre pensée. En d'autres termes, la pensée n'est jamais à elle-même son propre objet. 3 Le détour par l'altérité et la conscience de soi Comment l'esprit alors peut-il se connaître si lui est refusé maintenant et pour toujours un accès direct à lui-même ? De même que je ne peux me voir qu'en voyant autre chose que moi, c'est-à-dire une image de moi qui n'est pas moi (si le miroir se brise, je ne cesserai pas d'exister : l'image qu'il reflète est mon image, mais n'est pas moi-même), de même il faudrait que la conscience trouve un miroir où se refléter. On le sait, c'est chez Hegel l'activité pratique qui offre à l'esprit un tel miroir, et même un miroir grandeur nature : en agissant, en transformant le monde, l'homme y appose la 39 Philosophie Le corrigé marque de son esprit, en sorte que, regardant la nature, c'est sa propre action qu'il voit, et pour tout dire lui-même. Comme l'enfant qui jette des pierres dans l'eau prend conscience de son existence spirituelle en troublant le reflet du monde, l'homme parvient à la conscience de lui-même par son activité pratique, grâce à laquelle il transforme la nature même en image de l'esprit. Conclusion Nous avons vu que l'esprit ne pouvait parvenir à la conscience de lui-même qu'indirectement ou médiatement, en faisant un détour par ce qui n'est pas lui. Est-ce cependant assez dire ? Car enfin, prendre conscience que je suis un être spirituel capable de penser, de connaître et d'inventer, ce n'est pas encore exactement savoir ce que fait mon esprit quand il connaît. Il revient à Husserl d'avoir posé la question : si tout phénomène se donne à la conscience, comment pouvons-nous connaître ce que fait la conscience quand elle connaît ? Or, précisément, si tous les phénomènes se donnent à la conscience, on pourra comprendre indirectement ce que fait celle-ci, en étudiant les structures communes à ces phénomènes eux-mêmes. Mais alors la thèse de Comte se trouve ici confirmée : pour cette discipline qu'est la phénoménologie, la conscience ne saurait être directement connue, et c'est au contraire en observant la façon dont les phénomènes se donnent à nous qu'on en pourra déduire ce que fait la conscience qui les accueille. 40 Sujet 5, Sujet national, juin 2013, série ES La culture › Dissertation : Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? Le sujet Pas à pas ® Comprendre le sujet Le sens du sujet : « Le travail » désigne toute activité par laquelle l'homme transforme un donné pour en tirer un ouvrage quelconque. « Permet-il » : permettre, c'est offrir une possibilité, une occasion. « Prendre conscience de soi » désigne l'opération par laquelle l'individu fait, par la pensée, retour sur lui-même. La question posée interroge le rapport ambigu que le travail entretient avec la conscience de soi : s'il arrive qu'on s'oublie dans le travail, ne peut-on pas aussi s'y découvrir ? L'opinion commune et sa remise en question : À l'évidence, travailler c'est concentrer son attention sur ce qu'on fait, non sur soi-même. Le travail semble être un rapport de l'homme à une réalité extérieure, non de l'homme à lui-même. Pourtant, le travail ne nous permet-il pas de nous éprouver dans l'action et ainsi prendre conscience de nous-mêmes ? ® Mobiliser ses connaissances Repères et notions à connaître et à utiliser dans le traitement de ce sujet : Travail : o Activité de transformation de la nature dans un sens utile à l'homme, en vue de la satisfaction des besoins. Le travail est un phénomène essentiel de la culture et un des fondements de toute société. o Hegel montre que le travail est libérateur, dans la mesure où il permet de s'affranchir de la nature en la dominant et de se discipliner soi-même dans l'effort. Voir également : aliénation ; artisan ; arts mécaniques, arts libéraux, beaux-arts ; capitalisme ; loisir ; machine ; Marx ; oeuvre ; outil ; spécialisation ; technique ; technocratie ; technologie. Conscience : Au sens général, la conscience est le savoir intérieur immédiat que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. La conscience exprime ainsi notre capacité de réflexion et le pouvoir que nous avons de viser autre chose que nous-mêmes. Son essence est selon Husserl l'« intentionnalité» .Voir également : conscience morale ; certitude ; cogito ; Descartes ; être pour soi, être en soi ; évidence ; intuition ; ipséité ; morale ; représentation ; Sartre. 49 Philosophie Le sujet Pas à pas Aliénation : o Du latin alienus, « étranger », de alius, « autre ». En droit, désigne le fait de donner ou de vendre. C'est le sens qu'utilise Rousseau dans Le Contrat social. o Pour Hegel, Feuerbach et Marx, l'aliénation est le processus par lequel un individu est dépossédé de ce qui le constitue au profit d'un autre, ce qui entraîne un asservissement. Voir également : capitalisme ; loisir ; spécialisation ; technocratie ; ...