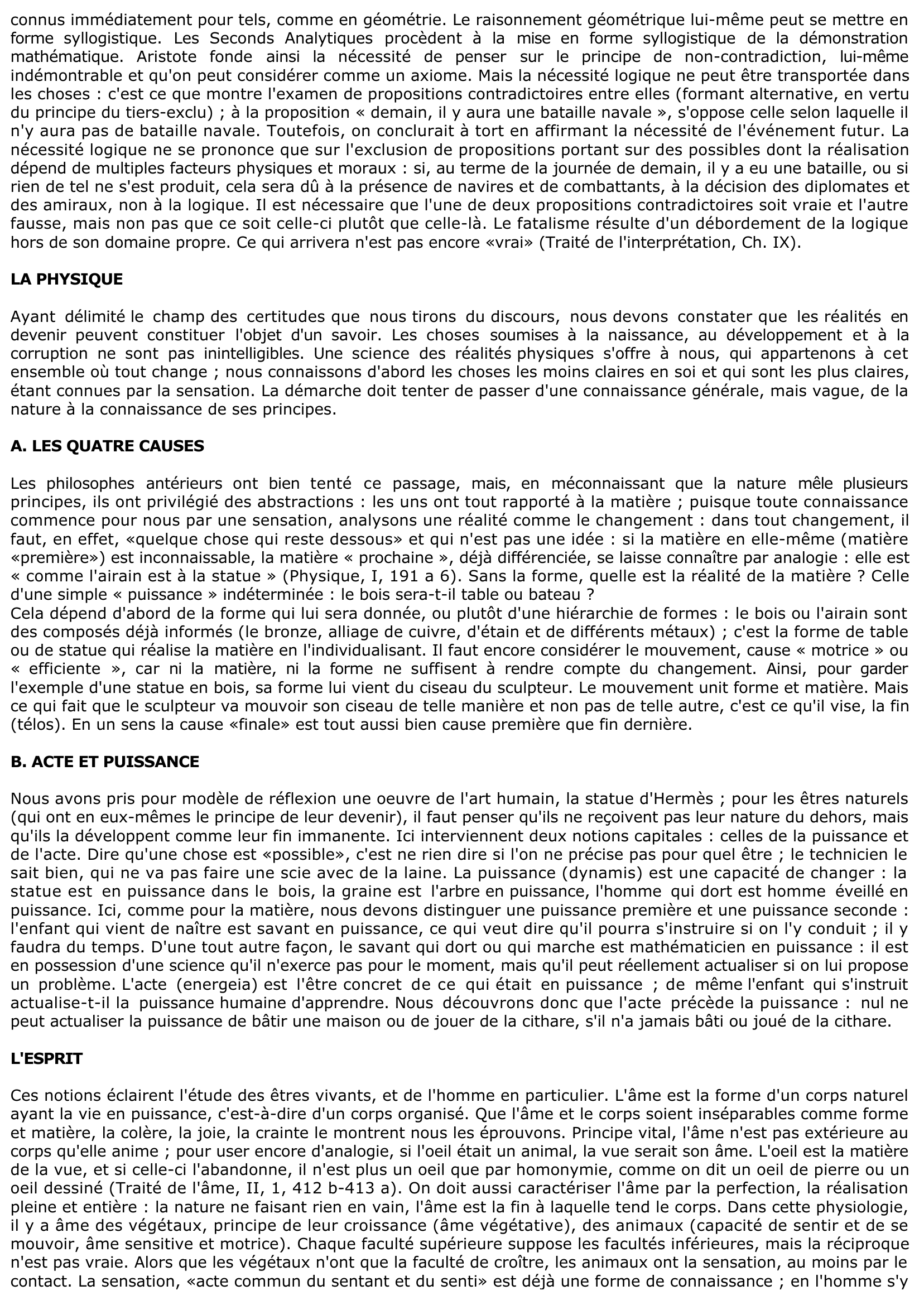Tout savoir sur ARISTOTE...
Publié le 08/07/2009

Extrait du document

Né à Stagire en Macédoine (au Nord de la Grèce), fils de Nicomaque, médecin personnel du roi Amyntas (le père de Philippe), Aristote vient à Athènes dès 366 et entre à l'Académie, école fondée par Platon. Il y étudie, puis y enseigne vingt ans. Platon admire l'étendue de son savoir et l'appelle «le lecteur«. A la mort de Platon, en 347, il se rend à Assos, en Mysie, où le tyran' Hermias protège un cercle platonicien. Il enseigne ensuite à Mitylène, mais en 343, Philippe de Macédoine lui demande de devenir le précepteur de son fils, Alexandre, âgé de treize ans. Plus tard, Alexandre dit que, s'il devait à son père, Philippe, de vivre, il devait à Aristote de vivre noblement. En 336, Philippe est assassiné ; peu de temps après l'avènement de son royal élève, Aristote retourne à Athènes et fonde, près du temple d'Apollon Lycien, un établissement d'enseignement rival de l'Académie, le «Lycée« (335). Il y exerce son enseignement en marchant dans les allées d'un bosquet ou sous un portique, d'où le nom de «promeneurs« (péripatéticiens) que reçoivent ses disciples. Alexandre reprend le dessein de son père : vaincre les Perses et faire l'unité des Grecs. Il emporte, comme son plus précieux bagage, l'Iliade, annotée par Aristote. Après avoir vaincu Darius, il entraîne jusqu'à l'Indus son armée, formée de Grecs, de Macédoniens et de contingents levés dans les contrées qu'il traverse ; il conquiert Babylone, Suse, Persépolis, Ecbatane. Tandis que s'étend indéfiniment le territoire où l'on parle grec, le savoir n'a plus de limites assignables ; il change de nature : aux mathématiques, science proprement rationnelle, succède un savoir en extension, enrichi par l'expérience et exposé à son démenti (parvenus à l'Océan indien, les Grecs découvrent le phénomène des marées et, lors de la bataille d'Arbèles, ils voient pour la première fois des éléphants). Parallèlement à cette transformation du savoir s'accomplit une transformation politique : au libre citoyen succède le sujet d'un monarque. A mesure qu'il s'enfonce vers l'Orient, le succès grise Alexandre ; il exige de ceux qui l'entourent des marques de respect inacceptables par les Grecs : il faut se prosterner devant lui. Callisthène, petit-neveu d'Aristote et historiographe de l'expédition, résiste au faste oriental ; accusé de complot, il est mis à mort à Bactriane en 328. Pendant l'expédition, Aristote reçoit des descriptions, des spécimens de végétaux et d'animaux inconnus des Grecs. Il est à la tête d'une bibliothèque et de collections uniques, sur lesquelles se fonde l'enseignement du Lycée. Quand meurt Alexandre, Aristote, suspect pour ses origines et ses attaches, s'exile à Chalcis, en Eubée, «afin d'épargner aux Athéniens un second attentat contre la philosophie« (323). De fait, le tribunal de l'Aréopage le condamne à mort. Il meurt l'année suivante.

«
connus immédiatement pour tels, comme en géométrie.
Le raisonnement géométrique lui-même peut se mettre enforme syllogistique.
Les Seconds Analytiques procèdent à la mise en forme syllogistique de la démonstrationmathématique.
Aristote fonde ainsi la nécessité de penser sur le principe de non-contradiction, lui-mêmeindémontrable et qu'on peut considérer comme un axiome.
Mais la nécessité logique ne peut être transportée dansles choses : c'est ce que montre l'examen de propositions contradictoires entre elles (formant alternative, en vertudu principe du tiers-exclu) ; à la proposition « demain, il y aura une bataille navale », s'oppose celle selon laquelle iln'y aura pas de bataille navale.
Toutefois, on conclurait à tort en affirmant la nécessité de l'événement futur.
Lanécessité logique ne se prononce que sur l'exclusion de propositions portant sur des possibles dont la réalisationdépend de multiples facteurs physiques et moraux : si, au terme de la journée de demain, il y a eu une bataille, ou sirien de tel ne s'est produit, cela sera dû à la présence de navires et de combattants, à la décision des diplomates etdes amiraux, non à la logique.
Il est nécessaire que l'une de deux propositions contradictoires soit vraie et l'autrefausse, mais non pas que ce soit celle-ci plutôt que celle-là.
Le fatalisme résulte d'un débordement de la logiquehors de son domaine propre.
Ce qui arrivera n'est pas encore «vrai» (Traité de l'interprétation, Ch.
IX).
LA PHYSIQUE
Ayant délimité le champ des certitudes que nous tirons du discours, nous devons constater que les réalités endevenir peuvent constituer l'objet d'un savoir.
Les choses soumises à la naissance, au développement et à lacorruption ne sont pas inintelligibles.
Une science des réalités physiques s'offre à nous, qui appartenons à cetensemble où tout change ; nous connaissons d'abord les choses les moins claires en soi et qui sont les plus claires,étant connues par la sensation.
La démarche doit tenter de passer d'une connaissance générale, mais vague, de lanature à la connaissance de ses principes.
A.
LES QUATRE CAUSES
Les philosophes antérieurs ont bien tenté ce passage, mais, en méconnaissant que la nature mêle plusieursprincipes, ils ont privilégié des abstractions : les uns ont tout rapporté à la matière ; puisque toute connaissancecommence pour nous par une sensation, analysons une réalité comme le changement : dans tout changement, ilfaut, en effet, «quelque chose qui reste dessous» et qui n'est pas une idée : si la matière en elle-même (matière«première») est inconnaissable, la matière « prochaine », déjà différenciée, se laisse connaître par analogie : elle est« comme l'airain est à la statue » (Physique, I, 191 a 6).
Sans la forme, quelle est la réalité de la matière ? Celled'une simple « puissance » indéterminée : le bois sera-t-il table ou bateau ?Cela dépend d'abord de la forme qui lui sera donnée, ou plutôt d'une hiérarchie de formes : le bois ou l'airain sontdes composés déjà informés (le bronze, alliage de cuivre, d'étain et de différents métaux) ; c'est la forme de tableou de statue qui réalise la matière en l'individualisant.
Il faut encore considérer le mouvement, cause « motrice » ou« efficiente », car ni la matière, ni la forme ne suffisent à rendre compte du changement.
Ainsi, pour garderl'exemple d'une statue en bois, sa forme lui vient du ciseau du sculpteur.
Le mouvement unit forme et matière.
Maisce qui fait que le sculpteur va mouvoir son ciseau de telle manière et non pas de telle autre, c'est ce qu'il vise, la fin(télos).
En un sens la cause «finale» est tout aussi bien cause première que fin dernière.
B.
ACTE ET PUISSANCE
Nous avons pris pour modèle de réflexion une oeuvre de l'art humain, la statue d'Hermès ; pour les êtres naturels(qui ont en eux-mêmes le principe de leur devenir), il faut penser qu'ils ne reçoivent pas leur nature du dehors, maisqu'ils la développent comme leur fin immanente.
Ici interviennent deux notions capitales : celles de la puissance etde l'acte.
Dire qu'une chose est «possible», c'est ne rien dire si l'on ne précise pas pour quel être ; le technicien lesait bien, qui ne va pas faire une scie avec de la laine.
La puissance (dynamis) est une capacité de changer : lastatue est en puissance dans le bois, la graine est l'arbre en puissance, l'homme qui dort est homme éveillé enpuissance.
Ici, comme pour la matière, nous devons distinguer une puissance première et une puissance seconde :l'enfant qui vient de naître est savant en puissance, ce qui veut dire qu'il pourra s'instruire si on l'y conduit ; il yfaudra du temps.
D'une tout autre façon, le savant qui dort ou qui marche est mathématicien en puissance : il esten possession d'une science qu'il n'exerce pas pour le moment, mais qu'il peut réellement actualiser si on lui proposeun problème.
L'acte (energeia) est l'être concret de ce qui était en puissance ; de même l'enfant qui s'instruitactualise-t-il la puissance humaine d'apprendre.
Nous découvrons donc que l'acte précède la puissance : nul nepeut actualiser la puissance de bâtir une maison ou de jouer de la cithare, s'il n'a jamais bâti ou joué de la cithare.
L'ESPRIT
Ces notions éclairent l'étude des êtres vivants, et de l'homme en particulier.
L'âme est la forme d'un corps naturelayant la vie en puissance, c'est-à-dire d'un corps organisé.
Que l'âme et le corps soient inséparables comme formeet matière, la colère, la joie, la crainte le montrent nous les éprouvons.
Principe vital, l'âme n'est pas extérieure aucorps qu'elle anime ; pour user encore d'analogie, si l'oeil était un animal, la vue serait son âme.
L'oeil est la matièrede la vue, et si celle-ci l'abandonne, il n'est plus un oeil que par homonymie, comme on dit un oeil de pierre ou unoeil dessiné (Traité de l'âme, II, 1, 412 b-413 a).
On doit aussi caractériser l'âme par la perfection, la réalisationpleine et entière : la nature ne faisant rien en vain, l'âme est la fin à laquelle tend le corps.
Dans cette physiologie,il y a âme des végétaux, principe de leur croissance (âme végétative), des animaux (capacité de sentir et de semouvoir, âme sensitive et motrice).
Chaque faculté supérieure suppose les facultés inférieures, mais la réciproquen'est pas vraie.
Alors que les végétaux n'ont que la faculté de croître, les animaux ont la sensation, au moins par lecontact.
La sensation, «acte commun du sentant et du senti» est déjà une forme de connaissance ; en l'homme s'y.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote: Le choix judicieux est l'affaire des gens de savoir
- Aristote: Tous les hommes desirent naturellement savoir
- PODCAST: « Savoir, c'est connaître par le moyen de la démonstration. » Aristote, Organon.
- Commentez la tirade de Dorante dans La Critique de l'École des Femmes (1663, sc. 6) : »Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles, dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde; et cependant ce ne sont que quelques observations aisées, que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes; et le même bon sens qui a fait aut
- « Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. » (ARISTOTE, Métaphysique I, chap. II.). Commentez cette citation.