Un scientifique peut-il être adepte à une religion ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
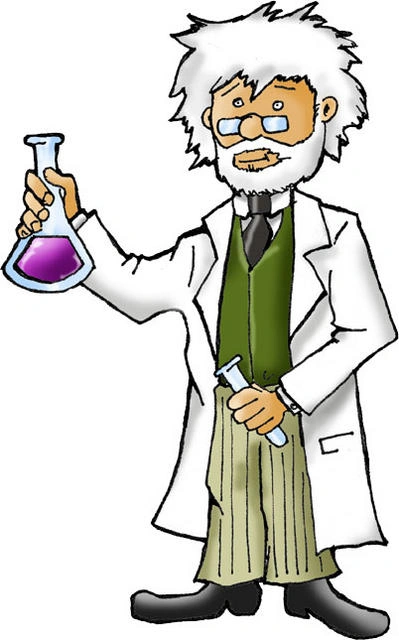
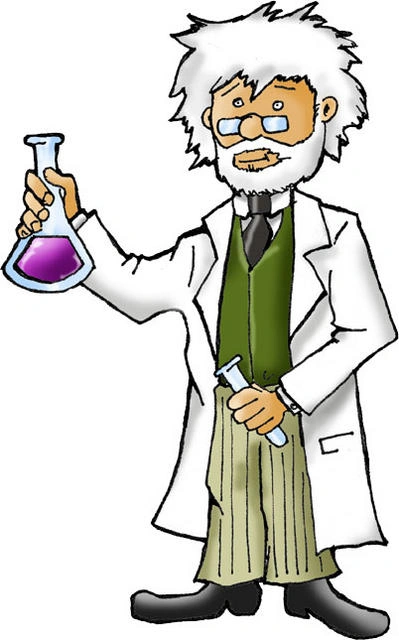
«
on peut prévoir que le mercure se stabilisera à une hauteur d'environ 76 cm.
Aux yeux de Popper, nous sommes bienici dans le domaine de la science car il y a bien falsifiabilité de l'hypothèse.
En effet, si la hauteur de mercureconstatée est très différente de celle qu'on attend, on est assuré que l'hypothèse de Galilée est fausse.
Si, enrevanche, la hauteur de mercure est bien de 76 cm (ce qui fut le cas) alors l'hypothèse est probablement vraie.
Lesthéories scientifiques ont un caractère hypothétique.
On peut infirmer une thèse mais jamais la confirmertotalement.
« Nous ne savons pas, nous pouvons seulement conjecturer ».
L'attitude scientifique est donc uneattitude critique qui ne cherche pas des vérifications mais tout au contraire des tests qui peuvent réfuter la théoriemais non l'établir définitivement.
On voit donc qu'une théorie scientifique n'est vraie que de manière temporaire, contrairement aux vérités éternellesde la religion.
-Avec Bachelard nous voyons que non seulement les vérités scientifiques sont temporaires, mais qu'elles sontconstruites, c'est-à-dire qu'elles sont le fruit du travail du scientifique.
Cela se joue à deux niveaux: tout d'abord lescientifique doit se débarrasser des obstacles épistémologiques au terme d'une psychanalyse de l'esprit scientifique:il faut que le scientifique dépasse ses croyances et ses préjugés, mette de coté ce qu'il désire voir comme vrai.C'est en allant au-delà de la croyance qu'il peut ensuite problématiser son objet, poser les questions justes: « pourun esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question.
S'il n'y a pas eu de question, il ne peut yavoir de connaissance scientifique.
Rien ne va de soi.
Rien n'est donné.
Tout est construit.
( La formation de l'esprit scientifique ).
III-Misère de l'homme sans Dieu
La science se construit, la religion se révèle.
L'opposition semble consommée entre deux méthodes, deux visions dumonde.
Le scientifique travaille à l'élaboration de théories qu'il remet ensuite en cause par des expériences, il tentede se détacher de ses croyances, de ses a priori, pour aboutir à une vérité aussi universelle que possible.
L'hommereligieux se vit dans la croyance que l'on ne peut remettre en cause, ses vérités sont révélées ou bien établies pardes expériences mystiques, en tout cas intouchables.
Son objet, Dieu, est infalsifiable, il n'appartient pas audomaine de la raison.
C'est peut-être là précisément que ce joue un rapprochement, du moins un tentative de compréhension réciproque,et une possible cohabitation.
Dieu est au-delà de la raison, il ne se démontre pas Kant, Critique de la raison pure ). La religion ne parle pas que de la formation de l'homme et du monde, où savision est certes discréditée par la science.
Là n'est pas son message.
Lareligion ne parle pas de faits, elle parle de valeurs.
La science cherche àexpliquer, recherche des causes, la religion donne du sen, elle interprète lemonde comme un message divin où l'homme à sa place.
D'ailleurs le besoin dereligion se fait de plus en plus sentir face aux avancées froides de la sciencemoderne.
Mettons en parallèle deux textes d'auteurs très différents.
Toutd'abord Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, qui présente les conclusions de recherches avancés en biologie et termine en s'interrogeantsur la place de l'homme dans l'univers: « s'il accepte ce message dans sonentière signification, il faut bien que l'Homme enfin se réveille de son rêvemillénaire pour découvrir sa totale solitude, son étrangeté radicale.
Il saitmaintenant que, comme un tzigane, il est en marge de l'univers où il doitvivre.
Univers sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs comme à sessouffrances ou à ses crimes.
» L'ancienne alliance rompue entre l'homme et lanature, l'homme se retrouve seule, perdue sans but et sans valeurs.
Ce texteest a rapproché de celui de Pascal: Les Pensées: 205, 206: « Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédant etsuivant le petit espace que je remplis (...) Le silence éternel de ses espacesinfinis m'effraie ».
C'est le résultat d'un monde où la science ne donne passens à l'homme, et où au contraire elle lui fait perdre tout repère, toutevaleurs.
Le message de la science sur la destinée de l'homme, son rôle, ou ses buts, est nulle, voire nihiliste.
L'homme a donc besoin de se raccrocher à des croyances pour avancer, faire unpari sur la non vacuité du monde, sur l'existence d'une entité supérieure qui justifie toutes le souffrances, qui donnesens à l'homme; Pascal: « Misère de l'homme sans Dieu; Félicité de l'homme avec Dieu.
» Pensées, 60
Conclusion
La science et la religion peuvent donc se compléter, chacune donnant une part de vérité sur l'homme, chacundélivrant un message différent.
Le scientifique peut adhérer à une religion si celle-ci n'entrave pas son travail: il nefaut pas que ses croyances influent sur ses expériences.
Il faut qu'il respecte la méthode scientifique.
La religions'identifie ici plus à un besoin de donné du sens à sa vie, plutot que le respect scrupuleux de rites ou d'un dogme..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- pourquoi le progrès scientifique n'a t'il pas fait disparaitre la religion
- pourquoi le progrès scientifique n'a t'il pas fait disparaitre la religion
- Pourquoi le progrès scientifique n'a-t-il pas fait disparaître la religion ?
- Vous étudierez cet exposé sur le symbolisme en vous demandant s'il éclaire tous les aspects de la poésie de Valéry : Ce qui fut baptisé : le Symbolisme, se résume très simplement dans l'intention commune à plusieurs familles de poètes (d'ailleurs ennemies entre elles) de « reprendre à la Musique leur bien ». Le secret de ce mouvement n'est pas autre. L'obscurité, les étrangetés qui lui furent tant reprochées ; l'apparence de relations trop intimes avec les littératures anglaise, slave

































