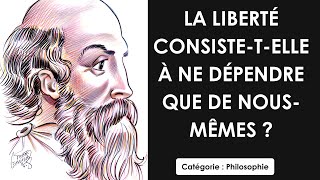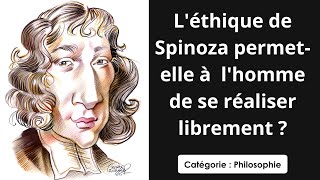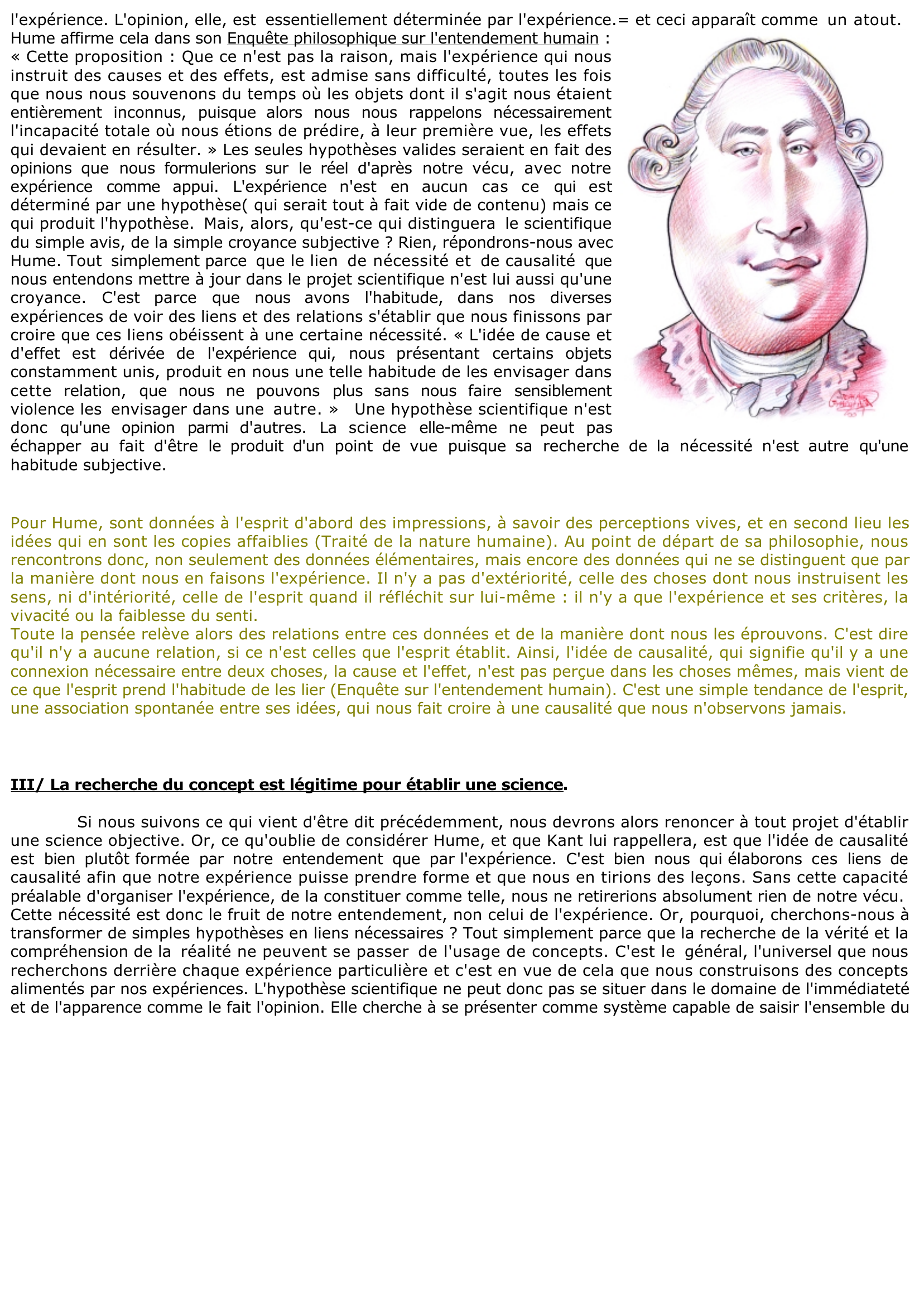Une hypothese scientifique n'est-elle qu'une opinion parmi d'autres ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
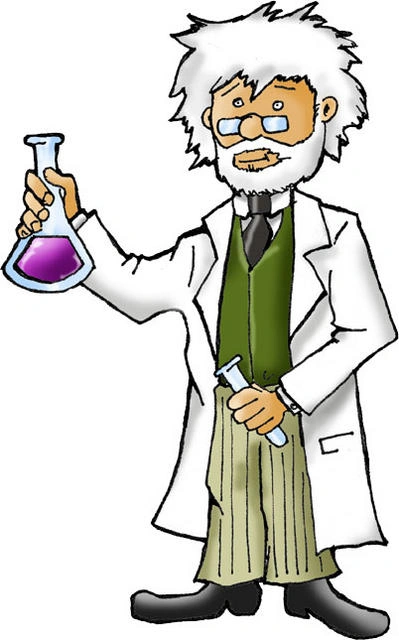
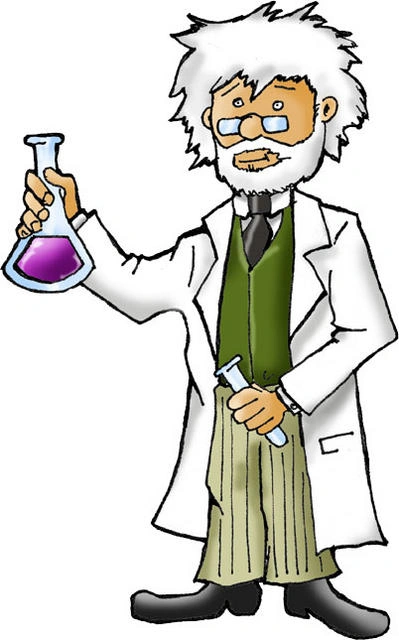
«
l'expérience.
L'opinion, elle, est essentiellement déterminée par l'expérience.= et ceci apparaît comme un atout.
Hume affirme cela dans son Enquête philosophique sur l'entendement humain : « Cette proposition : Que ce n'est pas la raison, mais l'expérience qui nousinstruit des causes et des effets, est admise sans difficulté, toutes les foisque nous nous souvenons du temps où les objets dont il s'agit nous étaiententièrement inconnus, puisque alors nous nous rappelons nécessairementl'incapacité totale où nous étions de prédire, à leur première vue, les effetsqui devaient en résulter.
» Les seules hypothèses valides seraient en fait desopinions que nous formulerions sur le réel d'après notre vécu, avec notreexpérience comme appui.
L'expérience n'est en aucun cas ce qui estdéterminé par une hypothèse( qui serait tout à fait vide de contenu) mais cequi produit l'hypothèse.
Mais, alors, qu'est-ce qui distinguera le scientifiquedu simple avis, de la simple croyance subjective ? Rien, répondrons-nous avecHume.
Tout simplement parce que le lien de nécessité et de causalité quenous entendons mettre à jour dans le projet scientifique n'est lui aussi qu'unecroyance.
C'est parce que nous avons l'habitude, dans nos diversesexpériences de voir des liens et des relations s'établir que nous finissons parcroire que ces liens obéissent à une certaine nécessité.
« L'idée de cause etd'effet est dérivée de l'expérience qui, nous présentant certains objetsconstamment unis, produit en nous une telle habitude de les envisager danscette relation, que nous ne pouvons plus sans nous faire sensiblementviolence les envisager dans une autre.
» Une hypothèse scientifique n'estdonc qu'une opinion parmi d'autres.
La science elle-même ne peut paséchapper au fait d'être le produit d'un point de vue puisque sa recherche de la nécessité n'est autre qu'unehabitude subjective.
Pour Hume, sont données à l'esprit d'abord des impressions, à savoir des perceptions vives, et en second lieu lesidées qui en sont les copies affaiblies (Traité de la nature humaine).
Au point de départ de sa philosophie, nousrencontrons donc, non seulement des données élémentaires, mais encore des données qui ne se distinguent que parla manière dont nous en faisons l'expérience.
Il n'y a pas d'extériorité, celle des choses dont nous instruisent lessens, ni d'intériorité, celle de l'esprit quand il réfléchit sur lui-même : il n'y a que l'expérience et ses critères, lavivacité ou la faiblesse du senti.Toute la pensée relève alors des relations entre ces données et de la manière dont nous les éprouvons.
C'est direqu'il n'y a aucune relation, si ce n'est celles que l'esprit établit.
Ainsi, l'idée de causalité, qui signifie qu'il y a uneconnexion nécessaire entre deux choses, la cause et l'effet, n'est pas perçue dans les choses mêmes, mais vient dece que l'esprit prend l'habitude de les lier (Enquête sur l'entendement humain).
C'est une simple tendance de l'esprit,une association spontanée entre ses idées, qui nous fait croire à une causalité que nous n'observons jamais.
III/ La recherche du concept est légitime pour établir une science .
Si nous suivons ce qui vient d'être dit précédemment, nous devrons alors renoncer à tout projet d'établirune science objective.
Or, ce qu'oublie de considérer Hume, et que Kant lui rappellera, est que l'idée de causalitéest bien plutôt formée par notre entendement que par l'expérience.
C'est bien nous qui élaborons ces liens decausalité afin que notre expérience puisse prendre forme et que nous en tirions des leçons.
Sans cette capacitépréalable d'organiser l'expérience, de la constituer comme telle, nous ne retirerions absolument rien de notre vécu.
Cette nécessité est donc le fruit de notre entendement, non celui de l'expérience.
Or, pourquoi, cherchons-nous àtransformer de simples hypothèses en liens nécessaires ? Tout simplement parce que la recherche de la vérité et lacompréhension de la réalité ne peuvent se passer de l'usage de concepts.
C'est le général, l'universel que nousrecherchons derrière chaque expérience particulière et c'est en vue de cela que nous construisons des conceptsalimentés par nos expériences.
L'hypothèse scientifique ne peut donc pas se situer dans le domaine de l'immédiatetéet de l'apparence comme le fait l'opinion.
Elle cherche à se présenter comme système capable de saisir l'ensemble du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bachelard, Formation de l'esprit scientifique : science et opinion : explication
- Corrigé du commentaire "Bachelard, Formation de l'esprit scientifique : science et opinion": « l'opinion a, en droit, toujours tort. »
- Alain disait : « La vérité n'est jamais qu'une suite d'erreurs redressées. » Quelle signification et quelle valeur cette opinion prend-elle dans la recherche scientifique ?
- L'opinion est-elle pour la connaissance scientifique un point d'appui ou un obstacle ?
- Taine, Paul Bourget ont fait l'éloge des romans de Mérimée, de Stendhal, de Balzac, en mettant en lumière ce qu'il y avait de vérité « scientifique » dans leur œuvre, en opposant cette vérité à la « convention » des romanciers romantiques ou romanesques. Expliquer et discuter cette opinion.