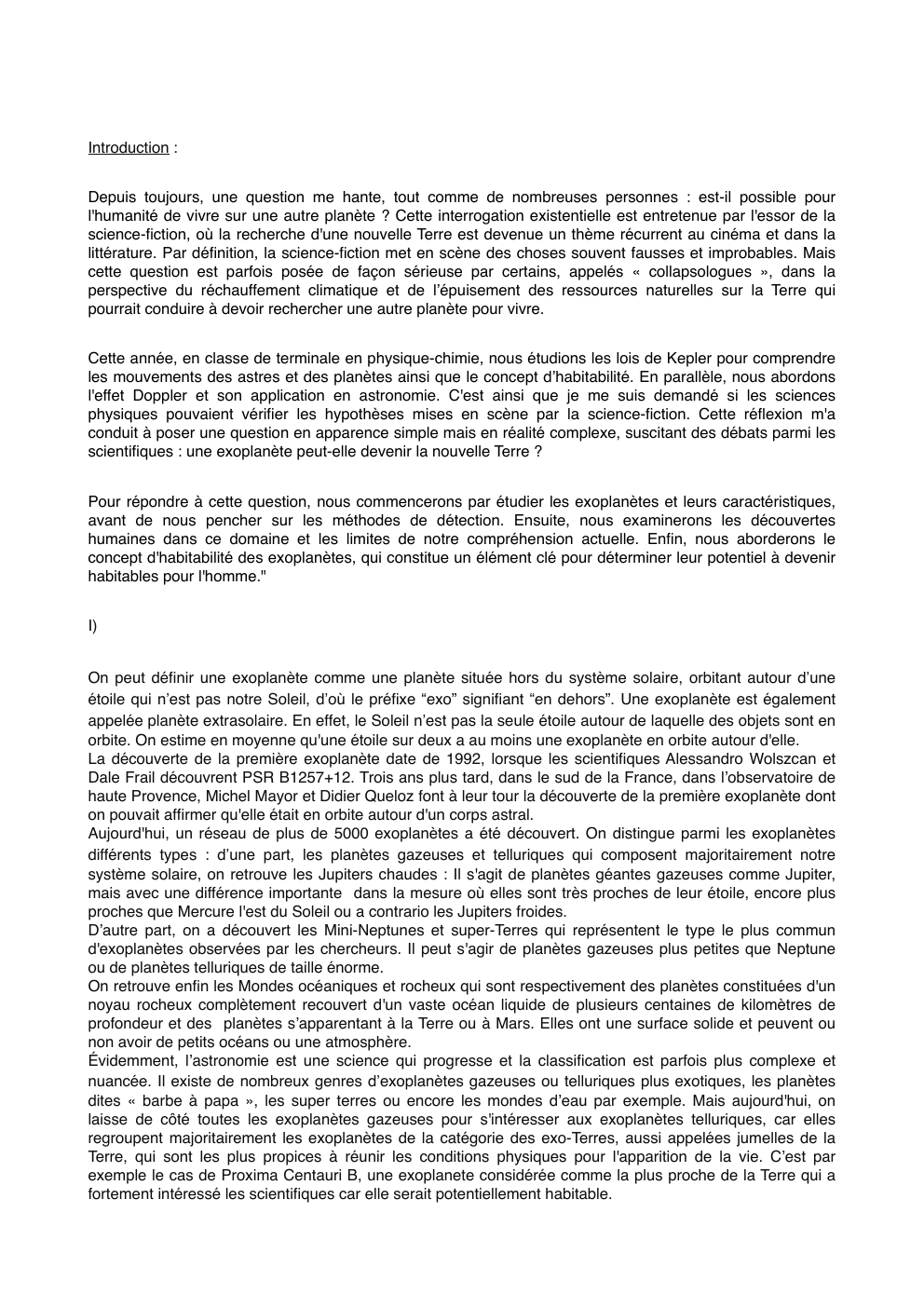grand oral masse planètes
Publié le 24/04/2025
Extrait du document
«
Introduction :
Depuis toujours, une question me hante, tout comme de nombreuses personnes : est-il possible pour
l'humanité de vivre sur une autre planète ? Cette interrogation existentielle est entretenue par l'essor de la
science- ction, où la recherche d'une nouvelle Terre est devenue un thème récurrent au cinéma et dans la
littérature.
Par dé nition, la science- ction met en scène des choses souvent fausses et improbables.
Mais
cette question est parfois posée de façon sérieuse par certains, appelés « collapsologues », dans la
perspective du réchauffement climatique et de l’épuisement des ressources naturelles sur la Terre qui
pourrait conduire à devoir rechercher une autre planète pour vivre.
Cette année, en classe de terminale en physique-chimie, nous étudions les lois de Kepler pour comprendre
les mouvements des astres et des planètes ainsi que le concept d’habitabilité.
En parallèle, nous abordons
l'effet Doppler et son application en astronomie.
C'est ainsi que je me suis demandé si les sciences
physiques pouvaient véri er les hypothèses mises en scène par la science- ction.
Cette ré exion m'a
conduit à poser une question en apparence simple mais en réalité complexe, suscitant des débats parmi les
scienti ques : une exoplanète peut-elle devenir la nouvelle Terre ?
Pour répondre à cette question, nous commencerons par étudier les exoplanètes et leurs caractéristiques,
avant de nous pencher sur les méthodes de détection.
Ensuite, nous examinerons les découvertes
humaines dans ce domaine et les limites de notre compréhension actuelle.
En n, nous aborderons le
concept d'habitabilité des exoplanètes, qui constitue un élément clé pour déterminer leur potentiel à devenir
habitables pour l'homme."
I)
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
On peut dé nir une exoplanète comme une planète située hors du système solaire, orbitant autour d’une
étoile qui n’est pas notre Soleil, d’où le pré xe “exo” signi ant “en dehors”.
Une exoplanète est également
appelée planète extrasolaire.
En effet, le Soleil n’est pas la seule étoile autour de laquelle des objets sont en
orbite.
On estime en moyenne qu'une étoile sur deux a au moins une exoplanète en orbite autour d'elle.
La découverte de la première exoplanète date de 1992, lorsque les scienti ques Alessandro Wolszcan et
Dale Frail découvrent PSR B1257+12.
Trois ans plus tard, dans le sud de la France, dans l’observatoire de
haute Provence, Michel Mayor et Didier Queloz font à leur tour la découverte de la première exoplanète dont
on pouvait af rmer qu'elle était en orbite autour d'un corps astral.
Aujourd'hui, un réseau de plus de 5000 exoplanètes a été découvert.
On distingue parmi les exoplanètes
différents types : d’une part, les planètes gazeuses et telluriques qui composent majoritairement notre
système solaire, on retrouve les Jupiters chaudes : Il s'agit de planètes géantes gazeuses comme Jupiter,
mais avec une différence importante dans la mesure où elles sont très proches de leur étoile, encore plus
proches que Mercure l'est du Soleil ou a contrario les Jupiters froides.
D’autre part, on a découvert les Mini-Neptunes et super-Terres qui représentent le type le plus commun
d'exoplanètes observées par les chercheurs.
Il peut s'agir de planètes gazeuses plus petites que Neptune
ou de planètes telluriques de taille énorme.
On retrouve en n les Mondes océaniques et rocheux qui sont respectivement des planètes constituées d'un
noyau rocheux complètement recouvert d'un vaste océan liquide de plusieurs centaines de kilomètres de
profondeur et des planètes s’apparentant à la Terre ou à Mars.
Elles ont une surface solide et peuvent ou
non avoir de petits océans ou une atmosphère.
Évidemment, l’astronomie est une science qui progresse et la classi cation est parfois plus complexe et
nuancée.
Il existe de nombreux genres d’exoplanètes gazeuses ou telluriques plus exotiques, les planètes
dites « barbe à papa », les super terres ou encore les mondes d’eau par exemple.
Mais aujourd'hui, on
laisse de côté toutes les exoplanètes gazeuses pour s'intéresser aux exoplanètes telluriques, car elles
regroupent majoritairement les exoplanètes de la catégorie des exo-Terres, aussi appelées jumelles de la
Terre, qui sont les plus propices à réunir les conditions physiques pour l'apparition de la vie.
C’est par
exemple le cas de Proxima Centauri B, une exoplanete considérée comme la plus proche de la Terre qui a
fortement intéressé les scienti ques car elle serait potentiellement habitable.
II)
Depuis que les exoplanètes sont devenues une préoccupation majeure pour les scienti ques, divers moyens
de détection ont été développés.
Les premières méthodes consistaient à envoyer des sondes pour les
étudier.
Bien que cette approche soit ef cace pour les planètes de notre système solaire, elle est inutile pour
les exoplanètes.
Par exemple, envoyer la sonde solaire Parker, la plus rapide qui atteint une vitesse de 724
000 km/h, vers Proxima Centauri, l’exoplanète habitable la plus proche, prendrait près de 7 000 ans.
Une autre méthode, la photographie depuis la Terre, s’avère également inadaptée.
Les photos de Neptune
et d’Uranus prises depuis la Terre ne permettent pas de distinguer clairement la surface de ces planètes.
De
plus, la plupart des exoplanètes émettent très peu de lumière comparées à leur étoile, qui en émet des
millions de fois plus.
C’est ici que l’effet Doppler-Fizeau joue un rôle crucial dans la détection des exoplanètes.
En étudiant le
décalage spectral d’une étoile, on peut obtenir des informations précieuses sur une exoplanète.
Lorsqu’une
exoplanète orbite autour d’une étoile, le système étoile-exoplanète tourne autour d’un centre de gravité
commun.
Ainsi, l’étoile se rapproche puis s’éloigne de l’observateur, ce qui provoque une modi cation de
son spectre lumineux.
Lorsque l’étoile s’éloigne de la Terre, on observe un décalage vers le rouge, appelé « red shift ».
Lorsque
l’étoile se rapproche, on observe un décalage vers le bleu, appelé « blue shift ».
En analysant ces
changements sur plusieurs cycles, on obtient la vitesse radiale, c’est-à-dire la vitesse à laquelle l’étoile
s’approche ou s’éloigne de l’observateur.
La périodicité de cette vitesse radiale est une preuve de la
présence d’une exoplanète, car sans celle-ci, le spectre de l’étoile ne varierait pas.
Pour mieux comprendre, voici la formule pour la vitesse radiale du système étoile-exoplanète : DeltaY/Y = V/
c ,ou deltaY est le décalage spectral de formule DeltaY= Y- Ymesuré , c est la célérité de l’air et V la vitesse
radiale exprimé par V= deltaY*c/Y
En étudiant la variation des vitesses radiales, nous pouvons déterminer deux informations cruciales sur
l’exoplanète : son orbite et sa période.
Une variation sinusoïdale des vitesses radiales indique une orbite
circulaire, tandis que des pics marqués indiquent une orbite elliptique.
Pour la période de l’exoplanète, si nous observons une répétition des cycles de vitesse radiale, nous
pouvons la calculer.
Par exemple, si trois périodes comme sur le dessin 3T correspondent à une durée X
alors on a T= x/3
Et T=x/3*24*3600 permets exprimé la période initialement en jours en secondes.
En conclusion, l’effet
Doppler-Fizeau nous permet de détecter les exoplanètes en analysant les variations spectrales de leur étoile
hôte.
Cela nous donne des informations ables et précieuses sur l’orbite et la période des exoplanètes, des
éléments cruciaux pour comprendre ces mondes lointains.
fi
fi
fi
fi
III)
Le concept d’habitabilité permet de déterminer si une exoplanète pourrait abriter la vie, en se basant sur la
possibilité de maintenir de l’eau liquide.
Les astronomes dé nissent une zone habitable autour d'une étoile,
où une exoplanète pourrait conserver de l’eau liquide.
Cette zone dépend de la distance entre l’étoile et
l’exoplanète ainsi que de la nature de l’étoile : plus l’étoile est....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand Oral: Le nombre d’or
- Grand oral hggsp les ZEE EN ARCTIQUE
- Grand Oral – Svt Quels sont les conséquences de la prise d’un produit dopants sur l’organisme : exemple du Trenbolone
- Ressources grand oral fast fashion
- Grand Oral: Les fonctions