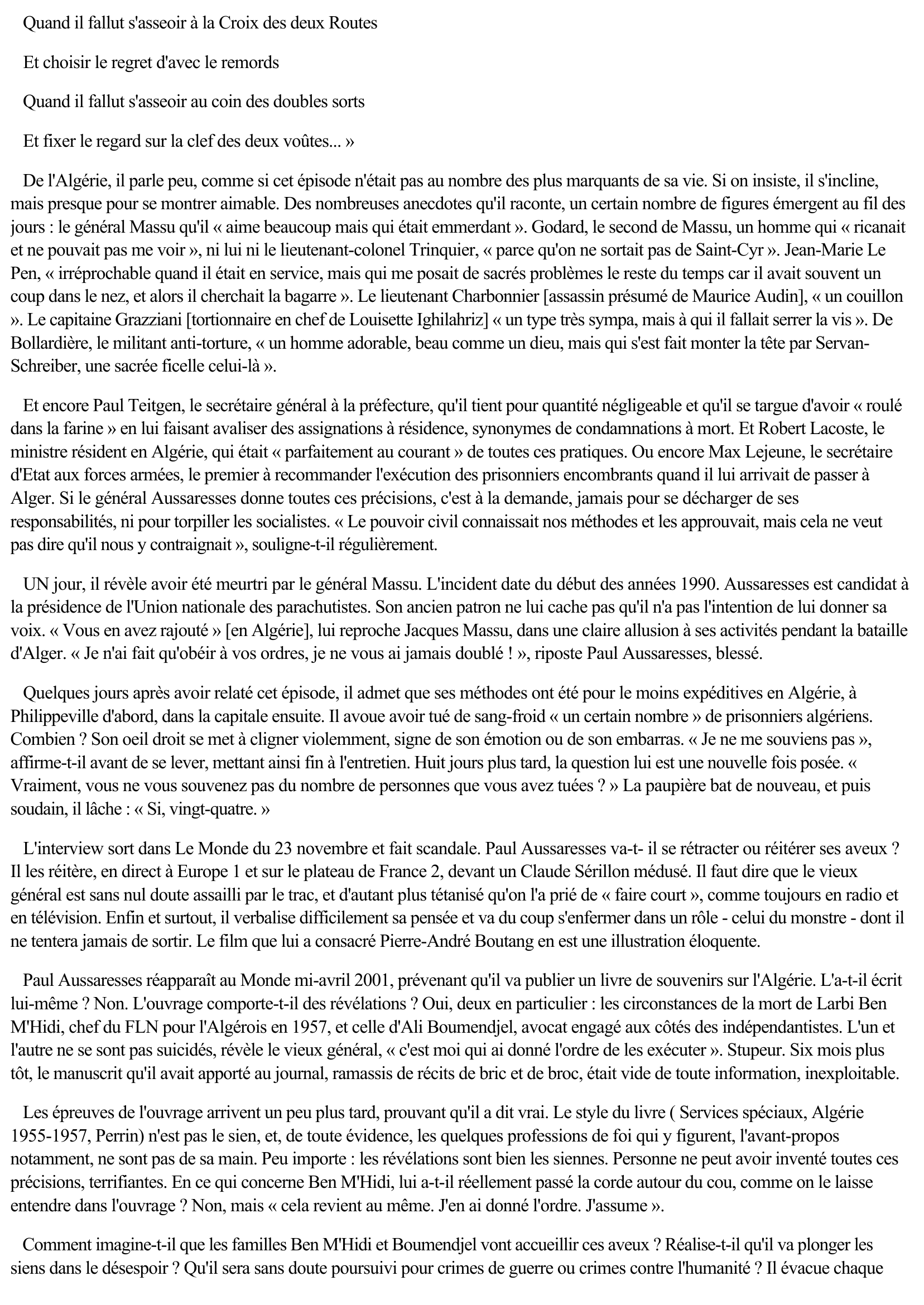Le secret du général Aussaresses
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
Quand il fallut s'asseoir à la Croix des deux Routes
Et choisir le regret d'avec le remords
Quand il fallut s'asseoir au coin des doubles sorts
Et fixer le regard sur la clef des deux voûtes...
»
De l'Algérie, il parle peu, comme si cet épisode n'était pas au nombre des plus marquants de sa vie.
Si on insiste, il s'incline,mais presque pour se montrer aimable.
Des nombreuses anecdotes qu'il raconte, un certain nombre de figures émergent au fil desjours : le général Massu qu'il « aime beaucoup mais qui était emmerdant ».
Godard, le second de Massu, un homme qui « ricanaitet ne pouvait pas me voir », ni lui ni le lieutenant-colonel Trinquier, « parce qu'on ne sortait pas de Saint-Cyr ».
Jean-Marie LePen, « irréprochable quand il était en service, mais qui me posait de sacrés problèmes le reste du temps car il avait souvent uncoup dans le nez, et alors il cherchait la bagarre ».
Le lieutenant Charbonnier [assassin présumé de Maurice Audin], « un couillon».
Le capitaine Grazziani [tortionnaire en chef de Louisette Ighilahriz] « un type très sympa, mais à qui il fallait serrer la vis ».
DeBollardière, le militant anti-torture, « un homme adorable, beau comme un dieu, mais qui s'est fait monter la tête par Servan-Schreiber, une sacrée ficelle celui-là ».
Et encore Paul Teitgen, le secrétaire général à la préfecture, qu'il tient pour quantité négligeable et qu'il se targue d'avoir « roulédans la farine » en lui faisant avaliser des assignations à résidence, synonymes de condamnations à mort.
Et Robert Lacoste, leministre résident en Algérie, qui était « parfaitement au courant » de toutes ces pratiques.
Ou encore Max Lejeune, le secrétaired'Etat aux forces armées, le premier à recommander l'exécution des prisonniers encombrants quand il lui arrivait de passer àAlger.
Si le général Aussaresses donne toutes ces précisions, c'est à la demande, jamais pour se décharger de sesresponsabilités, ni pour torpiller les socialistes.
« Le pouvoir civil connaissait nos méthodes et les approuvait, mais cela ne veutpas dire qu'il nous y contraignait », souligne-t-il régulièrement.
UN jour, il révèle avoir été meurtri par le général Massu.
L'incident date du début des années 1990.
Aussaresses est candidat àla présidence de l'Union nationale des parachutistes.
Son ancien patron ne lui cache pas qu'il n'a pas l'intention de lui donner savoix.
« Vous en avez rajouté » [en Algérie], lui reproche Jacques Massu, dans une claire allusion à ses activités pendant la batailled'Alger.
« Je n'ai fait qu'obéir à vos ordres, je ne vous ai jamais doublé ! », riposte Paul Aussaresses, blessé.
Quelques jours après avoir relaté cet épisode, il admet que ses méthodes ont été pour le moins expéditives en Algérie, àPhilippeville d'abord, dans la capitale ensuite.
Il avoue avoir tué de sang-froid « un certain nombre » de prisonniers algériens.Combien ? Son oeil droit se met à cligner violemment, signe de son émotion ou de son embarras.
« Je ne me souviens pas »,affirme-t-il avant de se lever, mettant ainsi fin à l'entretien.
Huit jours plus tard, la question lui est une nouvelle fois posée.
«Vraiment, vous ne vous souvenez pas du nombre de personnes que vous avez tuées ? » La paupière bat de nouveau, et puissoudain, il lâche : « Si, vingt-quatre.
»
L'interview sort dans Le Monde du 23 novembre et fait scandale.
Paul Aussaresses va-t- il se rétracter ou réitérer ses aveux ?Il les réitère, en direct à Europe 1 et sur le plateau de France 2, devant un Claude Sérillon médusé.
Il faut dire que le vieuxgénéral est sans nul doute assailli par le trac, et d'autant plus tétanisé qu'on l'a prié de « faire court », comme toujours en radio eten télévision.
Enfin et surtout, il verbalise difficilement sa pensée et va du coup s'enfermer dans un rôle - celui du monstre - dont ilne tentera jamais de sortir.
Le film que lui a consacré Pierre-André Boutang en est une illustration éloquente.
Paul Aussaresses réapparaît au Monde mi-avril 2001, prévenant qu'il va publier un livre de souvenirs sur l'Algérie.
L'a-t-il écritlui-même ? Non.
L'ouvrage comporte-t-il des révélations ? Oui, deux en particulier : les circonstances de la mort de Larbi BenM'Hidi, chef du FLN pour l'Algérois en 1957, et celle d'Ali Boumendjel, avocat engagé aux côtés des indépendantistes.
L'un etl'autre ne se sont pas suicidés, révèle le vieux général, « c'est moi qui ai donné l'ordre de les exécuter ».
Stupeur.
Six mois plustôt, le manuscrit qu'il avait apporté au journal, ramassis de récits de bric et de broc, était vide de toute information, inexploitable.
Les épreuves de l'ouvrage arrivent un peu plus tard, prouvant qu'il a dit vrai.
Le style du livre ( Services spéciaux, Algérie1955-1957, Perrin) n'est pas le sien, et, de toute évidence, les quelques professions de foi qui y figurent, l'avant-proposnotamment, ne sont pas de sa main.
Peu importe : les révélations sont bien les siennes.
Personne ne peut avoir inventé toutes cesprécisions, terrifiantes.
En ce qui concerne Ben M'Hidi, lui a-t-il réellement passé la corde autour du cou, comme on le laisseentendre dans l'ouvrage ? Non, mais « cela revient au même.
J'en ai donné l'ordre.
J'assume ».
Comment imagine-t-il que les familles Ben M'Hidi et Boumendjel vont accueillir ces aveux ? Réalise-t-il qu'il va plonger lessiens dans le désespoir ? Qu'il sera sans doute poursuivi pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ? Il évacue chaque.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- C.E. 26 juin 1959, SYNDICAT GÉNÉRAL DES INGÉNIEURS-CONSEILS, Rec. 394
- Dissertation sur le général de gaulle
- Le Foyer Général Cornet : rapport de stage
- Un Secret de Grimbert
- Le commentaire de texte : fiche méthode Définition de l’exercice Extrait de la note de service du 23/07/2020, BO spécial n°7du 30 juillet 2020 Pour le baccalauréat général : un commentaire ou une dissertation.