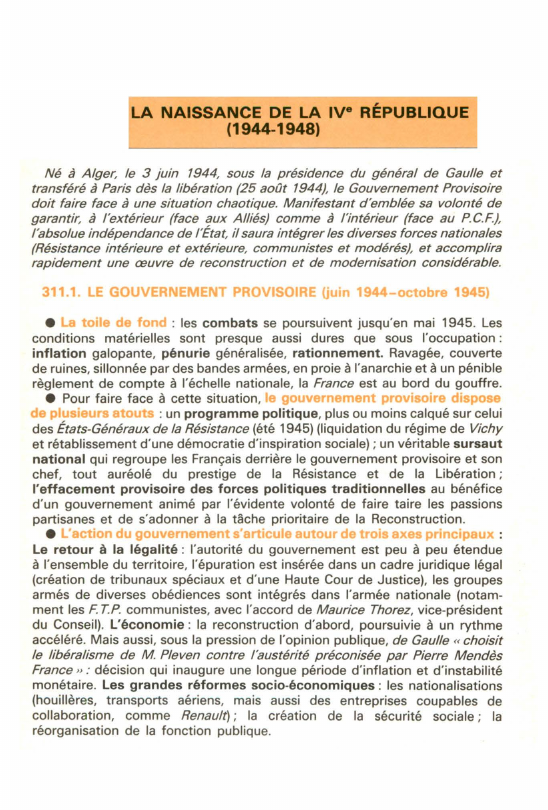République, IVe
Publié le 05/04/2013

Extrait du document
1 PRÉSENTATION République, IVe, régime politique de la France de 1946 à 1958.
La IVe République fit, de sa mort aux années quatre-vingt, l’objet d’une condamnation systématique, laissant le souvenir d’une période marquée par les divisions et une instabilité ministérielle chronique. Pourtant, son bilan, aujourd’hui réexaminé, fait apparaître des réalisations importantes : la reconstruction d’un pays dévasté par quatre années de guerre, un essor économique sans précédent, la fondation de l’Europe communautaire, la gestion de la majeure partie de la décolonisation et, en matière de politique intérieure, l’accès du droit de vote aux femmes.
2 UN RÉGIME NÉ DE LA GUERRE Depuis 1943, avec les défaites allemandes et japonaises qui s’accumulaient, avec l’adhésion de plus en plus considérable des Français à la Résistance, la légitimité du Comité français de libération nationale (CFLN) et de son chef, le général de Gaulle, était devenue incontestable. Le 2 juin 1944, le CFLN devint le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). La Résistance intérieure (voir maquis), difficilement unifiée, avait d’autre part publié, le 15 mars 1944, une directive contenant le programme politique et économique de la Libération. L’opération Overlord du 6 juin 1944, l’arrivée de De Gaulle à Courseulles le 14, le débarquement de la 2e DB (division blindée) le 1er août et, du 19 au 24, la libération de Paris permirent l’installation effective du GPRF.
Sur le plan politique, trois problèmes se posèrent immédiatement : celui de la poursuite de la guerre (Royan ne fut libérée que par la reddition allemande du 8 mai 1945, et l’armée française rejoignit l’offensive alliée en Allemagne) ; celui de la transition entre l’État français (voir Vichy, gouvernement de) et la république réinstallée ; celui, enfin, du retour à la paix dans une France où les vainqueurs civils étaient des résistants armés et dotés, souvent, de solides et contradictoires espérances politiques.
Le problème militaire était posé moins par la stratégie que par l’organisation de l’armée qui devait amalgamer aux corps traditionnels comme la 2e DB, les groupes de résistants des Forces françaises de l’intérieur (FFI). En fait, 120 000 hommes, souvent jeunes, furent incorporés sans grandes difficultés.
Plus délicat fut le problème de la transition entre l’État français et la république. Plusieurs options étaient confrontées sur le terrain et au sommet de l’État. Les communistes, auréolés par leur rôle dans la Résistance, souhaitaient jouer les premiers rôles dans la vie politique, encouragés en cela par Moscou. Les socialistes et les démocrates centristes souhaitaient de nouvelles institutions laissant, comme au temps de la IIIe République, un primat au législatif. De Gaulle et ses alliés voulaient que les nouvelles institutions donnent, au contraire, une puissance nouvelle à l’exécutif. Le statut de Vichy faisait, lui aussi, débat : de Gaulle aurait souhaité avoir incarné une légitimité ininterrompue, ce qui faisait de Vichy une parenthèse illégale. Les anciens radicaux, les socialistes en majorité, impliqués nolens volens dans la prise du pouvoir par Pétain, en soulignaient, au contraire, la légalité. Ces débats posaient aussi le problème de l’épuration.
Dès la Libération, les résistants — souvent du « lendemain « — pratiquèrent une épuration sauvage. Au sommet se posait la question des responsables de haut niveau de la collaboration. Si les politiques les plus en vue (Laval, Pétain, Darnand) ainsi que les intellectuels collaborationnistes (Brasillach, Drieu La Rochelle, Lucien Rebatet) furent jugés ou au moins quelque peu inquiétés, et si des cours spéciales de justice furent instituées (26 juin 1944), la magistrature, les cadres de l’administration et de la police, les responsables industriels furent relativement épargnés. L’épuration sauvage, puis légale, fit au total à peu près 10 000 victimes ; mais, dans l’ensemble, on fit « payer les lampistes «, tandis que certains collaborateurs réels — de Touvier à Bousquet — demeuraient protégés par des réseaux politiques ou religieux. Pour de Gaulle, il s’agissait surtout de permettre, le plus vite possible, la remise en route de l’État. Dans les départements, des commissaires de la République et les comités de liaison assuraient tant bien que mal l’autorité du GPRF en se substituant aux préfets de l’État français.
Le 2 septembre 1944 se tenait à Paris le premier Conseil des ministres du GPRF. Le 5 octobre, une ordonnance du « ministère d’unanimité nationale « (présidé par de Gaulle, avec deux communistes, des socialistes, des anciens de la IIIe République) accordait le droit de vote aux femmes qui l’exercèrent dès le mois de mars 1945, lors des élections municipales. L’Assemblée consultative provisoire, créée à Alger puis transférée à Paris, céda la place le 21 octobre 1945 à une Assemblée constituante imposée par de Gaulle, élue à la proportionnelle et dominée par la gauche et le Mouvement républicain populaire (MRP), mouvement démocrate-chrétien issu de la Résistance. Communistes, socialistes de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) et MRP s’allièrent pour gouverner, Maurice Thorez devenant ministre d’État : le tripartisme devenait susceptible de contrebalancer l’autorité du général de Gaulle. La rupture entre celui-ci et le Gouvernement intervint assez vite : il démissionna le 20 janvier 1946.
Au lendemain du rejet par référendum d’un retour à la IIIe République, des institutions nouvelles furent rapidement créées : un premier projet constitutionnel soutenu par les socialistes et les communistes fut voté le 19 avril 1946 par l’Assemblée, mais rejeté par référendum le 5 mai ; le 2 juin, une nouvelle Assemblée fut élue dans laquelle radicaux et MRP étaient mieux représentés au détriment surtout des socialistes ; le 29 septembre, un nouveau projet était adopté par l’Assemblée, puis entériné par référendum le 13 octobre. Les premières élections législatives eurent lieu dès le 10 novembre. La Constitution venait, en fait, encadrer des institutions fondamentales que le GPRF instaura entre 1945 et 1946 : de l’École nationale d’administration (ENA) au Commissariat général au Plan, de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) à la Sécurité sociale, aux allocations familiales et aux caisses de retraite, l’activité créatrice fut remarquable et durable.
La IVe République fut d’abord un régime parlementaire bicamériste reposant sur le suffrage universel et le scrutin de liste. L’Assemblée nationale et le Conseil de la République, au pouvoir « consultatif «, votaient les lois et pouvaient censurer le gouvernement. Le président de la République, élu pour sept ans par les deux Assemblées, désignait le président du Conseil, lequel exerçait le pouvoir exécutif avec ses ministres et pouvait demander au président la dissolution de l’Assemblée. Un Conseil économique, élu par les syndicats et les organisations professionnelles (création du Conseil national du patronat français (CNPF) en 1946), gérait les questions sociales. Le président de la République présidait le Conseil supérieur de la magistrature et l’Assemblée de l’Union française dont la moitié était constituée de représentants de l’outre-mer. Au total, selon le mot de De Gaulle, le président « inaugurait les chrysanthèmes « et le président du Conseil était dépendant de majorités parlementaires que le scrutin proportionnel rendait singulièrement fluctuantes. En même temps, la Constitution garantissait, outre les droits de l’homme de 1789, des « droits économiques et sociaux « que contrôlait le Conseil économique : ainsi se lisaient dans la Constitution nouvelle l’héritage de la Résistance et celui de la IIIe République.
3 LA RECONSTRUCTION ET L'ESSOR ÉCONOMIQUE Outre les structures administratives et politiques déjà évoquées, le GPRF rénova les structures économiques. Les droits sociaux furent élargis (troisième semaine de congés payés, création des comités d’entreprise), les prix bloqués par ordonnances comme les loyers. Deux séries de nationalisations donnèrent à l’État le moyen de contrôler l’essentiel de l’appareil productif : de la fin 1944 à la mi-1945, Renault, la Banque de France, les Houillères du Nord, les sociétés de crédit, Air France ; en avril 1946, l’électricité, le gaz et les assurances. Si certaines nationalisations furent motivées par l’activité collaboratrice des responsables (Renault), elles s’inscrivaient, comme la création du Plan, dans une logique d’interventionnisme extrême de l’État. Pour les communistes, il s’agissait d’un possible moyen d’instaurer une économie de type socialiste ; pour les gaullistes et la gauche modérée, il s’agissait de mesures destinées à accélérer l’effort national de reconstruction.
L’effort national de reconstruction fit, au moins jusqu’en 1946, l’objet d’un consensus que relayèrent les appareils de propagande de tous les partis. Les résultats furent à la hauteur des sacrifices incontestables des Français. De Gaulle avait constaté, dans ses Mémoires de guerre de 1944 : « La marée, en se retirant, découvre donc, d’un bout à l’autre, le corps meurtri de la France. «. Trois fois plus de départements furent touchés par les destructions qu’en 1914-1918 ; Le Havre était rasé à plus de 80 p. 100 ; sur les 300 gares principales, seules 115 étaient en service pour un réseau tronçonné et amputé (18 000 km sur 40 000). Dès 1946, le redressement était effectif : les niveaux de productions de 1938 étaient retrouvés pour le charbon, l’électricité, le ciment, le trafic SNCF et à plus de 60 p. 100 pour l’acier et les engrais azotés, et dans les biens de consommation, pour la viande, le lait, les pommes de terre, le textile d’habillement.
Ces progrès remarquables furent lents à se faire sentir au niveau des conditions de vie : le rationnement fut maintenu jusqu’en 1949 (30 novembre : suppression du haut-commissariat au ravitaillement) pour certains produits ; l’indice du pouvoir d’achat passa de 100 en octobre 1944 à 71 en avril 1948 ; le franc s’effondrait et fut dévalué (avril 1949). Des mesures conservatoires de hausse des salaires ou de blocage des prix furent adoptées par les gouvernements successifs ; l’aide du plan Marshall fut un apport décisif au succès du plan Monnet de reconstruction et, à terme, à l’amélioration de la situation globale des Français.
L’aide américaine était constante depuis 1945, en nature puis en fonds (« aide intérimaire «). À partir d’avril 1948, la France bénéficia de l’aide Marshall distribuée jusqu’en janvier 1952. Elle reçut plus de 2,6 milliards de dollars, soit plus de 20 p. 100 du total : cette manne permit de résorber le déficit créé par la mise en place du plan. À partir des années cinquante, la mécanique de la croissance était lancée. De 100 en 1938, l’indice industriel passa à 213 en 1958 ; le trafic voyageurs SNCF doubla dans la même période.
La France se dirigea alors vers la société de consommation : le décollage des « Trente Glorieuses «, selon l’expression de Jean Fourastié (1975), peut s’illustrer par quelques remarquables réalisations comme, en automobile, la 2 CV Citroën et sa concurrente directe, la 4 CV Renault. Le retour au libéralisme en matière commerciale se fit progressivement, en particulier sous l’impulsion de Daniel Mayer ; il permit le développement des magasins à succursales et des supermarchés. Cette vague de croissance s’appuyait sur la lame de fond du baby-boom, commencé en fait dès 1943, mais qui fit culminer à plus de 2 p. 100 le taux de natalité au début des années cinquante. Chaque année, la France comptait 800 000 nouveau-nés supplémentaires.
4 LA NAISSANCE DE L'EUROPE COMMUNAUTAIRE Le plan Marshall et l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) chargée de la répartition de cette aide furent à la base de la création d’une Europe communautaire. Celle-ci reposait aussi sur une idée européenne antérieure au second conflit mondial que les partis démocrates-chrétiens relayèrent après la victoire alliée dans toute l’Europe. Le « discours de l’Horloge « de Robert Schuman (9 mai 1950) proposait la création d’une « haute autorité « supranationale pour la « mise en commun des productions de charbon et d’acier « comme première étape vers une « Europe organisée et vivante «. L’Allemagne fédérale, puis l’Italie et le Benelux cautionnèrent le projet, et le traité de Paris, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), fut signé en avril 1951 et ratifié par la France en décembre. Cette première étape, qui avait reçu le soutien des États-Unis et entraîné les protestations vigoureuses et inefficaces des communistes, fut suivie par la tentative de mettre en place une Communauté européenne de défense (CED). Signée par les gouvernements en juin 1952, la ratification en fut refusée par le Parlement français (communistes et gaullistes) le 30 août 1954. Après cet échec, la conférence de Messine de juin 1955 constitua un comité pour préparer une intégration économique de l’Europe sous la direction du Belge Paul Henri Spaak, avec l’appui déterminé de Jean Monnet. Les tensions internationales de 1956 (crise de Suez et révolution hongroise) montrèrent l’urgence de l’intégration européenne : le 25 mars 1957, les partenaires de la CECA créèrent deux autres communautés : la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). L’industrie lourde, l’énergie nucléaire, le commerce et l’agriculture comprise dans la CEE (politique agricole commune, PAC) étaient désormais placés sous le contrôle d’institutions supranationales : la Commission, instance de proposition et d’exécution ; le Conseil des ministres, instance de décision conditionnée par l’unanimité ; le Parlement composé d’élus nationaux, dont le rôle n’était que consultatif. Une Cour européenne de justice était également créée. Trois capitales furent choisies : Bruxelles (Commission et Conseil), Luxembourg (Cour de justice) et Strasbourg (Parlement).
Le traité de Rome (1957), qui ouvrait véritablement une ère géopolitique nouvelle pour la France, fut très rapidement suivi d’effets en matière commerciale et atomique ; la PAC fut définie précisément en 1962. Mais le succès de l’entreprise communautaire montrait la puissance d’initiative conservée par la France qui, par Jean Monnet et Robert Schumann, fut véritablement, avec l’Allemagne de Konrad Adenauer, la cheville ouvrière de la construction européenne.
5 LA SUCCESSION DES CRISES Les crises n’avaient pourtant jamais cessé, enchaînées les unes aux autres, fragilisant peu à peu le régime : crises politiques, crises économiques, crises diplomatiques et coloniales.
Les crises politiques furent le lot de toute la durée du régime. Récusée d’emblée par de Gaulle qui, après sa démission, formula lors du discours de Bayeux (16 juin 1946) ses critiques et ses propositions constitutionnelles, la IVe République fut donc confrontée à l’opposition gaulliste organisée entre 1948 et 1953 dans le Rassemblement du peuple français (RPF) qui obtint, aux législatives de 1951, 117 députés — soit le groupe le plus important.
Le second groupe était le groupe communiste, avec 103 députés ; or les communistes étaient, depuis 1947, entrés eux aussi dans une opposition sans faiblesse. Outre leur rôle avec les gaullistes dans le rejet de la CED, ils animèrent inlassablement les mouvements sociaux qui se multiplièrent à partir de 1947. Le mouvement syndical s’était désuni : Force ouvrière (FO), dirigée par Léon Jouhaux, s’en était séparée depuis avril 1948, tandis que la Confédération générale du travail (CGT) demeurait installée dans une ligne conforme à celle du Parti communiste. Un nouveau syndicat regroupa les enseignants, la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), dont la puissance et l’ancrage à gauche firent un interlocuteur redouté du ministère de l’Éducation nationale. À la différence de l’opposition gaulliste, l’opposition communiste s’intégrait dans une stratégie planétaire guidée par le Kominform à Moscou, dont Thorez et Jacques Duclos relayaient fidèlement les instructions. La guerre froide commandait largement les manifestations de l’opposition communiste.
Les alliances des partis du centre et de la gauche modérée, dont la représentation était bien moins importante, pouvaient seules assurer la stabilité gouvernementale. La « Troisième Force «, qui fournit l’essentiel des gouvernements jusqu’en septembre 1951, éclata sur la loi Barangé qui attribuait une allocation scolaire y compris aux enfants fréquentant les écoles privées. Le MRP se rapprocha alors des modérés, puis d’une fraction des députés du RPF (dissout par de Gaulle en mai 1953), pour obtenir l’investiture du modéré Antoine Pinay. Celui-ci, « l’homme au chapeau rond «, lança un emprunt dont le succès fut immense et put vaincre l’inflation. Son prestige, au-delà de sa chute sur les questions coloniales en décembre 1952, resta très important.
Son investiture avait montré que, malgré la croissance, l’économie française restait fragile, menacée en particulier par la fragilité du franc qui déclenchait des vagues d’inflation dramatiques. Pour tenter d’en juguler les effets, un salaire-plancher fut établi, le SMIG, alors que se multipliaient les grèves dans l’industrie et la fonction publique, grèves dures et souvent longues : les enseignants avaient ainsi lutté un mois durant contre la loi Barangé. L’instabilité se poursuivit ainsi jusqu’à la chute du régime. Au total, une vingtaine de gouvernements se succédèrent ; le gouvernement du Front républicain de Guy Mollet tint seize mois jusqu’en mai 1957 ; mais la moyenne fut de moins de neuf mois et plusieurs gouvernements durèrent à peine quelques semaines. En 1953, il fallut treize tours de scrutin pour que le Congrès choisisse le président de la République appelé à succéder à Vincent Auriol, René Coty — un président sans pouvoirs.
Les crises diplomatiques et coloniales s’ajoutant aux problèmes politiques et sociaux finirent par avoir raison du régime. Sur le plan diplomatique, de Gaulle était parvenu à faire admettre la France dans le camp des vainqueurs et une zone d’occupation française fut découpée en Allemagne. Par ailleurs, un siège permanent était accordé à la France au Conseil de sécurité de l’ONU, créée en juillet 1945. Mais l’aide Marshall aggrava la dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui firent sans difficulté entrer les Français dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ; l’opposition communiste fut constante à cette occupation, rejoignant parfois la majorité comme au moment de la CED ou à propos des époux Rosenberg. Si le traité de Rome reçut l’assentiment des États-Unis peu auparavant, la crise de Suez avait confirmé l’impuissance française en dehors de cet assentiment : le colonel Nasser ayant fermé le canal de Suez, Français et Britanniques intervinrent pour rétablir le passage et durent se replier sur l’injonction commune des Américains et des Soviétiques (novembre 1956). Il s’agissait, en effet, à la fois de pétrole et de stratégie : ce n’était plus le domaine des vieilles puissances coloniales.
Les questions coloniales furent permanentes au long de la période. En effet, l’indépendantisme s’était propagé chez les populations soumises, d’abord dans les élites, puis plus largement dans l’ensemble de la population. De Gaulle lui-même avait promis, pendant la guerre, de revoir le statut des peuples de l’Empire colonial français (discours de Brazzaville, 30 janvier 1944). En 1943, l’Algérie, fleuron de l’Empire, formulait officiellement sa revendication à plus d’autonomie avec le manifeste de Ferhat Abbas.
Ce fut en Indochine que commencèrent les vrais conflits coloniaux : malgré les accords signés, la France refusa de reconnaître l’indépendance du Viêt Nam implicite dans l’accord Sainteny-Hô Chí Minh du 6 mars 1946. Les massacres de Haiphong en novembre rendirent la guerre d’Indochine inéluctable. En 1949, l’armée du Viêt-minh reçut l’appui massif de la Chine, nouvellement communiste, et de l’URSS ; l’armée française (corps expéditionnaire de métier) se laissa encercler en novembre 1953 à Diên Biên Phu et se rendit le 7 mai 1954. Le traumatisme fut considérable en France et permit l’accession au pouvoir de Pierre Mendès France qui signa les accords de Genève en juillet : le Cambodge et le Laos devenaient indépendants, le Viêt Nam était divisé au 17e parallèle, le Nord au Viêt-minh de « l’oncle Ho «, le Sud aux nationalistes.
Mendès France eut immédiatement à affronter d’autres mouvements insurrectionnels dans l’Empire. En Tunisie, où le parti de Bourguiba, le Néo-Destour, était en lutte depuis 1951, Mendès choisit la négociation et accorda l’autonomie interne. Au Maroc, le mouvement indépendantiste fut fondé en décembre 1953 et avait l’appui du sultan de ce protectorat, Mohammed ben Youssef. Le soulèvement commença en décembre 1952 ; le général Guillaume détrôna et exila Mohammed, ce qui accrut les troubles. Edgar Faure, alors président du Conseil, fit rentrer Mohammed le 16 novembre 1955 et l’indépendance fut accordée le 2 mars 1956, statut qui fut également accordé à la Tunisie le 20 mars.
La même année, Gaston Defferre avait fait voter une loi-cadre (26 juillet) pour éviter qu’en Afrique noire ne se reproduisent ces problèmes ; d’autant que l’île de Madagascar, qui s’était révoltée en 1947, n’avait été soumise que par une répression implacable (plusieurs dizaines de milliers de morts). Par la mise en place d’administrations indigènes élues, la loi-cadre assurait une transition vers l’indépendance.
6 LA CRISE FINALE : LES « ÉVÉNEMENTS « D'ALGÉRIE Le problème algérien fut beaucoup plus grave. En effet, l’Algérie, peuplée par une minorité de 3 millions d’Européens, les pieds-noirs, divisée en départements et envoyant des élus au Parlement de la République, « c’était la France « aux yeux d’une large partie de l’opinion. Mais le modérantisme de Ferhat Abbas se trouva discrédité par la répression très dure qui suivit les émeutes de 1945 dans le Constantinois. Messali Hadj, fondateur du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), fut à son tour considéré comme timoré par les fondateurs, en 1954, du Front de libération nationale (FLN). La lutte fut engagée le 1er novembre 1954 par une série d’attentats. Mendès France et François Mitterrand, son ministre de l’Intérieur, choisirent immédiatement la répression la plus sévère. Devant l’ampleur croissante de la rébellion, en janvier 1956, Guy Mollet décida de satisfaire les exigences des Européens et d’envoyer en Algérie le contingent. Les Français commencèrent une campagne militaire et policière entachée d’excès en tous genres ; le FLN fut progressivement repoussé à partir de 1957 dans les campagnes et dans les régions frontalières de Tunisie. L’armée française vint les bombarder en avril 1958 à Sakiet. Cet incident, dont l’écho fut porté sur la scène internationale par les médias, entraîna une nouvelle escalade de la violence et des revendications : au FLN s’opposaient nettement les pieds-noirs et une armée française soucieuse aussi de laver l’échec indochinois et l’humiliation de Suez. Le 13 mai, craignant d’être abandonnés par le nouveau gouvernement Pflimlin, les Français d’Algérie se soulevèrent avec l’appui d’une partie de l’armée (voir Mai 1958, crise du 13). Le président René Coty fit alors appel au général de Gaulle, officiellement retiré des affaires depuis 1953. Il fut investi des pleins pouvoirs le 1er juin 1958 avec mission de préparer une nouvelle constitution. Un voyage triomphal à Alger (« Je vous ai compris ! «) le 4 juin apaisa dans l’immédiat les tensions. Le 28 septembre, quatre électeurs sur cinq approuvaient la nouvelle constitution : la IVe République avait vécu. (voir Algérie, guerre d’).
Moins qu’à des institutions somme toute démocratiques, moins qu’à un personnel politique somme toute durable, moins qu’à la seule crise algérienne, la IVe République avait dû sa chute au choc d’une conception nationale de la politique confrontée à l’échelle planétaire désormais seule valide : la guerre froide, la décolonisation, la pression économique liée à l’expansion des Trente Glorieuses posaient aux institutions et aux politiques des questions d’ampleur nouvelle que la IVe République permit de mieux connaître, voire de mieux maîtriser. Le retour de De Gaulle, incarnation d’un passé glorieux, portait aussi une nouvelle conception de l’État au pouvoir, un État dont la raison, supérieure aux contradictions d’une opinion publique toujours bigarrée, saurait s’imposer.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- République (IVe).
- Le Nigeria, République fédérale, pays le plus peuplé et le plus puissant d'Afrique occidentale, est l'héritier de brillantes civilisations, échelonnées du IVe au XIXe siècle : cités-États yorubas, royaumes haoussas, ibos, du Bénin.
- La valse des gouvernements sous la IVe République
- Question 210: Quelle fonction ministérielle Georges PoMPIDOU (1911-1974) a-t-il occupée sous la IVe République: A.
- « [...] Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison [...] » Platon, République, ive s. av. J.-C. Commentez.