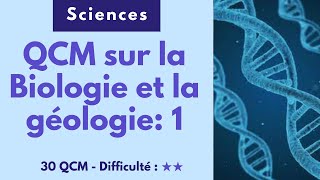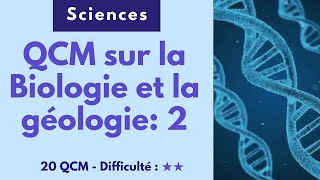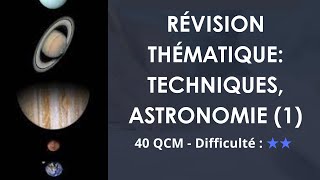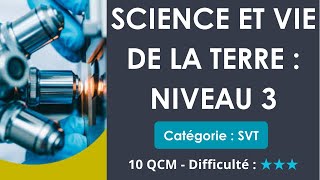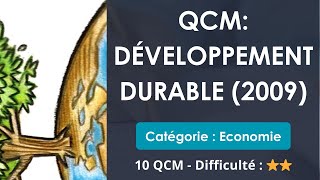OCÉANOGRAPHIE NAVIGATEURS ET EXPLORATEURS Les origines de l'océanographie se perdent dans le dense réseau de relations commerciales et de communications que les civilisations de la région méditerranéenne ont commencé à tisser dès les époques les plus reculées.
Publié le 04/04/2015

Extrait du document
«
2
des grandes explorations océaniques.
D'un certain point de vue, le bateau lui-
même était un instrument de mesure pour l’explorateur car il subissait l'effet des
courants océaniques au sein desquels il se trouvait.
Mais les premiers navigateurs,
tout en reconnaissant l'effet et l'importance de ces forts courants, ne pouvaient pas
en mesurer la vitesse ou la direction exacte.
Sans chronomètres précis pour
mesurer la longitude, dont l'utilisation ne devait devenir régulière qu'au XIX esiècle,
ils ne pouvaient estimer leur position qu'en se fondant sur celle du Soleil, c'est-à-
dire en mesurant uniquement la latitude et en obtenant ainsi une idée
nécessairement approximative de leur position et de la distance parcourue.
Mais la
dérive produite par les grands courants océaniques était évidente.
Le grand courant
nord-équatorial qui va de l'Afrique vers les Amériques fut identifié et signalé par
Christophe Colomb au cours de son troisième voyage.
À la même époque, les
navigateurs portugais découvraient et cherchaient à exploiter le courant des
Aiguilles en Afrique orientale.
Dans le Pacifique, l'existence de la Kuroshio, un
courant qui porte au nord puis au nord-est le long des côtes du Japon et de la
Sibérie jusqu'en Amérique du Nord, était déjà connue par les pilotes espagnols qui
guidaient les galions qui assuraient les liaisons entre la colonie des Philippines et le
Mexique.
Les courants influaient sur les routes prises par les navires de façon
déterminante.
Par exemple, le « galion de Manille », qui reliait la capitale Manille au
Mexique espagnol chaque année, suivait des routes radicalement différentes à
l'aller et au retour.
À l'aller, vers Manille, il suivait la route équatoriale, en cherchant
à exploiter le courant pacifique nord-équatorial, qui va vers l'Asie, mais au retour il
cherchait à suivre la Kuroshio, et donc remontait très au nord, le long des côtes de
la Sibérie puis redescendait toute l'Amérique du Nord et rejoignait le Mexique.
Si on
survivait aux tempêtes, aux maladies et aux erreurs de direction, l’aller-retour durait
deux ans.
De la même façon, le parcours le plus rapide entre l'Europe et l'Afrique
méridionale ne consistait pas à suivre les côtes africaines, où les vents et les
courants se meuvent en sens contraire, mais à traverser l'Atlantique vers le Brésil et
à descendre le long des côtes argentines, jusqu'à rencontrer le courant
Circumpolaire antarctique, qui décrit un grand anneau autour du continent
antarctique et qui promet un passage rapide (parfois même trop) vers le Cap de
Bonne-Espérance.
LES ORIGINES DE L'OCÉANOGRAPHIE MODERNE
Pendant de nombreux siècles, les informations recueillies dans les portulans
représentèrent l'ensemble des connaissances disponibles dans ce que l'on appelle
actuellement océanographie.
Mais on peut faire remonter l’origine de la science
océanographique aux trois grands voyages du capitaine James Cook, accomplis
dans le Pacifique entre 1768 et 1779.
Lors de ces voyages, les navires de Cook
avaient à bord des chronomètres qui permettaient de calculer avec une grande
précision la longitude et donc la position des navires.
La connaissance de la
position géographique exacte, en outre, permettait l'estimation de l'effet de dérive
des courants.
La publication du compte rendu du voyage de Cook dans les années
suivantes contribua fortement à élargir l'horizon culturel européen et à diffuser la
connaissance des dimensions réelles des océans.
Au cours des années suivantes,
les principales nations européennes de l'époque organisèrent des voyages
d'exploration des océans.
Napoléon I er envoya deux navires, Le Géographe et Le
Naturaliste , qui s'unirent aux nombreuses expéditions russes, danoises et
britanniques.
Les savants embarqués n'étaient souvent que des médecins et par.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RER (Réseau express régional), réseau de transport ferroviaire de masse, partiellement aérien et partiellement souterrain, au sein de la région parisienne.
- Nietzsche; Le Gai Savoir, 1881: La conscience n'est qu'un réseau de communications
- NIETZSCHE : La conscience comme « Réseau de communications » (commentaire)
- mégalopole 1 PRÉSENTATION mégalopole, vaste région urbanisée regroupant des villes de tailles différentes et entretenant entre elles d'étroites relations, essentiellement économiques et financières, mais également sociales ou culturelles.
- Nietzsche: La conscience n'est qu'un réseau de communications