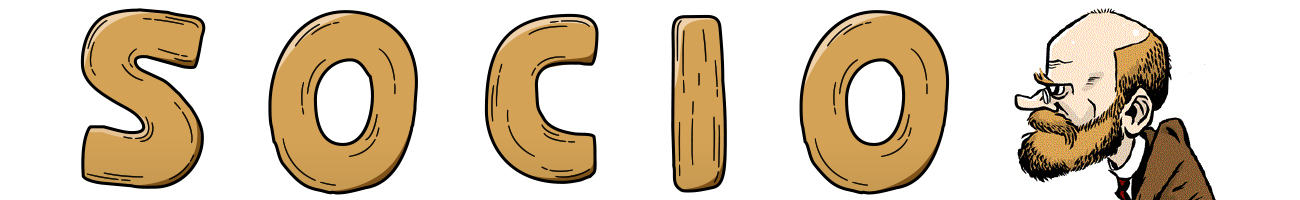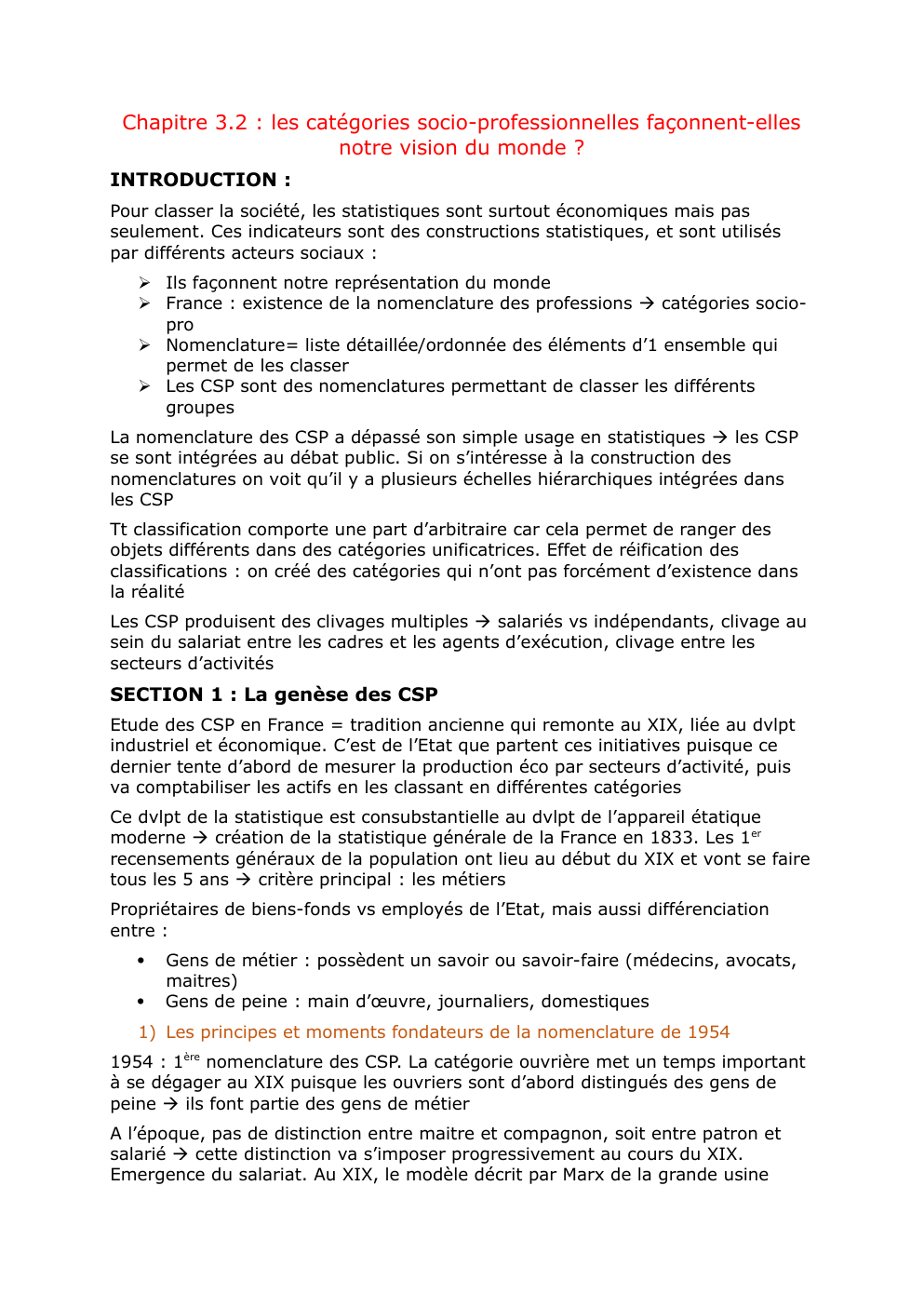Chapitre 3.2 : les catégories socio-professionnelles façonnent-elles notre vision du monde ?
Publié le 05/04/2025
Extrait du document
«
Chapitre 3.2 : les catégories socio-professionnelles façonnent-elles
notre vision du monde ?
INTRODUCTION :
Pour classer la société, les statistiques sont surtout économiques mais pas
seulement.
Ces indicateurs sont des constructions statistiques, et sont utilisés
par différents acteurs sociaux :
Ils façonnent notre représentation du monde
France : existence de la nomenclature des professions catégories sociopro
Nomenclature= liste détaillée/ordonnée des éléments d’1 ensemble qui
permet de les classer
Les CSP sont des nomenclatures permettant de classer les différents
groupes
La nomenclature des CSP a dépassé son simple usage en statistiques les CSP
se sont intégrées au débat public.
Si on s’intéresse à la construction des
nomenclatures on voit qu’il y a plusieurs échelles hiérarchiques intégrées dans
les CSP
Tt classification comporte une part d’arbitraire car cela permet de ranger des
objets différents dans des catégories unificatrices.
Effet de réification des
classifications : on créé des catégories qui n’ont pas forcément d’existence dans
la réalité
Les CSP produisent des clivages multiples salariés vs indépendants, clivage au
sein du salariat entre les cadres et les agents d’exécution, clivage entre les
secteurs d’activités
SECTION 1 : La genèse des CSP
Etude des CSP en France = tradition ancienne qui remonte au XIX, liée au dvlpt
industriel et économique.
C’est de l’Etat que partent ces initiatives puisque ce
dernier tente d’abord de mesurer la production éco par secteurs d’activité, puis
va comptabiliser les actifs en les classant en différentes catégories
Ce dvlpt de la statistique est consubstantielle au dvlpt de l’appareil étatique
moderne création de la statistique générale de la France en 1833.
Les 1er
recensements généraux de la population ont lieu au début du XIX et vont se faire
tous les 5 ans critère principal : les métiers
Propriétaires de biens-fonds vs employés de l’Etat, mais aussi différenciation
entre :
Gens de métier : possèdent un savoir ou savoir-faire (médecins, avocats,
maitres)
Gens de peine : main d’œuvre, journaliers, domestiques
1) Les principes et moments fondateurs de la nomenclature de 1954
1954 : 1ère nomenclature des CSP.
La catégorie ouvrière met un temps important
à se dégager au XIX puisque les ouvriers sont d’abord distingués des gens de
peine ils font partie des gens de métier
A l’époque, pas de distinction entre maitre et compagnon, soit entre patron et
salarié cette distinction va s’imposer progressivement au cours du XIX.
Emergence du salariat.
Au XIX, le modèle décrit par Marx de la grande usine
industrielle dans laquelle les ouvriers obéissaient au patron existait mais n’était
pas la forme socio-éco
La petite production était encore très importante
Tt au long du XIX, dvlpt de l’industrialisation
Les grandes entreprises vont se substituer aux petites entreprises.
Distinction patron/ouvriers est le produit du dvlpt du droit du travail à la
fin du XIX
1936-1950 : salariat codifié à travers des grilles d’emplois hiérarchisées dvlpt
du salariat, càd que celui-ci va être reconnu dans le droit et va devenir un
élément structurant de la vie pro
C’est à travers la reconnaissance du salariat qu’on va se mettre à différencier des
catégories considère qu’il existe 1 hiérarchie au sein du salariat et qu’il n’y a
pas seulement patron vs salarié
Cette reconnaissance des différences au sein du salariat nait de la distinction
entre ouvriers qualifiés et spécialisés.
1936 : négociation nationale réunie autour
de Blum pour discuter des salaires
Mvt d’unification et de standardisation de la codification du travail ouvrier
On va essayer d’uniformiser les catégories du salariat au niveau national
Industrie métallurgique qui joue un rôle majeur
Automobile : 1ère forme de taylorisation (division du travail ouvriers
qualifiés/spécialisés)
Début d’une règlementation et d’une taylorisation différenciation entre les
gens de métiers et les gens de peine.
Cette distinction ouvriers
qualifiés/spécialisés va se généraliser avec les accords de Matignon
Processus de codification des relations de travail à travers des conventions
collectives : on élabore des catégories d’emplois et de niveaux de qualification
qui vont être valable pour toutes les branches
A l’époque, cela restait inégaux car les syndicats patronaux et les ouvriers
n’étaient pas présents avec la même force partout : l’existence de catégories
reconnues officiellement dépend d’un travail de représentation
Cette codification va s’accélérer à l’après-guerre Alexandre Parodi.
En plus de
la différenciation entre les ouvriers, on différencie aussi les employés et les
cadres :
Impression qu’ils ont été laissés de côté lors des accords de Matignon
Dvlpt d’une nouvelle organisation syndicale qui cherche à représenter
cette catégorie
1946 : élaboration d’une statut général de la fonction publique qui
hiérarchise les employés
L’Etat joue un rôle essentiel dans la définition des statuts socio-pro en France :
c’est celui qui produit les statistiques sociales, le régulateur des relations sociales
et l’instance qui légitime les qualifications l’Etat détermine le cadre légal de
leur existence
Années 30 et 50 : période décisive dans la mise en place des modèles de
classement des salariés mais l’idée de métier remonte aux premiers
recensements généraux (Corporations professionnelles)
L’INSEE a été créée en 1946 en remplacement du service national des
statistiques.
1954 : l’INSEE produit une nomenclature des catégories pro en
introduisant dans les recensements une question sur l’appartenance ou non à ces
CSP
Cette grille va être utilisée pendant une trentaine d’années jusqu’à une nouvelle
en 1982 qui se base sur les mêmes principes.
Cette nomenclature est utilisée
partout, dans la plupart des recherches statistiques
1er groupe qui se divise en 8 groupes socio-pro
Chaque groupe se divise lui-même en catégories
6 groupes qui se détachent : agri, patrons, cadres supérieurs/moyens,
employés, ouvriers
Les statisticiens ont considéré qu’il fallait lier le statut social au statut
professionnel : derrière une profession, il y a une certaine homogénéité sociale
la classification doit faire apparaitre els différences de situation, de
comportement et d’aptitude
Au sein de cette nomenclature, on distingue les salariés des indépendants.
On
différencie aussi le fait de travailler dans une grande ou petite structure, et on
prend en compte le secteur (public/privé)
Cette nomenclature propose des clivages multidimensionnels : on ne peut pas
vrmt mettre d’emblée les 8 groupes de base dans une perspective hiérarchique
car il y a des clivages de nature différente pas de hiérarchie linéaire entre ces
CSP
Plusieurs critères identifiés pour représenter une certaine homogénéité sociale :
Profession et statut : opposition entre salarié et non salarié permet de
distinguer les professions libérales et les cadres.
Niveau de qualification : à une profession correspond un certain niveau
d’instruction critère problématique car il y a bcp d’emplois qui ne
correspondent pas forcément à la qualification correspondante : certaines
personnes peuvent bénéficier d’1 promotion interne
Position dans la division du travail
La taille de l’entreprise
2) La réforme de 1982 : des CSP aux PCS
A)Les motifs de la réforme
En 1982, on réforme cette nomenclature de 1954 on passe des CSP aux PCS.
On a modifié car les statisticiens cherchent à faire évoluer la nomenclature aux
grandes transformations de la société actuelle.
Ces changements s’expliquent aussi par les critiques à l’encontre de la
nomenclature de 1954.
Les transformations de la structure de la population
française ont poussé les statisticiens à rendre compte de celles-ci.
B)Les principaux changements
Catégorie des agriculteurs : On avait dans la nomenclature de 54 une seule
catégorie les salariés agricoles.
Cpdt, ce groupe diminue et on va différencier
les agriculteurs salariés ou exploitants en 1982.
On différencie les agri
exploitants en fonction de la taille de l’exploitation
Catégorie des gens de service : devient obsolète car à partir des années 80,
diminution de ce groupe ajd, les femmes de ménages sont inclues dans le
groupes des employés.
En 1982, il n’y a plus que 6 groupes socio-professionnels
On ajoute 2 catégories 7 : retraités, 8 : inactifs
On supprime la catégorie 8 et on les répartit selon la position hiérarchique
Années 80 : nomenclature critiquée et certains se demandaient si elle n’était pas
déjà obsolète.
Emergence du secteur associatif qui pourrait se rapprocher du
secteur public
Autre phénomène massif : chômage et précarité changements assez
importants dans la trajectoire professionnelle des individus
Cette nomenclature est aussi critiquée car certains disent que la profession a une
emprise sociologique de moins en moins importante sur les identités sociales des
individus (Lahire) Distinction identité pro/identité sociologique
Critique : on serait face à d’autres principes de différenciation : les CSP
permettent de définir des classes en soi mais pas pour soi la stratification
raciale viendrait supplanter la stratification sociale : débats sur les statistiques
ethniques.
C)Quelques critiques
Question des statistiques ethniques : objet de bcp de controverses
invisibilisation totale de cette question.
Enquêtes de l’INSEE :
On demande aux personnes leur origine géographique et celle de leurs
parents
Depuis les 90s, l’introduction de questions sur l’origine des parents se
généralise
Grâce à ces enquêtes, on croise l’origine de la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HÔLDERLIN. Vision du monde et religiosité Romano Guardini
- Personnages et vision du monde
- > Notre vision du monde doit-elle quelque chose au langage ?
- CHAPITRE II Roulé en boule sur son couvre-pieds, Fouquet attend que le monde prenne l'affaire en main.
- Chapitre XXXIV Un enfant demandera : « Pourquoi y a-t-il un monde ?