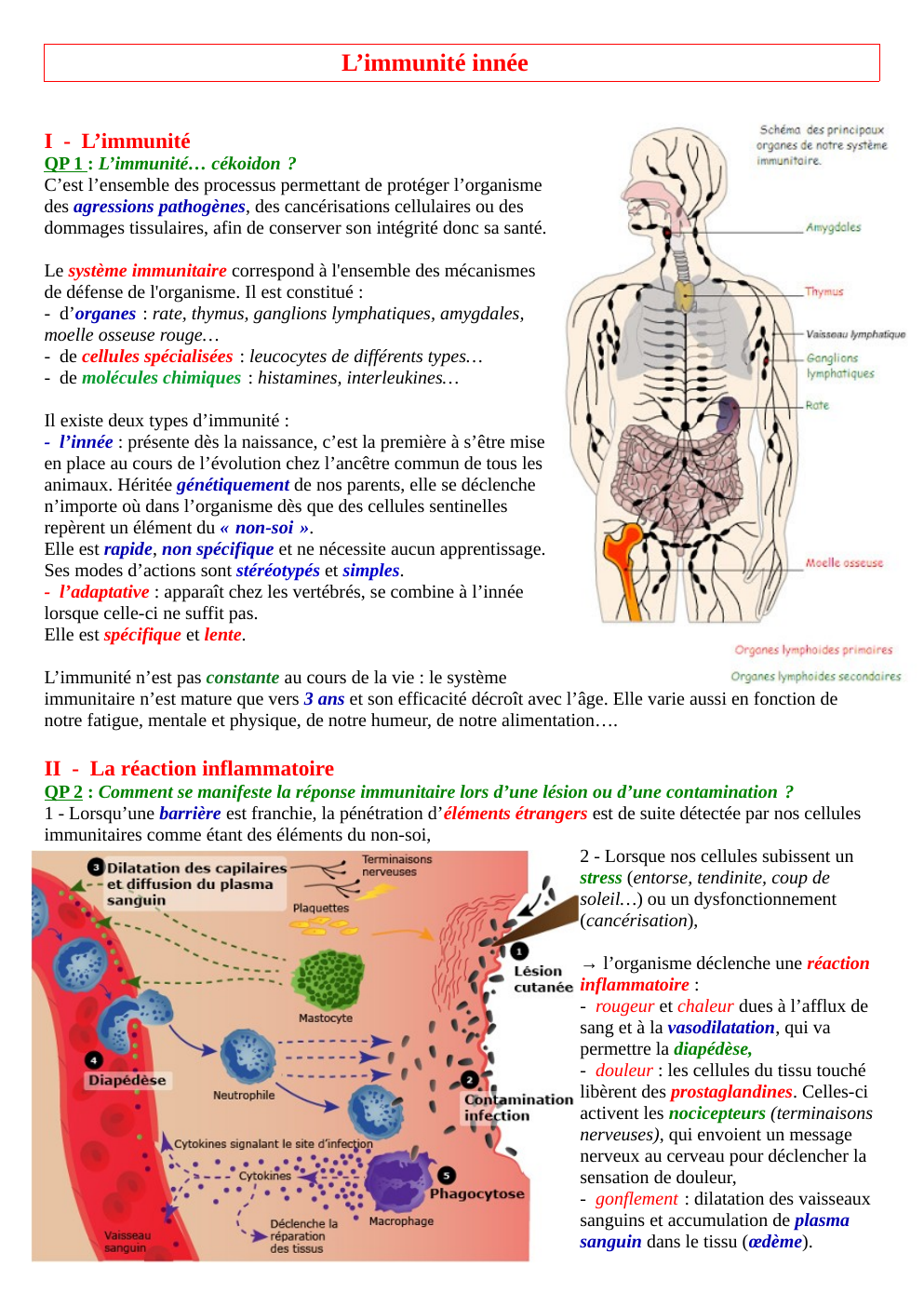Cours SVT: L’immunité innée
Publié le 28/02/2025
Extrait du document
«
L’immunité innée
I - L’immunité
QP 1 : L’immunité… cékoidon ?
C’est l’ensemble des processus permettant de protéger l’organisme
des agressions pathogènes, des cancérisations cellulaires ou des
dommages tissulaires, afin de conserver son intégrité donc sa santé.
Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes
de défense de l'organisme.
Il est constitué :
- d’organes : rate, thymus, ganglions lymphatiques, amygdales,
moelle osseuse rouge…
- de cellules spécialisées : leucocytes de différents types…
- de molécules chimiques : histamines, interleukines…
Il existe deux types d’immunité :
- l’innée : présente dès la naissance, c’est la première à s’être mise
en place au cours de l’évolution chez l’ancêtre commun de tous les
animaux.
Héritée génétiquement de nos parents, elle se déclenche
n’importe où dans l’organisme dès que des cellules sentinelles
repèrent un élément du « non-soi ».
Elle est rapide, non spécifique et ne nécessite aucun apprentissage.
Ses modes d’actions sont stéréotypés et simples.
- l’adaptative : apparaît chez les vertébrés, se combine à l’innée
lorsque celle-ci ne suffit pas.
Elle est spécifique et lente.
L’immunité n’est pas constante au cours de la vie : le système
immunitaire n’est mature que vers 3 ans et son efficacité décroît avec l’âge.
Elle varie aussi en fonction de
notre fatigue, mentale et physique, de notre humeur, de notre alimentation….
II - La réaction inflammatoire
QP 2 : Comment se manifeste la réponse immunitaire lors d’une lésion ou d’une contamination ?
1 - Lorsqu’une barrière est franchie, la pénétration d’éléments étrangers est de suite détectée par nos cellules
immunitaires comme étant des éléments du non-soi,
2 - Lorsque nos cellules subissent un
stress (entorse, tendinite, coup de
soleil…) ou un dysfonctionnement
(cancérisation),
→ l’organisme déclenche une réaction
inflammatoire :
- rougeur et chaleur dues à l’afflux de
sang et à la vasodilatation, qui va
permettre la diapédèse,
- douleur : les cellules du tissu touché
libèrent des prostaglandines.
Celles-ci
activent les nocicepteurs (terminaisons
nerveuses), qui envoient un message
nerveux au cerveau pour déclencher la
sensation de douleur,
- gonflement : dilatation des vaisseaux
sanguins et accumulation de plasma
sanguin dans le tissu (œdème).
QP 3 : Comment le système immunitaire détecte le « non-soi » ?
Les p’tites histoires de Mme Dubuc…
En 1958, le Professeur
Jean Dausset révèle
l’existence au niveau des
membranes cellulaires du
CMH, issu du
système HLA.
Cette découverte lui
permettra d’obtenir le prix
Nobel de Médecine en 1980,
« pour la découverte sur les
structures génétiquement
déterminées sur la surface
d'une cellule et régulatrices
des réactions
immunologiques ».
Le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) correspond à
un groupe d’antigènes initialement identifiés comme jouant un
rôle primordial dans les processus de rejet de greffe, et pour
lesquels la compatibilité entre donneur et receveur permettait de
prolonger la survie de la greffe.
Chez l’homme, les protéines du CMH sont codées par le système
HLA (Human Leucocyte Antigen).
Ces gènes regroupés sont sur
le bras court du chromosome 6.
Le CMH est comme une « carte d’identité » située à la surface de
toutes nos cellules.
Elle permet la reconnaissance du soi (nos
cellules, nos tissus, nos organes) et celle du non-soi (micro-organisme étranger, corps étranger, greffon…).
QP 4 : Quelles cellules sont présentes au niveau de l’inflammation ?
Les leucocytes sont présents dans tout l’organisme.
Il y a :
- les cellules sentinelles qui résident dans les tissus :
cellules dendritiques, mastocytes et macrophages,
- les granulocytes et monocytes, circulent dans le sang et sont recrutés sur le site de l’inflammation.
III - La réaction immunitaire
QP 5 : Comment sont reconnus les agents pathogènes ?
La membrane des cellules immunitaires possède des récepteurs de surface capables de reconnaître les motifs
moléculaires communs de la paroi cellulaire de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓