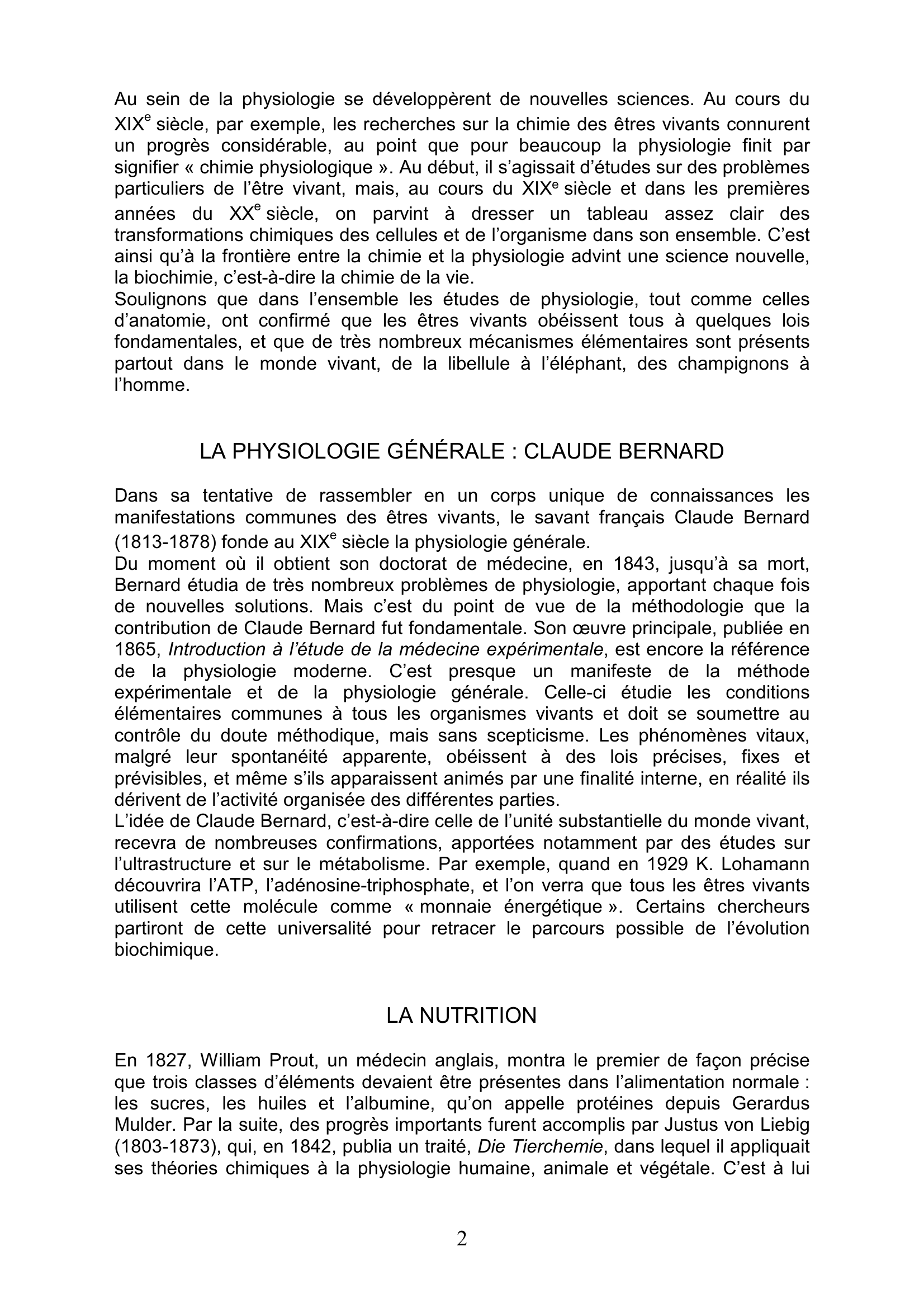HISTOIRE DE LA PHYSIOLOGIE
Publié le 02/05/2019

Extrait du document

En 1889, Charles-Edouard Brown-Séquard (1817-1894) reprit cette idée et injecta du tissu testiculaire à différentes personnes, confirmant les résultats précédents et soulignant que cela avait la surprenante capacité de soigner les dommages causés par le vieillissement. Vers la fin du siècle, Joseph von Merign (1849-1908) et Oskar Minkovsky (1858-1931) démontrèrent que la résection du pancréas chez l’animal causait une brusque augmentation du sucre dans le sang, ce qui laissait à penser que cet organe produisait une substance ayant l’effet opposé.
Toutes ces observations laissaient à penser que certains organes du corps produisaient une substance qui exerçait des effets sur le reste du corps, même sur des parties éloignées. On en eut une première confirmation en 1895, quand certains physiologistes découvrirent qu’un extrait des surrénales injecté chez la souris augmentait sa pression sanguine. Le chimiste japonais Jokichi Takamine (1854-1922) identifia en 1901 la substance responsable de ce phénomène et l’appela adrénaline. C’était la première fois que l’on isolait une hormone.
Ce terme, dérivé d’un mot grec qui signifie « exciter », fut utilisé pour la première fois en 1905 par deux physiologistes anglais, William M. Bayliss (1860-1924) et Ernest H. Starling (1866-1978) pour définir la sécrétine, une substance produite par l’intestin et qui induisait le pancréas à produire des sucs digestifs. La section des nerfs qui arrivaient au pancréas ne bloquait pas la production hormonale de cet organe et Bayliss et Starling en déduisirent qu’il devait exister un messager chimique, qu’ils identifièrent dans la sécrétine. Une fois introduit le concept d’hormone comme messager chimique, Bayliss démontra que d’autres glandes endocrines produisaient également des hormones. Des résultats importants à ce sujet furent obtenus par Edward C. Kendall (1886-1972) qui, le jour de Noël 1914, isola la thyroxine, l’hormone de la thyroïde. En 1921, Frederick G. Banting (1891-1941) et Charles H. Best (1899-1978) identifièrent l’insuline. Mais les recherches de physiologie avaient démontré qu’une même hormone ne remplissait pas toujours les mêmes fonctions dans tous les organismes. Entre 1912 et 1918, par exemple, on découvrit que l’hormone thyroïdienne commandait la métamorphose des têtards de grenouilles.
Dans les années 30, on découvrit que les plantes elles aussi produisent des substances ayant des fonctions d’hormones. En 1933 et en 1934, par exemple, on identifia respectivement les auxines et les gibbérellines, hormones régulatrices de la croissance. Grâce à d’autres découvertes de ce genre, on parvint à comprendre que les hormones végétales jouent un rôle fondamental dans la vie des plantes parce qu’elles représentent le seul système de communication entre les racines, le tronc et les feuilles, et par conséquent le seul système de régulation des fonctions, de la croissance à la floraison, du mouvement du tronc et des feuilles à la chute de ces dernières.
Les recherches en endocrinologie n’ont pas connu de répit ces dernières décennies, le nombre des hormones connues n’a fait qu’augmenter et on a beaucoup étudié leurs effets et les mécanismes selon lesquels elles agissent. Il apparaît que, chez les animaux, le système endocrinien établit, en plus du système nerveux, une autre voie de liaison et de communication entre des parties éloignées du corps. Le système nerveux transporte le message de façon rapide et spécifique, c’est-à-dire sur des cibles précises, tandis que les hormones le font de façon lente et aspécifique, c’est-à-dire sur plusieurs cibles. Enfin, on a compris que de nombreuses hormones n’agissent qu’après avoir été liées à des points spécifiques, les récepteurs, qui se trouvent à la surface de la membrane plasmique des cellules ou à l’intérieur de ces dernières.
L’IMMUNOLOGIE
En 1882, Elie Metchnikov, zoologiste russe, avait découvert que l’organisme vivant possède un mécanisme de défense contre les microbes. En présence de ces agents pathogènes, sont mobilisées des cellules capables de les manger et de les détruire, que Metchnikov appela phagocytes. Par la suite, on découvrit que dans certaines circonstances déterminées ces cellules n’étaient pas indispensables, car le sérum, la part du sang dépourvue de cellules et qui ne se coagule pas, était en mesure de neutraliser tout seul des substances toxiques comme les toxines bactériennes. Selon les résultats obtenus par Paul Ehrlich (1854-1915), cela se produisait en particulier grâce à la production d’antitoxines circulant dans le sang et présentes également dans le sérum.
Cela donna lieu à une vive discussion entre ceux qui soutenaient que, dans les défenses immunitaires, le rôle central était joué par des cellules, et ceux qui soulignaient l’importance des antitoxines, conceptions auxquelles on donna respectivement les noms de théorie cellulaire et de théorie humorale de l’immunité. La controverse fut résolue par la démonstration que l’une et l’autre jouaient un rôle dans la défense de l’organisme.
Quoi qu’il en soit, il restait encore à comprendre comment les antitoxines parvenaient à réagir de façon spécifique à une substance particulière, et comment ce mécanisme de défense pouvait être assez souple pour défendre l’organisme face aux nombreuses agressions présentes dans le milieu. Au début du siècle, Paul Ehrlich formula l’hypothèse que le contact avec la toxine (l’antigène) déterminait la production de l’antitoxine correspondante (l’anticorps), grâce à des mécanismes qui intéressaient la surface de la cellule. Selon cette hypothèse, l’anticorps préexistait à la rencontre avec l’antigène, et cela laissait ouvert l’énigme du grand nombre de réactions spécifiques, c’est-à-dire d’anticorps préexistants. Dans les premières décennies du XXe siècle, on commença à penser que les anticorps étaient totipotents, c’est-à-dire tous identiques et capables de réagir immunologiquement à n’importe quel antigène, mais en 1940, Linus Pauling (1901) avança une explication tout à fait différente, qui eut beaucoup de succès durant les années suivantes. Pauling considérait que l’antigène fonctionnait comme un moule, autrement dit qu’il avait la capacité de « mettre en forme » l’anticorps. Cette théorie, baptisée « instructive », parce que l’anticorps se serait formé sur la base des instructions chimiques de l’antigène, fut en fait démentie par les recherches sur l’ADN au début des années 50. Les anticorps sont des protéines et, selon ces recherches, la possibilité de produire des protéines était liée à la présence dans l’ADN des gènes correspondants. En d’autres termes, un organisme n’aurait pu produire qu’un éventail limité d’anticorps et, en tout état de cause, aucun anticorps dont le gène correspondant n’existait pas dans son ADN.
Ce n’est qu’en 1955 que Niels K. Jerne (1911) publia l’article qui marqua un tournant décisif dans ce domaine. Dans cette étude, il avançait l’hypothèse de l’existence d’un mécanisme sélectif analogue à celui de la sélection naturelle avancé par Darwin et présidant à la détermination de l’anticorps. Dans le modèle de Jerne, connu sous le nom de « théorie sélective », l’anticorps existait déjà avant la rencontre avec l’antigène à la surface des cellules immunitaires, mais était « sélectionné » et se liait à l’antigène, déterminant ainsi la reproduction des cellules qui le transportaient et la destruction de l’antigène même.
LES COORDINATIONS ORGANIQUES
L’étude de la façon dont sont coordonnées dans le corps les différentes fonctions devint un nouveau domaine de recherche pour la physiologie à partir des années 20.
En 1923, Starling avait défini l’activité du système endocrinien comme « la sagesse du corps » pour souligner son importance dans le contrôle des différentes fonctions, dans la coordination et dans la régulation des conditions alternes de l’organisme. Cette définition deviendra le titre d’un livre de 1932 dans lequel l’auteur, Walter B. Cannon, précisera l’importance du maintien de ces conditions et introduira l’idée d’homéostasie en affirmant que le milieu interne de l’organisme ne peut pas varier sur le plan physico-chimique sans subir des dommages et qu’en présence de variations, l’organisme active des mécanismes de compensation de différente nature.
Dans de nombreux cas, ce sont certaines glandes endocrines qui rétablissent directement les conditions de normalité ; dans de nombreux autres cas, c’est le système nerveux et, en particulier, l’une de ces sections, le système nerveux autonome, ou végétatif, composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Chaque partie est formée de centres nerveux propres, localisés à l’intérieur du cerveau ou de la moelle épinière, ou en dehors du cerveau.
Dans les années 50, on verra que les deux systèmes de coordination (endocrinien et nerveux) ont des points de contact dans le système nerveux. À travers la zone de l’hypothalamus, des processus en cours dans le cerveau peuvent avoir des effets sur le système endocrinien parce qu’à l’hypothalamus est reliée l’hypophyse, la glande « directrice » du système endocrinien. C’est ainsi que naît la neuroendocrinologie, science de frontière entre la neurologie et l’endocrinologie. Mais les indices selon lesquels les activités mentales, et en particulier les émotions, conditionnent le fonctionnement de glandes de plus en plus forts, la neuroendocrinologie, est dépassée par une nouvelle discipline qui en intègre les connaissances, la psychoneuroendocrinologie. C’est là le point de référence cognitif d’un secteur de la médecine qui, à la fin des années 40, connaît une diffusion extraordinaire, la médecine psychosomatique. C’est ainsi qu’est né un mariage, que personne ne pensait possible, entre la psychologie et la physiologie, la psychologie et la médecine.
L’EXCRÉTION
Quand Claude Bernard jeta les bases de la physiologie générale, il était déjà clair que les organismes vivants avaient besoin d’éliminer les déchets du métabolisme, et tout ce qui était en excédent, de façon à maintenir l’équilibre interne. Dans ce sens, les découvertes relatives à l’excrétion se recoupent avec celles de la physiologie respiratoire sur l’élimination du gaz carbonique ou de la physiologie rénale concernant l’excrétion des substances azotées. Ce deuxième point mérite d’être souligné parce que, à tort ou à raison, parler d’excrétion signifie parler de physiologie rénale et de métabolisme des substances azotées.
Les recherches sur l’anatomie microscopique rénale et sur la formation de l’urine accomplissent d’importants pas en avant dans les années 20. Quelques années plus tard, en 1938, C. Fischer et S. W. Ranson découvrent que, dans le contrôle de l’activité rénale, interviennent aussi des signaux à distance provenant de l’hypophyse. À travers l’hormone antidiurétique, l’hypophyse promeut la réabsorption de l’eau dans les reins. Il est clair désormais que les reins sont fondamentaux pour la régulation de l’équilibre hydrominéral du corps et de l’acidité, le pH, des liquides corporels.
Mais dans les années 20 on découvre aussi les liens entre l’excrétion de l’azote et le milieu, c’est-à-dire entre la physiologie du métabolisme azoté et l’écologie (cycle de l’azote). En 1929, Joseph Needham (1900) précise que l’azote qui se forme dans les organismes par effet du métabolisme protéique est libéré par les organismes de façon différente. Cela dépend en partie du milieu dans lequel vivent les animaux, ainsi que de leur histoire évolutive. De nombreux vertébrés aquatiques et invertébrés éliminent les déchets azotés sous la forme d’ammoniac, un composé très toxique qu’ils peuvent éliminer avec facilité dans le milieu dans lequel ils vivent. Par contre, les Reptiles et les Oiseaux éliminent l’acide urique, tandis que les Mammifères et les Amphibiens se libèrent des substances azotées principalement après les avoir transformées en urée. Ces deux solutions, plus coûteuses en termes énergétiques, permettent toutefois d’économiser de l’eau et de retenir l’urine dans le corps sans risque. Needham souligne donc que le milieu dans lequel l’animal vit conditionne le choix de la voie métabolique.
LE MOUVEMENT MUSCULAIRE
Dans les premières années du XVIIIe siècle, où avaient déjà été accomplies des études anatomiques sur les nerfs et les centres nerveux, le mouvement musculaire était encore expliqué par les idées de Galien (130-200 env.). Nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il existait un fluide nerveux qui circulait dans les nerfs comme le sang circule dans les veines et que les muscles se contractaient grâce à l’intervention d’esprits animaux ou forces vitales.
Albrecht von Haller (1708-1777) découvrit le premier que les muscles étaient « irritables » parce que, si on les stimule de façon appropriée, ils se contractent, mais il vit aussi que l’on pouvait obtenir le même résultat par la stimulation du nerf relié au muscle. Étant donné que l’irritabilité du nerf était supérieure à l’irritabilité musculaire, von Haller en conclut que les mouvements musculaires normaux étaient commandés par la stimulation nerveuse. Cette théorie de l’irritabilité favorisait le dépassement des conceptions mécanistes précédentes et ouvrait la voie aux recherches sur la contraction musculaire. Luigi Galvani (1737-1798) commença ses études sur l’électricité animale et Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) ses études sur le rapport entre l’exercice musculaire et la consommation d’oxygène.
On découvrit par la suite que l’arrivée du signal nerveux au muscle se fait par un médiateur chimique qui est libéré par la partie terminale de la fibre nerveuse. Entre celle-ci et le muscle, il existe un espace de dimensions ultramicroscopiques analogue à l’espace qui relie les cellules du système nerveux. Mais comment se fait la contraction musculaire proprement dite ? Les recherches sur ce thème connaissent un véritable tournant dans les années 40, quand on observe que le muscle contient des molécules particulières (actine, myosine, tropomyosine) assemblées de façon « discontinue » et que, à l’arrivée de l’impulsion nerveuse, elles « glissent » l’une sur l’autre déterminant de cette façon le raccourcissement du muscle, c’est-à-dire la contraction (protéines dans les muscles).
LA NEUROPHYSIOLOGIE
Séparant la fonction nerveuse de la fonction musculaire, Albrecht von Haller définit avec clarté la fonction du nerf (mouvement musculaire). Celui-ci n’est pas vide et rempli d’un esprit vital, mais c’est un organe qui a la spécificité de transmettre et de produire la sensation. En outre, von Haller observe que tous les nerfs sont reliés au cerveau ou à la moelle épinière et que par conséquent ces derniers sont les centres de la perception sensorielle et des réponses de l’organisme.
L’œuvre de von Haller fut poursuivie par le médecin allemand Franz Joseph Gall (1758-1828), qui, dès 1796, démontra que les nerfs arrivaient dans une zone particulière du cerveau, la matière grise, à l’extérieur de la matière blanche, considérée seulement comme une substance conjonctive (organisation du cerveau). Comme von Haller, Gall était convaincu que certaines parties du cerveau commandaient des parties déterminées du corps, et il alla même jusqu’à considérer qu’à des parties spécifiques du cerveau correspondaient des qualités émotives et caractérielles particulières. Cette idée fut portée à ses extrémités par certains élèves, représentants de la phrénologie, selon lesquels ces qualités pouvaient être localisées en examinant les renflements du crâne. Malgré ces exagérations, l’idée selon laquelle, dans le cerveau, les différentes zones remplissent des tâches différentes s’affirma et mena à des résultats concrets. Au siècle suivant, par exemple, Pierre-Paul Broca (1824-1880) identifia la zone du cerveau responsable de la parole et, en 1870, par des expériences sur le cortex cérébral d’un chien, les deux neurologues allemands Gustav T. Fritsch (1838-1891) et Eduard Hitzig (1838-1907) découvrirent que la moitié gauche du cerveau, l’hémisphère gauche, commande la moitié droite du corps et l’hémisphère droit la moitié gauche.
Au début du XXe siècle, les études sur le système nerveux connaissent un grand développement. En 1873, Camillo Golgi (1843-1926) avait perfectionné une méthode de coloration du tissu nerveux qui permit d’en étudier la structure microscopique. En apparence, il semblait qu’il s’agissait d’un réseau, c’est-à-dire d’une structure continue, car il n’y avait pas d’espaces vides entre les unités constitutives du réseau, les neurones. Le neurologue espagnol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) pensait que ces espaces existaient pourtant, même s’il n’était pas encore possible d’en démontrer l’existence, et que le tissu nerveux était formé d’unités cellulaires élémentaires. Les théories « réticulaire » et « neuronale » se confrontèrent jusqu’à ce que le microscope électronique démontre qu’il existait effectivement un espace vide entre les cellules, baptisé synapses par Charles S. Sherrington (1857-1952).
Les recherches sur les neurones dévoilèrent également la véritable structure des nerfs. C’est un anatomiste allemand, Wilhelm von Waldeyer (1836-1921) qui, en 1891, démontra que les fibres nerveuses des nerfs étaient de fins prolongements des cellules nerveuses.
C’est au début du XXe siècle que remontent les premières recherches sur les mécanismes biochimiques responsables de la transmission des signaux nerveux. Curieusement, ces recherches furent conduites sur le cœur. En 1921, le chercheur Otto Loewi (1872-1961) identifia un mécanisme chimique par lequel le système nerveux régulait le battement cardiaque. Après la stimulation du nerf vague, dirigé vers un cœur contenu dans une solution, un peu de cette solution modifiait le battement d’un autre cœur. Évidemment, la stimulation nerveuse du premier cœur avait libéré une substance chimique en mesure de conditionner le battement du deuxième. Ce n’était que le début de recherches sur la transmission chimique de l’impulsion nerveuse entre les cellules qui donnèrent par la suite naissance à la neurochimie. Celle-ci a fourni au cours des années un panorama surprenant de ce qui a lieu entre les cellules nerveuses au passage du signal chimique (transmission de l’impulsion nerveuse). Tout d’abord, on a appris qu’il existe des dizaines de milliers de médiateurs chimiques de l’impulsion nerveuse, certains excitateurs d’autres inhibiteurs et que, en général, une cellule nerveuse en produit un seul type pour transmettre les signaux. En second lieu, on a découvert que ces médiateurs modifient le fonctionnement de la cellule cible, qui se trouve de l’autre côté de la synapse, seulement après s’être liés à des récepteurs, des « serrures » moléculaires.
Le scientifique qui a introduit le terme de synapse, Sherrington, a été l’un des premiers à étudier ce que l’on appelle les réflexes nerveux, ces mécanismes automatiques qui nous font par exemple fermer les paupières dès que quelque chose effleure notre œil ou retirer la main quand nous touchons un corps brûlant. Après des années où le système nerveux avait été le terrain de chasse exclusif des anatomistes, qui le considéraient plus comme un dépôt de cellules que comme un lieu où étaient remplies des fonctions, Sherrington mit l’accent sur ces dernières, raison pour laquelle il est considéré comme le fondateur de la neurophysiologie. Sa première découverte dans ce domaine fut que certains réflexes sont dus à un circuit très simple formé d’une cellule sensitive, qui reçoit le signal, et d’une cellule motrice, qui détermine une réponse motrice, naturellement reliées entre elles par une synapse. Le circuit fut appelé arc réflexe (les théories de Sherrington).
A la fin des années 20, en outre, le physiologiste russe Ivan P. Pavlov (1849-1936) entama une étude des réflexes conditionnés. Au cours d’expériences visant à déterminer l’influence du système nerveux sur la circulation et sur la digestion, Pavlov découvrit que les sucs gastriques et la salive étaient produits par l’animal à la seule vue de la nourriture, avant même que celle-ci ait atteint la bouche ou l’estomac, ou même en réponse à un signal particulier qui prédisposait l’animal à l’arrivée de la nourriture (réflexes conditionnés). Pavlov expliqua que cela avait lieu parce que, en associant le stimulus responsable d’un réflexe avec un autre stimulus indifférent, au bout d’un certain temps, on obtenait que ce dernier détermine à lui seul le réflexe en question. Si, par exemple, pendant un certain temps un chien recevait de la nourriture immédiatement après le son d’une cloche, ce stimulus seul finirait par faire saliver l’animal. Pavlov appela la production de salive en présence de nourriture dans la bouche réflexe inconditionné, et la production de salive due à cette espèce d’entraînement réflexe conditionné. Sur la base de ces observations, le savant formula une théorie générale des réflexes conditionnés par laquelle il pensait pouvoir expliquer le comportement.
Dans les années suivantes, les recherches de neurophysiologie connurent une certaine impulsion grâce à l’invention de techniques d’enregistrement de l’activité électrique des cellules nerveuses, comme, d’abord, l’électroencéphalographie, puis les potentiels évoqués. La première enregistre l’ensemble de l’activité électrique du cerveau tandis que la seconde contrôle l’intégrité des voies nerveuses chargées de la conduction de certaines impulsions à travers l’étude des potentiels électriques évoqués, c’est-à-dire déterminés, par des stimuli particuliers. Signalons également, parmi les techniques destinées à permettre l’étude fonctionnelle du cerveau, la tomographie à émission de positrons (PET, des initiales du terme anglais), une technique qui a littéralement révolutionné la recherche en psychologie et en neurophysiologie.

«
2
Au sein de la physiologie se développèrent de nouvelles sciences.
Au cours du
XIX esiècle, par exemple, les recherches sur la chimie des êtres vivants connurent
un progrès considérable, au point que pour beaucoup la physiologie finit par
signifier « chimie physiologique ».
Au début, il s’agissait d’études sur des problèmes
particuliers de l’être vivant, mais, au cours du XIX esiècle et dans les premières
années du XX esiècle, on parvint à dresser un tableau assez clair des
transformations chimiques des cellules et de l’organisme dans son ensemble.
C’est
ainsi qu’à la frontière entre la chimie et la physiologie advint une science nouvelle,
la biochimie, c’est-à-dire la chimie de la vie.
Soulignons que dans l’ensemble les études de physiologie, tout comme celles
d’anatomie, ont confirmé que les êtres vivants obéissent tous à quelques lois
fondamentales, et que de très nombreux mécanismes élémentaires sont présents
partout dans le monde vivant, de la libellule à l’éléphant, des champignons à
l’homme.
LA PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE : CLAUDE BERNARD
Dans sa tentative de rassembler en un corps unique de connaissances les
manifestations communes des êtres vivants, le savant français Claude Bernard
(1813-1878) fonde au XIX esiècle la physiologie générale.
Du moment où il obtient son doctorat de médecine, en 1843, jusqu’à sa mort,
Bernard étudia de très nombreux problèmes de physiologie, apportant chaque fois
de nouvelles solutions.
Mais c’est du point de vue de la méthodologie que la
contribution de Claude Bernard fut fondamentale.
Son œ uvre principale, publiée en
1865, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale , est encore la référence
de la physiologie moderne.
C’est presque un manifeste de la méthode
expérimentale et de la physiologie générale.
Celle-ci étudie les conditions
élémentaires communes à tous les organismes vivants et doit se soumettre au
contrôle du doute méthodique, mais sans scepticisme.
Les phénomènes vitaux,
malgré leur spontanéité apparente, obéissent à des lois précises, fixes et
prévisibles, et même s’ils apparaissent animés par une finalité interne, en réalité ils
dérivent de l’activité organisée des différentes parties.
L’idée de Claude Bernard, c’est-à-dire celle de l’unité substantielle du monde vivant,
recevra de nombreuses confirmations, apportées notamment par des études sur
l’ultrastructure et sur le métabolisme.
Par exemple, quand en 1929 K.
Lohamann
découvrira l’ATP, l’adénosine-triphosphate, et l’on verra que tous les êtres vivants
utilisent cette molécule comme « monnaie énergétique ».
Certains chercheurs
partiront de cette universalité pour retracer le parcours possible de l’évolution
biochimique.
LA NUTRITION
En 1827, William Prout, un médecin anglais, montra le premier de façon précise
que trois classes d’éléments devaient être présentes dans l’alimentation normale :
les sucres, les huiles et l’albumine, qu’on appelle protéines depuis Gerardus
Mulder.
Par la suite, des progrès importants furent accomplis par Justus von Liebig
(1803-1873), qui, en 1842, publia un traité, Die Tierchemie , dans lequel il appliquait
ses théories chimiques à la physiologie humaine, animale et végétale.
C’est à lui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La lecture peut vous paraître un acte banal. En fait, c'est une activité complexe qui est tributaire des conditions physiques, des expériences personnelles et de la culture du lecteur, au point que l'on a pu dire : « Le lecteur [...] se définit par une physiologie, une histoire et une bibliothèque. » Vous commenterez cette formule en vous fondant sur des exemples précis. ?
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Histoire de l'esclavage
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer: Une histoire des mathématiques (résumé)
- Bill Bryson: Histoire de tout, ou presque ...