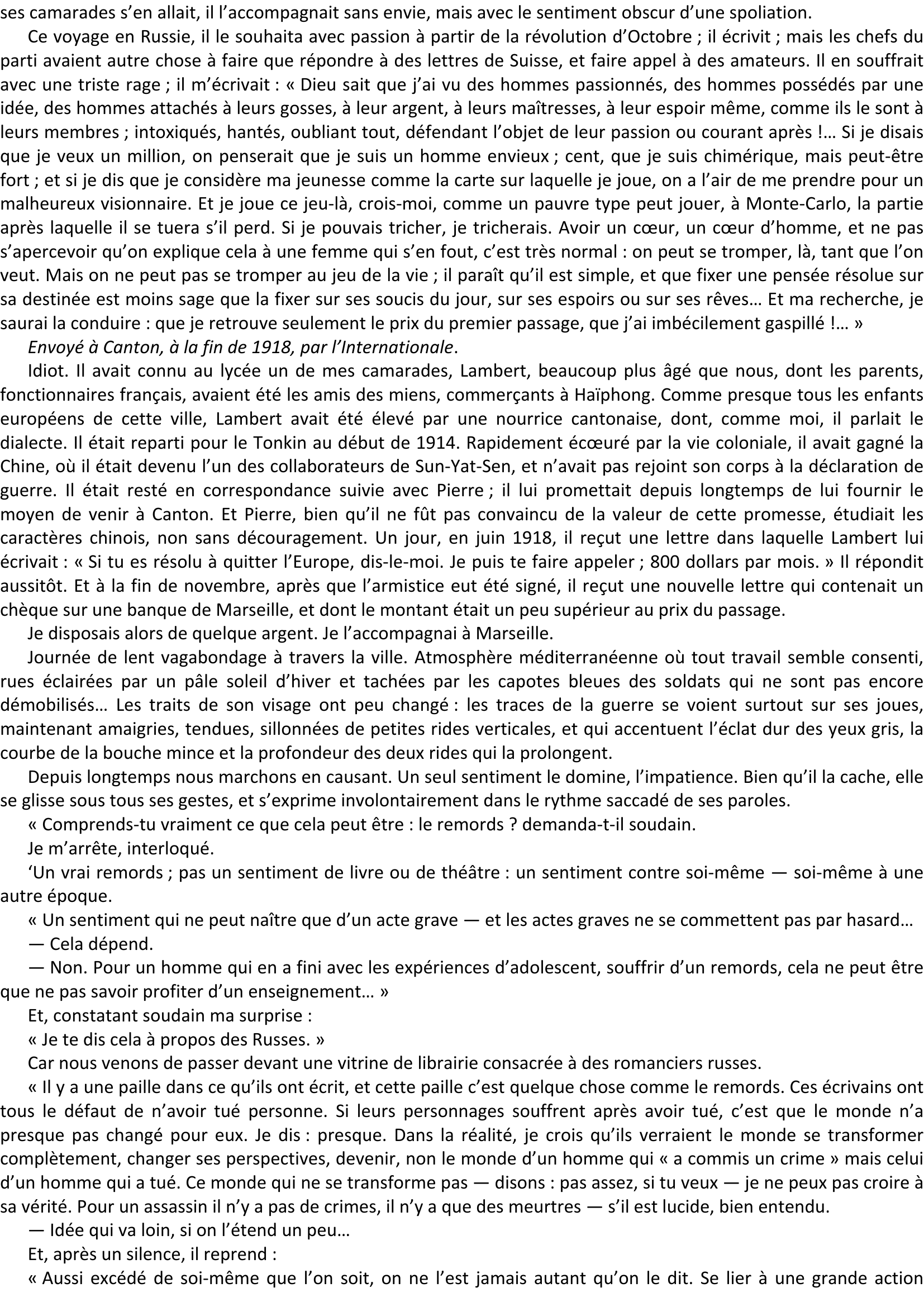la fin de la pièce qui le libérerait de sa corvée.
Publié le 04/11/2013

Extrait du document
«
ses
camarades s’enallait, ill’accompagnait sansenvie, maisaveclesentiment obscurd’unespoliation.
Ce voyage enRussie, ille souhaita avecpassion àpartir delarévolution d’Octobre ; ilécrivit ; maisleschefs du
parti avaient autrechose àfaire querépondre àdes lettres deSuisse, etfaire appel àdes amateurs.
Ilen souffrait
avec unetriste rage ; ilm’écrivait : « Dieusaitque j’aivudes hommes passionnés, deshommes possédés parune
idée, deshommes attachésàleurs gosses, àleur argent, àleurs maîtresses, àleur espoir même, comme ilslesont à
leurs membres ; intoxiqués, hantés,oubliant tout,défendant l’objetdeleur passion oucourant après !… Sije disais
que jeveux unmillion, onpenserait quejesuis unhomme envieux ; cent,quejesuis chimérique, maispeut-être
fort ; etsije dis que jeconsidère majeunesse commelacarte surlaquelle jejoue, onal’air deme prendre pourun
malheureux visionnaire.Etjejoue cejeu-là, crois-moi, commeunpauvre typepeut jouer, àMonte-Carlo, lapartie
après laquelle ilse tuera s’ilperd.
Sije pouvais tricher,jetricherais.
Avoiruncœur, uncœur d’homme, etne pas
s’apercevoir qu’onexplique celaàune femme quis’en fout, c’esttrèsnormal : onpeut setromper, là,tant quel’on
veut.
Maisonnepeut passetromper aujeu delavie ; ilparaît qu’ilestsimple, etque fixer unepensée résolue sur
sa destinée estmoins sagequelafixer surses soucis dujour, surses espoirs ousur ses rêves… Etma recherche, je
saurai laconduire : quejeretrouve seulement leprix dupremier passage, quej’aiimbécilement gaspillé !… »Envoyé
àCanton, àla fin de1918, parl’Internationale .
Idiot.
Ilavait connu aulycée undemes camarades, Lambert,beaucoup plusâgéque nous, dontlesparents,
fonctionnaires français,avaientétélesamis desmiens, commerçants àHaïphong.
Commepresque touslesenfants
européens decette ville,Lambert avaitétéélevé parune nourrice cantonaise, dont,comme moi,ilparlait le
dialecte.
Ilétait reparti pourleTonkin audébut de1914.
Rapidement écœuréparlavie coloniale, ilavait gagné la
Chine, oùilétait devenu l’undescollaborateurs deSun-Yat-Sen, etn’avait pasrejoint soncorps àla déclaration de
guerre.
Ilétait resté encorrespondance suivieavecPierre ; illui promettait depuislongtemps deluifournir le
moyen devenir àCanton.
EtPierre, bienqu’ilneft pas convaincu delavaleur decette promesse, étudiaitles
caractères chinois,nonsans découragement.
Unjour, enjuin 1918, ilreçut unelettre danslaquelle Lambert lui
écrivait : « Situes résolu àquitter l’Europe, dis-le-moi.
Jepuis tefaire appeler ; 800dollars parmois. » Ilrépondit
aussitôt.
Etàla fin denovembre, aprèsquel’armistice eutétésigné, ilreçut unenouvelle lettrequicontenait un
chèque surune banque deMarseille, etdont lemontant étaitunpeu supérieur auprix dupassage.
Je disposais alorsdequelque argent.Jel’accompagnai àMarseille.
Journée delent vagabondage àtravers laville.
Atmosphère méditerranéenne oùtout travail semble consenti,
rues éclairées parunpâle soleil d’hiver ettachées parlescapotes bleuesdessoldats quinesont pasencore
démobilisés… Lestraits deson visage ontpeu changé : lestraces delaguerre sevoient surtout surses joues,
maintenant amaigries,tendues,sillonnées depetites ridesverticales, etqui accentuent l’éclatdurdes yeux gris,la
courbe delabouche minceetlaprofondeur desdeux rides quilaprolongent.
Depuis longtemps nousmarchons encausant.
Unseul sentiment ledomine, l’impatience.
Bienqu’illacache, elle
se glisse soustoussesgestes, ets’exprime involontairement danslerythme saccadé deses paroles.
« Comprends-tu vraimentceque cela peut être : leremords ? demanda-t-il soudain.
Je m’arrête, interloqué.
‘Un vrai remords ; pasunsentiment delivre oudethéâtre : unsentiment contresoi-même —soi-même àune
autre époque.
« Un sentiment quinepeut naître qued’un actegrave —etles actes graves nesecommettent pasparhasard…
— Cela dépend.
— Non.
Pourunhomme quienafini avec lesexpériences d’adolescent, souffrird’unremords, celanepeut être
que nepas savoir profiter d’unenseignement… »
Et, constatant soudainmasurprise :
« Je tedis cela àpropos desRusses. »
Car nous venons depasser devant unevitrine delibrairie consacrée àdes romanciers russes.
« Il ya une paille danscequ’ils ontécrit, etcette paille c’estquelque chosecomme leremords.
Cesécrivains ont
tous ledéfaut den’avoir tuépersonne.
Sileurs personnages souffrentaprèsavoirtué,c’est quelemonde n’a
presque paschangé poureux.Jedis : presque.
Danslaréalité, jecrois qu’ils verraient lemonde setransformer
complètement, changersesperspectives, devenir,nonlemonde d’unhomme qui« acommis uncrime » maiscelui
d’un homme quiatué.
Cemonde quinesetransforme pas—disons : pasassez, situ veux —jene peux pascroire à
sa vérité.
Pourunassassin iln’y apas decrimes, iln’y aque desmeurtres —s’il est lucide, bienentendu.
— Idée quivaloin, sion l’étend unpeu…
Et, après unsilence, ilreprend :
« Aussi excédé desoi-même quel’onsoit, onnel’est jamais autant qu’onledit.
Selier àune grande action.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'homme est un pont, non une fin. Nietzsche.
- Le théâtre a-t-il pour fonction de tout dire, de tout expliquer au spectateur de la crise que vivent les personnages? - Par quels moyens et quelles fonctions Juste la Fin du monde est une pièce qui nous retrace la crise de cette famille?
- la fin justifie les moyens
- L'EUROPE DE L'OUEST EN CONSTRUCTION JUSQU'A LA FIN DES ANNÉES 1980
- Lecture linéaire1 : prologue de Juste la Fin du Monde, Jean-Luc LAGARCE